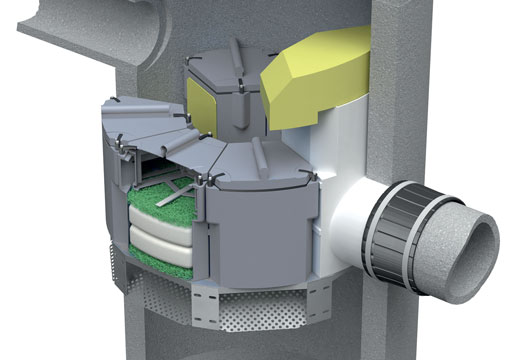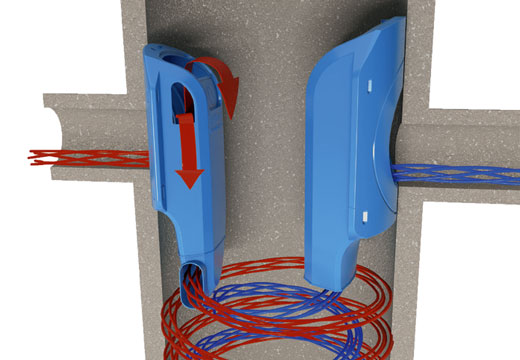« Nous avons modifié les conditions du cycle de l'eau et cela complique d'autant les conséquences des effets du changement climatique », a pointé Jean-Jacques Hérin, président de l'Astee Hauts-de-France et d'Adopta, mardi 14 mars, lors d'une journée consacrée à la sécheresse et aux eaux pluviales (1) . Pendant de nombreuses années, la gestion de l'eau pluviale a consisté à l'évacuer rapidement hors des villes grâce à des réseaux. De la même manière, un certain nombre de cours d'eau ont été artificialisés et ne peuvent plus, lors des crues, s'étaler dans leurs lits majeurs et recharger les nappes. Et les possibilités pour l'eau de s'infiltrer dans les sols se réduisent rapidement. En France, l'artificialisation augmente ainsi presque quatre fois plus vite que la population.
Si les approches de la gestion des eaux pluviales commencent à changer, le rythme apparaît trop lent aux vues des enjeux en cours. « Avec le changement climatique, les précipitations tombent plus violemment sur moins de jours, a expliqué Jean-Jacques Hérin. En parallèle, l'assèchement des sols s'accroît. Et la conjugaison de pluies intenses et de sols plus secs favorise le ruissellement : nous disposons alors de moins de pluie utile pour recharger les nappes. » Et ce constat devrait s'accentuer à l'avenir avec l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes.
Le zonage pluvial, outil obligatoire mais sans date butoir
Parmi les outils que souhaite encourager le plan figure le zonage pluvial. Ce dernier est une aide à la décision qui définit les zones où des mesures de limitation de l'imperméabilisation des sols doivent être prises. Obligatoire depuis 1992, le zonage pluvial est toutefois un outil peu déployé par les collectivités. En cause notamment : l'absence d'échéance de réalisation. Pour y remédier et pour pousser les collectivités à s'en emparer, le plan d'actions national vise à introduire dans la législation une date boutoir. Mais l'horizon de 2026 envisagée dans un premier temps ne semble désormais plus d'actualité.La Deru veut limiter les rejets de temps de pluie
Dans le cadre de la révision de la directive Eaux urbaines résiduaires (Deru), la Commission européenne a proposé d'agir sur les pollutions liées au ruissellement urbain et les débordements d'eaux usées des réseaux d'assainissement lors des orages. Elle fixe un objectif de surverse d'au plus 1 % des eaux collectées annuellement, au plus tard entre décembre 2025 et 2040 selon la taille des agglomérations (contre 5 % aujourd'hui dans la réglementation française).
Le guide (2) d'accompagnement, prévu par le plan et réalisé par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), a toutefois été publié. « Nous conseillons de réaliser l'étude du zonage à l'échelle du bassin versant », a indiqué Bruno Kerloc'h, chef de groupe biodiversité, eau et risques au Cerema Hauts-de-France. Autre préconisation forte : l'outil doit être intégré dans les documents d'urbanisme afin d'être opposable aux aménageurs. Ainsi, la réalisation d'un zonage peut s'accompagner de la révision du plan local d'urbanisme pour que les documents soient cohérents.
Potentiellement complexe, la démarche peut toutefois être adaptée aux moyens dont disposent les acteurs. « Un zonage peut être réalisé de façon simple, a assuré Bruno Kerloc'h. Si une petite collectivité répertorie les zones où elle peut intervenir, c'est déjà un point positif. »
L'élaboration d'un zonage pluvial est également une bonne occasion pour sensibiliser et informer sur les enjeux des eaux de pluie.
Des effets visibles sur le long terme, mais conséquents
Concrètement pour limiter l'imperméabilisation, plusieurs options sont envisageables : la mobilisation de l'ensemble des services pour mettre en place une déconnexion du réseau des eaux pluviales à chaque projet, l'application d'un seuil pour l'imperméabilisation (coefficient d'imperméabilisation limite), l'utilisation de matériau perméable d'espaces végétalisés, mais également l'application d'un abattement volumique de hauteur d'eau. « C'est la tendance aujourd'hui », a constaté Bruno Kerloc'h. Par exemple, la Ville de Paris a établi, en 2016, quatre niveaux de premiers millimètres de pluie tombée à exclure des réseaux, en fonction des caractéristiques de son territoire : 4, 8, 12 et 16 millimètres. « Ce qui s'est traduit – comme Paris est très dense – par le développement de beaucoup de projets de toitures végétalisées pour respecter ces limitations de volume ».
Le résultat de ces actions peut néanmoins être long à observer. Certaines collectivités précurseurs commencent toutefois à disposer d'un retour d'expérience. C'est le cas de Douaisis Agglomération qui a élaboré un zonage des secteurs sensibles par temps de pluie en 1998. « Les volumes globaux rejetés ont été divisés par trois, c'est énorme, a noté Bruno Kerloc'h. Il y a également deux fois moins de déversements issus des déversoirs d'orages dans la station d'épuration, les volumes non traités ont été divisés par six. » Par ailleurs, grâce à ces mesures, la collectivité a pu éviter la construction d'un bassin de stockage (restitution de 7 600 m3) et donc économiser près de 7,6 millions d'euros, selon le Cerema.