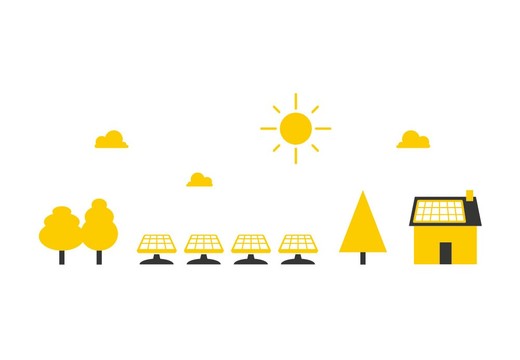La loi sur la transition énergétique prévoit un doublement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale de chaleur d'ici 2030. La biomasse devrait être fortement sollicitée pour répondre à cet objectif, avec des risques d'une gestion non durable des ressources forestières et des impacts plus larges sur l'environnement. "La récolte de bois pour la production des plaquettes forestières a d'ores et déjà plus que triplé au cours des dix dernières années (...). En parallèle, la récolte du bois bûche s'est réduite", note une étude (1) publiée par l'Ademe, en partenariat avec l'Inra, le FCBA, l'Irstea, l'ONF, Ecofor et le GCF (2) .
Les impacts peuvent aussi être positifs
L'exploitation de bois énergie n'a pas que des impacts négatifs sur les milieux forestiers. Elle permet par exemple de renouveler ou de transformer certains peuplements vieillissants, ou de réduire le risque d'incendie.
La production des plaquettes mobilise des ressources nouvelles : arbres entiers qui ont un petit diamètre et houppiers entiers, branches d'un diamètre inférieur à 7 cm, communément appelés les "menus bois", ou des souches… Or, ces ressources sont importantes pour la biodiversité forestière et la bonne santé des sols (apports en minéraux, …). L'étude est donc accompagnée de recommandations (3) précises pour mener une exploitation durable des forêts. "La rédaction de ces recommandations a nécessité une expertise collective approfondie, qui a associé pendant près de trois ans une vingtaine d'experts issus de la recherche académique, de la recherche & développement et d'acteurs de terrain", souligne l'Ademe.
Des impacts multiples
"Le risque de perte de fertilité des sols forestiers associé à la récolte de menus bois et souches est lié, d'une part à l'exportation parfois forte d'éléments minéraux et, d'autre part à la sensibilité des sols vis-à-vis de l'exportation des éléments minéraux", indique l'étude. Ces éléments, autrefois laissés sur place, "constituent une biomasse riche en éléments nutritifs : calcium (Ca), magnésium (Mg), potassium (K), phosphore (P) et azote (N)". Priver une parcelle de ces apports peut avoir "des effets marqués et prolongés – pendant plus de 15 ans – sur la fertilité du sol et la production du peuplement".
L'exploitation forestière peut également avoir un impact sur tout un écosystème (mousses, champignons, bactéries…). Par exemple, "certaines pratiques actuelles de la récolte de bois à des fins énergétiques modifient la quantité et la diversité des bois morts", essentiels pourtant au fonctionnement de l'écosystème.
Enfin, les gros engins d'exploitation peuvent tasser les sols et engendrer des dégâts irréversibles. L'érosion des sols constitue un risque, alors que les forêts jouent un rôle important dans l'infiltration de l'eau.
Zoom sur !es bonnes pratiques
L'étude recommande de réaliser un diagnostic pour évaluer les enjeux liés à la biodiversité et à la qualité des sols, avant toute exploitation.
Par ailleurs, le fait de laisser le feuillage sur place lors des récoltes permettrait de limiter les risques de l'appauvrissement des sols, cet élément étant particulièrement riche en nutriments (4) . L'idéal serait d'espacer les récoltes des menus bois de 15 ans, voire de 30 ans pour les sols particulièrement appauvris. A défaut, laisser 10 à 30 % de cette ressource sur place permettrait d'apporter les éléments essentiels au sol. L'étude dresse également des recommandations pour le prélèvement des souches.
Pour limiter les impacts sur la biodiversité, l'étude préconise de préserver les refuges : pièces des bois morts (chandelles, chablis isolés, gros bois morts au sol…), arbres vivants constituant des supports de biodiversité (arbres isolés à cavités, îlots de gros et vieux arbres vivants), fruitiers et autres essences secondaires.
Éviter la circulation des engins sur toute la parcelle et protéger les voies de passage avec du menu bois permet d'amortir le poids et de limiter le phénomène du tassement des sols. Enfin, ne pas laisser un sol nu, protéger les bords des cours d'eau et les zones humides permettra de limiter l'érosion et de faciliter l'infiltration des eaux.