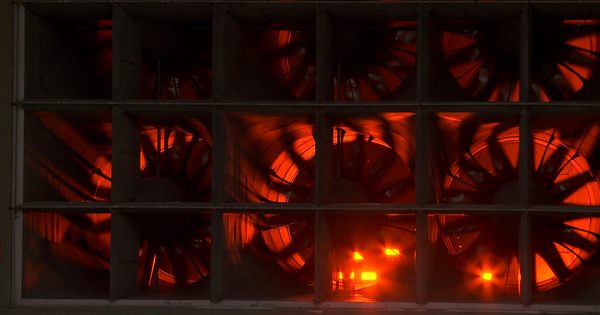Les riverains du site industriel de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) affichent une préoccupation croissante concernant les enjeux de santé environnementale. Ils souhaitent que soient menées des études épidémiologiques, "même si l'absence de conclusion causale est anticipée du fait de limites méthodologiques (multifactorialité, effets cocktails)". Par ailleurs, "une transparence sur les méthodes et les conditions de réalisation des études épidémiologiques est particulièrement attendue compte tenu des soupçons de collusion entre les acteurs publics qui les portent, l'Etat et l'industrie."
Telles sont les principales conclusions d'une étude (1) du contexte local du site Lacq publiée le 9 mai par Santé publique France. Elle visait à "identifier les perceptions, les interrogations et attentes de différents acteurs locaux à l'égard des liens entre santé et environnement autour du site". L'agence nationale de santé publique s'est notamment appuyée sur 39 entretiens semi directifs réalisés par l'Ifop auprès des parties prenantes.
Moindre acceptation des nuisances
Sans surprise, l'enjeu économique et la question de l'emploi sont présents chez tous les interviewés. De 1950 à 2000, "le développement économique de la région relègue au second plan les questions environnementales et sanitaires", rappelle l'étude, précisant que cela "[a eu] d'autant plus de force que le système d'indemnisation mis en place a agi comme un levier compensatoire essentiel". Mais avec le déclin du gisement de gaz, "les années 2000 marquent une rupture forte". Même si l'acceptation du site reste élevée, la population montre "une moindre acceptabilité des nuisances face aux doutes qui peuvent exister sur la qualité environnementale et sanitaire à proximité du bassin". L'étude de Santé publique France met notamment en avant un discours plus critique chez les personnes qui souffrent d'un symptôme ou subissent une gêne. Quant aux professionnels de santé, ils "confirment la présence de symptômes possiblement associés aux polluants rejetés et se montrent inquiets sur la situation sanitaire et environnementale autour du bassin industriel".
En 2002, une étude épidémiologique réalisée par l'Institut de santé publique, d'épidémiologie de développement (Isped) "a mis en évidence (…) une surmortalité dans la zone à proximité du bassin industriel de Lacq comparativement aux zones témoins plus distantes, chez les personnes âgées de moins de 65 ans, pour toutes causes de décès confondues et par cancer", rappelle Santé publique France. Pour autant, "compte tenu du type d'étude conduite (descriptive), ces résultats « ne permettaient toutefois pas de conclure en termes de causalité par rapport aux émissions de polluants » selon l'Isped". En 2007, une évaluation des risques sanitaires de zone a identifié cinq substances préoccupantes : dioxyde de soufre, oxyde d'éthylène, benzène, l'acétaldéhyde et le dichlorométhane.
En 2015, un collectif d'élus, l'association Sépanso et une série de plaintes de riverains relatives à des nuisances olfactives, conduisent la Direction générale de la santé (DGS) à demander à Santé publique France d'évaluer l'opportunité́ de la mise en place d'une surveillance épidémiologique autour du bassin de Lacq. L'étude du contexte locale est le premier volet de ce travail. Santé publique France doit encore en réaliser deux autres : une étude géographique de mortalité et une étude exploratoire de morbidité.
La zone industrielle de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) regroupe l'exploitation du plus gros gisement gazier de France, ainsi des activités de désulfurisation, de thiochimie (chimie du soufre) et de chimie fine. Le site comprend 43 installations classées (ICPE) dont 15 sont classées Seveso seuil haut et 6 Seveso seuil bas.