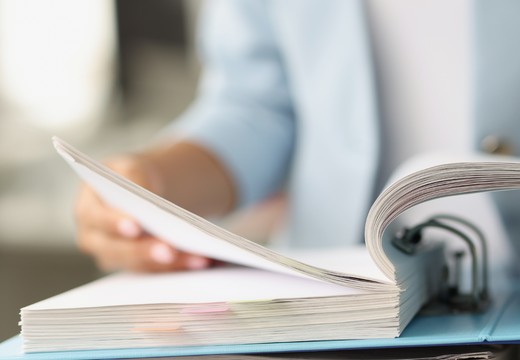Avocat et président de la commission droit et politiques environnementales de l'UICN France
Actu-Environnement.com : Pourquoi un tel appel ?
Sébastien Mabile : Les questions liées à l'application du droit de l'environnement et les litiges relatifs aux atteintes à l'environnement prennent de plus en plus d'importance comme le montrent les affaires de Notre-Dame-des-Landes, Sivens, l'Erika, Xynthia, AZF ou le scandale de l'amiante. Les dossiers sont complexes et font appel à la fois à des connaissances en droit de l'environnement et aux sciences de la vie comme on peut le voir avec les questions de compensation ou de réparation des pollutions. Or, il y a un déficit de formation des magistrats et d'intérêt pour la matière, en particulier dans l'ordre judiciaire. S'y ajoutent des choix de politique pénale qui privilégient les atteintes aux personnes plutôt que celles portant sur l'environnement.
AE : D'autres pays ont-ils déjà choisi cette voie ?
SM : Quarante-quatre pays sont déjà engagés dans la voie de la spécialisation. C'est le cas de la Chine qui possède plus 130 tribunaux environnementaux, l'Inde qui en a cinq ou le Chili trois. Mais la spécialisation des juridictions recouvre des réalités très différentes. On peut avoir des juridictions ultra spécialisées sur la sylviculture, les mines ou le pétrole comme en Colombie britannique ou au Canada. Certaines juridictions sont autonomes comme en Australie ou en Nouvelle Zélande et compétentes à la fois dans les domaines judiciaires et administratifs. Il peut y avoir aussi création de chambres spécialisées au sein des juridictions de droit commun comme à Hawaï ou au Brésil. La spécialisation peut ne porter que sur l'ordre administratif comme en Angleterre ou ne concerner que le Parquet comme en Espagne, où un parquet spécialisé dispose d'agents de la Guardia civil dédiés au contentieux environnemental. Le champ de la spécialisation peut ne concerner que l'environnement ou aller au delà en prenant en compte la santé ou l'urbanisme.
AE : En quoi consiste l'appel ?
SM : Il s'agit d'un appel (1) à l'exécutif à engager la réflexion. Il va dans le sens du rapport du Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (Cimap) qui, il y a deux ans, préconisait la création de chambres spécialisées au sein des tribunaux de grande instance (TGI). Il s'agit d'améliorer globalement le traitement du contentieux environnemental qui pose de nouvelles questions de responsabilité avec les changements climatiques et fait appel à de nouveaux concepts de justice environnementale et d'équité intra ou intergénérationnelles. Ce qui soulève des questions éthiques importantes. Cet appel fait suite à une motion adoptée par l'assemblée des membres de l'UICN lors de son dernier congrès à Hawaï en septembre 2016. La France a voté cette motion mais elle est plutôt à la traîne.
AE : Croyez-vous au nouvel exécutif pour mettre en œuvre une telle réforme ?
SM : Le ministère de l'Environnement ne saisit pas d'emblée l'importance des juges. Le ministère de la Justice, de son côté, s'intéresse très peu à l'environnement. Il est souvent difficile de sensibiliser les deux en même temps. Nous plaçons beaucoup d'espoir sur Nicolas Hulot qui est pleinement sensibilisé aux conséquences des changements climatiques et aux responsabilités des différents acteurs. Il a parlé de crime contre l'humanité à propos de la politique climatique de Donald Trump. Ces mots renvoient à des qualifications juridiques et ce n'est pas anodin.
AE : Privilégiez-vous une solution plutôt qu'une autre ?
SM : Ce n'est pas à nous de trancher. Notre tradition juridique va plutôt dans le sens de la création de chambres spécialisées ou de TGI dédiés, dans le ressort des cours d'appel ou des régions, compétents pour recevoir l'ensemble du contentieux environnemental plutôt que vers des juridictions autonomes comme au Chili ou en Inde. La création de chambres spécialisées dans la pollution maritime au sein des TGI de Marseille, du Havre et de Brest, après l'Erika a porté ses fruits. Elle a permis d'améliorer les sanctions contre les armateurs pollueurs, ce qui a entraîné une baisse sensible des dégazages. La spécialisation de la cour administrative d'appel de Nantes pour les litiges en matière d'énergie marine va dans le même sens. La spécialisation des juridictions est d'ailleurs possible par la voie réglementaire.
AE : Une telle réforme se suffira-t-elle à elle-même ?
SM : Un mouvement de simplification du droit de l'environnement doit aller de pair, comme ce fût le cas en Suède. Une simplification des procédures administratives est nécessaire. Il s'agit aussi de supprimer les infractions spéciales prévues dans le code l'environnement qui sont difficiles à caractériser au profit d'un délit général d'atteinte à l'environnement. La reconnaissance du préjudice écologique dans le code civil va dans ce sens.
AE : Cet appel est-il partagé ?
SM : Il y a un très large consensus aujourd'hui qui réunit tant les universitaires que les praticiens du droit de l'environnement, les ONG comme France Nature Environnement ou Surfrider, que des organisations patronales. Le Medef s'est prononcé en faveur d'une telle spécialisation dans son livre blanc pour la modernisation du droit de l'environnement mais il n'a finalement pas signé l'appel car il est en revanche farouchement opposé à une spécialisation du Parquet.