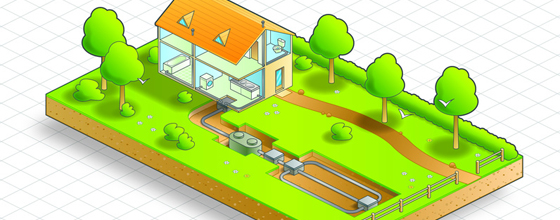La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 prévoyait que les installations d'assainissement non collectif (ANC) (1) soient contrôlées et réhabilitées au 1er janvier 2013. Près de 70 % des installations autonomes ne seraient en effet pas conformes. La loi Grenelle 2 a assoupli ces exigences et prévoit désormais qu'en matière d'ANC, ''pour les installations existantes, des travaux ne seront nécessaires, à l'issue du contrôle, qu'en cas de danger pour les personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement, dont les critères d'évaluation seront définis par arrêté interministériel''. Cet arrêté est très attendu par les particuliers concernés.
Un financement des travaux par les agences de l'eau ?
Le coût des travaux de mise en conformité peut être élevé. ''Des réflexions sont actuellement en cours pour préparer les dixièmes programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau. Dans ce cadre, l'intégration, dans les programmes 2013-2018, de la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif sera proposée au Parlement (modification de l'article 83 de la loi LEMA)'', indique le ministère de l'Ecologie dans une réponse écrite publiée au Journal officiel le 9 août.
Pour l'heure, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) ou certaines collectivités peuvent financer en partie les travaux de mise en conformité. L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), selon des conditions d'éligibilité, peut également être utilisé pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d'ANC ne consommant pas d'énergie. En revanche, la question d'un crédit d'impôt dédié aux travaux de réhabilitation a été écartée par les parlementaires dans le cadre du vote de la loi LEMA en 2006.
Cependant, les conclusions à tirer de ce test font l'objet de désaccords entre les ministères de l'écologie et de la santé, notamment sur la définition des situations jugées prioritaires. Le ministère de l'écologie pencherait pour une approche ''pragmatique'' : prioriser les efforts sur les points noirs d'ici quatre ans et définir ensuite chaque année les catégories d'installations concernées par une obligation de travaux à échéance plus ou moins longue. Le ministère de la santé souhaiterait de son côté fixer des objectifs plus ambitieux, mais jugés non atteignables par l'écologie. Un arbitrage interministériel est attendu pour le mois de septembre.
Les risques sanitaires et environnementaux pris en compte
Dans le projet de grille d'évaluation, cinq points ont été identifiés comme représentant un risque sanitaire direct. Tout d'abord, le contact possible avec les eaux usées non traitées ou pré-traitées pourrait constituer un risque de transmission de maladies, via les germes microbiens pathogènes contenus dans les eaux grises. Ensuite, est considéré comme risque sanitaire direct, le risque de contamination microbiologique ou chimique de la ressource en eau lorsque celle-ci est associée à un usage présentant des enjeux sanitaires (production d'eau potable, baignade, pêche, activités nautiques…). Le dégagement d'odeurs peut également avoir un impact significatif sur la santé des personnes et être associé à la présence dans l'air de composés nocifs. Des risques sanitaires peuvent être aussi liés à la sécurité des ouvrages : un défaut de résistance structurelle ou de fermeture pouvant entraîner chutes, blessures voire noyades. Enfin, le risque est direct lorsqu'il y a risque de transmission vectorielle de maladies de type arbovirose (chikungunya, dengue, fièvre de la vallée du Rift, West Nile, etc.) et parasitaire (paludisme) par les moustiques, les eaux usées pouvant constituer des lieux de ponte.
Des zones à enjeux sanitaires pourraient être définies lorsque l'ANC est située dans un périmètre de protection rapprochée de captage public utilisé pour l'alimentation en eau potable ou dans une zone située à moins de 35 mètres d'un puits privé déclaré. Les périmètres de protection éloignée de captage, les zones à proximité d'une baignade et à proximité de conchyculture, pisciculture, ramassage de coquillages pourraient également être visés.
La notion de risque environnemental comprend quant à elle le risque de contamination physico-chimique de la ressource en eau tant superficielle que souterraine, notamment en matières organiques, matières en suspension, demande biochimique en oxygène (DBO5) pouvant engendrer des modifications significatives sur les milieux aquatiques (eutrophisation, appauvrissement en oxygène…). Des zones à enjeux environnementaux pourraient être définies lorsqu'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontre l'impact de l'ANC.
L'arbre de décision testé
Le projet de grille d'évaluation prévoyait un risque élevé lorsqu'il n'y a pas d'installation ANC (absence de prétraitement, rejet direct dans un puisard), lorsque cette installation est incomplète ou fonctionne mal (absence de prétraitement, de traitement ou d'évacuation, installation sous-dimensionnée, résurgence d'eaux usées ou d'odeurs, rejet d'eau usée de mauvaise qualité) et lorsque le risque sanitaire est direct ou lorsque l'ANC est située dans une zone à enjeu environnemental ou sanitaire.
Le risque est considéré comme modéré lorsqu'une absence totale d'installation ne présente pas d'enjeu sanitaire direct et qu'elle n'est pas localisée dans une zone à enjeu ou lorsque l'installation est incomplète (ou fonctionne mal), et qu'elle ne représente pas de risque sanitaire direct.
Enfin, le risque est considéré comme faible lorsque l'installation est incomplète ou qu'elle fonctionne mal, s'il n'y a pas de risque sanitaire direct et que l'ANC n'est pas située dans une zone à enjeu.
En fait, c'est la notion d'urgence attribuée à chaque type de risque qui fait l'objet d'un désaccord entre les ministères aujourd'hui : jusqu'à quel niveau de risque ordonner des travaux et à quelle échéance ?