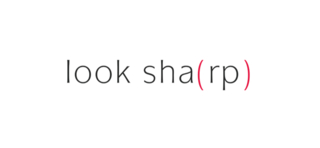Il y a dix ans tout juste, à Dacca, capitale du Bangladesh, plus d'un millier de personnes périssaient dans l'effondrement du Rana Plaza, victimes de toute une série de négligences et de manquements aux impératifs de sécurité. L'immeuble abritait plusieurs ateliers de confection travaillant pour des marques internationales de fast-fashion, dont l'espagnol Mango et l'irlandais Primark.
La catastrophe n'est pas directement à l'origine de la loi française sur le devoir de vigilance, qui impose désormais aux multinationales de 5 000 salariés (10 000 avec leurs filiales à l'étranger) de mettre en œuvre un plan spécifique pour éviter les violations des droits de l'homme et les dommages environnementaux liés à leurs activités, tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Voté en 2017, le texte avait en effet été proposé dès 2012 par les ONG, dans le cadre de la campagne pour les présidentielles. Mais cet événement aura largement contribué à lever le voile sur les dérives sociales et environnementales de certains donneurs d'ordres transnationaux et de révéler les failles juridiques dans ce domaine. « La prise de conscience politique aura donc accéléré l'action règlementaire, avec l'objectif que ceci ne se reproduise pas », observe Adrien Fourmon, avocat associé au sein du cabinet Jeantet.
Des lacunes dans le texte
Fruit d'un compromis assumé par ses initiateurs, après cinq ans de débats parlementaires marqués par une forte pression des lobbies, le texte adopté ne fait pas l'unanimité. Beaucoup lui reprochent, par exemple, ce seuil de 5 000 salariés qui laisse passer entre ses mailles des entreprises comme le pétrolier Perenco, accusé de préjudices écologiques en République démocratique du Congo par Sherpa et les Amis de la Terre France. L'accès à la justice des personnes ou des communautés affectées par des violations de leurs droits s'avère également assez difficile, qu'il s'agisse d'une demande de réparation après le dommage ou d'une demande d'action concrète de prévention auprès des entreprises. Un exercice encore plus compliqué.
La fin de l'impunité pour les grands groupes
Les témoins faisant l'objet de harcèlement ou de menaces dans certains pays, comme en Tanzanie ou en Ouganda, le recueil de témoignages directs reste difficile, voire impossible. Enfin, aucun contrôle du plan de prévention des multinationales visées n'est effectué à ce jour par les services de l'État. Se reposant sur la perspicacité des ONG, l'administration ne joue pas son rôle, regrettent ainsi les observateurs. Mais, de l'avis de tous, la loi aura eu le mérite de faire reconnaître la responsabilité des sociétés mères et des donneurs d'ordres sur les activités de leurs filiales partout dans le monde. « Elle signe le début de la fin de l'impunité en termes de sécurité, de santé ou de dégradation de l'environnement », résume le député Dominique Potier, rapporteur de la proposition de loi française.
Autre point fort, elle couvre tous les types de violations : droits humains, libertés fondamentales, sécurité des personnes et environnement. « Un champ très large », approuve Juliette Renaud. En 2021, la loi Climat et résilience est par ailleurs venue apporter un complément au texte en permettant aux acheteurs publics de prendre en considération le respect de ce devoir de vigilance dans leurs appels d'offres. « Cette obligation de communication se transforme ainsi en obligation de rendre des comptes aux clients acheteurs », analyse maître Fourmon.
Un réel moyen de pression
Au fil des années, le texte s'est finalement révélé une arme efficace aux mains des ONG, des syndicats et de la société civile pour faire pression sur les groupes transnationaux. Même si, à ce jour, aucune condamnation n'a encore été prononcée, quinze actions en justice (1) sont déjà en cours, dont près de la moitié pour des atteintes à l'environnement ou au climat. « Nous ne pouvons pas préjuger de leur l'issue. Mais ces procès sont suffisamment impactants pour justifier d'actions sur le terrain juridique. Quand on connait l'enjeu du plastique pour Danone, par exemple, on saisit la force d'une assignation pour ne pas avoir pris la question assez au sérieux dans sa stratégie », souligne maître Fourmon.
Considéré comme un devoir effectif, nécessitant un minimum de crédibilité, la démarche ne peut en outre qu'influencer les opinions au sein des entreprises, donc rejaillir sur leurs politiques en interne. L'un des paris de la loi française était par ailleurs d'inspirer d'autres pays. C'est aujourd'hui chose faite pour l'Allemagne, la Norvège et les Pays-Bas qui ont déjà adopté un texte similaire. La Belgique s'apprête à le faire. La Finlande et la Suisse en débattent…
Passage à l'échelle européenne
Mais en se saisissant de la question, l'Union européenne devrait bientôt la faire changer considérablement d'échelle. Le 1er décembre dernier, avec quelques amendements, le Conseil des ministres de l'Industrie s'est prononcé sur un projet de directive, lui-même présenté en février 2022 par la Commission. Ce mardi 25 avril, la commission des affaires juridiques du Parlement devrait à son tour adopter la version proposée par les eurodéputés, plus progressive, avant un vote en plénière dans le courant du mois de mai. Les discussions se poursuivront ensuite en trilogue, jusqu'au vote final, prévu en fin d‘année ou au tout début de 2024. Les ambivalences des Européens
Des citoyens très favorables à une version ambitieuse de la future directive sur le devoir de vigilance de l'Union européenne : c'est ce que tend à montrer un sondage, commandé par des ONG, dont les Amis de la Terre France, CCFD Terre solidaire, Notre Affaire à tous et Sherpa, dans le cadre de leur campagne « Justice is everybody's business », réalisé dans dix pays de l'UE. Les trois quarts des sondés (74 %) souhaiteraient une législation contraignant toutes les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour les deux tiers (64 %), les banques devraient être tenues pour responsables des actions des entreprises qu'elles financent.
Dix ans après le drame du Rana Plaza, l'ultra fast-fashion a succédé à la fast fashion et les ouvrières du textile travaillent toujours dans des conditions indignes, rappellent par ailleurs ActionAid France et Les Amis de la Terre France. Tandis que certains pays d'Afrique étouffent sous les fumées des déchets textiles, 3 milliards de vêtements sont mis sur le marché chaque année, en France, soit 44 par habitant. Près de dix fois plus que les trajectoires recommandées pour respecter l'Accord de Paris.
De nombreux points sont encore en débat et certains observateurs se préoccupent de ce qu'ils considèrent comme des risques de dénaturation : le degré d'harmonisation entre les États membres qui pourrait s'avérer minimal, la suppression du renversement de la charge de la preuve, initialement proposée en faveur des plaignants par le Parlement, l'exclusion du secteur bancaire du spectre des entreprises visées, des exemptions de certains sous-traitants… « Le combat est loin d'être terminé : un fossé persiste entre les trois textes et les lobbies n'ont pas baissé la garde », constate Dominique Potier, aujourd'hui mobilisé auprès des eurodéputés pour défendre sa vision d'une directive ambitieuse. « Les grands principes de la loi française devraient en effet être repris et même bonifiés dans le texte du Parlement, mais ce n'est pas le cas de ceux de la Commission et du Conseil des chefs d'État. »
Un premier cadre pour commencer
Maître Fourmon, pour sa part, ne partage pas ces inquiétudes. « C'est bien de disposer d'un cadre, estime-t-il. Il aura pour effet d'intégrer la directive dans toutes les politiques européennes et de faire progresser le sujet, en laissant une certaine liberté aux États membres pour la transposer dans leur règlementation nationale. Il va falloir leur laisser un peu de temps pour la mettre en œuvre. » Les sanctions éventuelles décidées en France pourraient en outre faire jurisprudence à l'étranger. « Les juges nationaux regardent ce que font leurs homologues », explique maître Fourmon.
Le nouveau texte s'intègrera par ailleurs dans un corpus d'autres règlementations européennes, comme la directive CSRD relative au reporting sur la durabilité, celle contre la déforestation et celle contre le travail des enfants. Toutes destinées à limiter de possibles dérives. « Si elles étaient coordonnées et prises en compte dans les traités bilatéraux ou multilatéraux signés par l'Europe, on passerait alors du libre-échange au juste-échange », imagine Dominique Potier. Pour ce dernier, qui encourage les citoyens, syndicats, intellectuels et ONG à prendre la parole à l'occasion du dixième anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza, on ne peut pas « brader » l'espérance née de la loi sur le devoir de vigilance. « Elle doit être précisée et accomplie à travers la directive européenne, insiste-t-il. Que la société civile organisée, en lien avec les parlementaires, ait fait bouger l'exécutif en 2017, en France, cela dit quelque chose de puissant. Surtout en cette période de basses eaux en matière de confiance dans les institutions. Il ne faut jamais désespérer de la politique. »