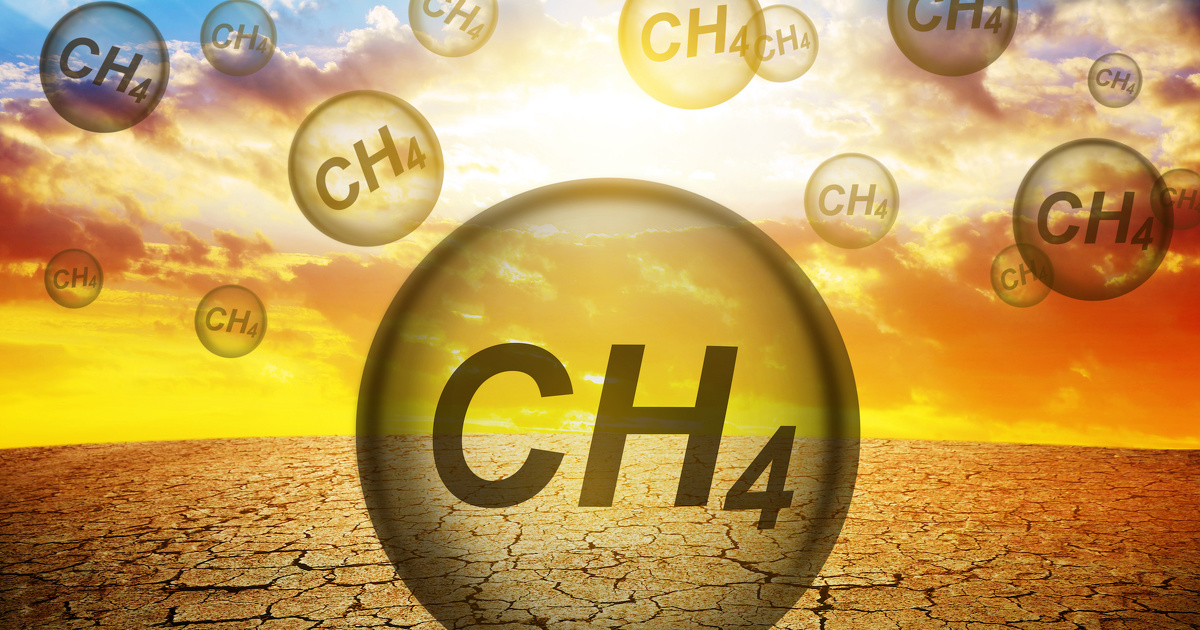Une équipe de chercheurs américains, chinois, norvégiens et français a résolu un récent mystère particulièrement inquiétant pour le climat. Pour autant, une partie de la réponse n'est pas rassurante.
En 2020, la première année de la pandémie de Covid-19 a interrompu, avec son lot de confinements, la plupart des activités humaines à travers le monde, y compris toutes celles liées aux transports gourmands en combustibles fossiles. Pourtant, ce qui aurait pu constituer une aubaine accidentelle pour le climat n'en a pas exactement été une. En un an, la concentration moyenne du méthane (CH4), l'un des gaz à effet de serre au potentiel de réchauffement climatique les plus élevé, a bondi de 15,1 parties par milliard (ppb), soit une augmentation d'environ 50 %. Il s'agissait alors de la plus forte hausse annuelle observée par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) depuis le début de ses mesures atmosphériques en 1984. D'après l'étude publiée le 14 décembre (1) dans la célèbre revue scientifique Nature, deux raisons sont à l'origine de ce phénomène : la première est naturelle et constitue l'une des conséquences directes du réchauffement climatique, mais l'autre est anthropique et rentre même en conflit avec l'amélioration de la qualité de l'air.
Premier coupable : la « transpiration » des zones humides
Selon les modèles et simulations statistiques réalisés par les chercheurs, notamment du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE (2) ), une première moitié (environ 47 %) de ce bond de méthane dans l'atmosphère se justifie par une modification des conditions météorologiques dans les zones humides dans les hautes latitudes nord et autour du tropique du Cancer. En 2020, une hausse globale de l'humidité et de la température a entraîné l'émission naturelle d'une plus grande quantité de méthane contenue dans les marais et autres tourbières de l'hémisphère nord – six millions de tonnes de plus en un an, plus exactement. Directement liée au réchauffement climatique, « cette augmentation des émissions de méthane dans les régions contenant des zones humides tropicales et septentrionales où les précipitations devraient augmenter à l'avenir pourrait amplifier le réchauffement climatique » dans une sorte de cercle vicieux, signalent par ailleurs les chercheurs.
Second coupable : l'amélioration de la qualité de l'air
Paradoxalement, l'amélioration de la qualité de l'air pourrait donc passer par une accumulation de gaz à effet de serre. L'essentiel, selon les chercheurs, est avant tout d'attaquer le problème du méthane à la racine. « Les efforts réalisés dans le cadre de l'Accord de Paris pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles, ainsi que l'adoption de mesures de réduction de la pollution de l'air diminueront probablement les émissions de NOx à l'avenir, en déduisent les scientifiques. Au vu de ce qui a été observé en 2020, la réduction des NOx pourrait à son tour accélérer la hausse de la concentration de méthane. Nous devrons donc adopter des mesures d'atténuation encore plus contraignantes sur le méthane. » Pour rappel, lors de la COP 26 en novembre 2021, plus de 100 pays se sont engagés à réduire d'au moins 30 % les émissions mondiales de méthane d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2020.