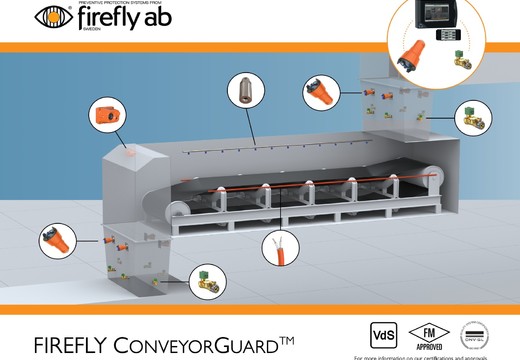Les délégués réunis à Paris depuis lundi n'ont toujours pas commencé à élaborer le futur traité sur la pollution plastique. Pour l'instant, les négociations sont à l'arrêt tant que n'est pas adopté le règlement intérieur du Comité intergouvernemental de négociation (CIN). En jeu : la règle d'adoption des dispositions du futur texte. Faute d'accord, une partie des négociateurs refuse d'engager les discussions sur le fond. À leur tête : l'Arabie saoudite, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie.
« On était prêts à discuter de procédure », assure Gustavo Meza-Cuadra Velázquez, le président péruvien du CIN. Mais peut-être pas à ce point. De l'avis de plusieurs observateurs, une telle situation est très rare. Si les débats procéduraux sont habituels lors des négociations internationales, il est tout aussi habituel qu'ils soient rapidement réglés (au moins provisoirement). Des échanges informels doivent se tenir en vue d'obtenir un accord mercredi. Mais, pour l'instant, les discussions sont très tendues.
Adoption provisoire
En novembre dernier, le premier round à Punta del Este (Uruguay) s'était achevé par l'adoption provisoire d'un projet de règles de négociation. Officiellement, seules les modalités de vote de l'Union européenne (UE) restaient en suspens. Concrètement, l'enjeu du débat portait sur le nombre exact de voix comptabilisées lorsque l'UE vote pour ses États membres. La proposition la plus favorable à l'UE en comptabilise automatiquement 27 et les variantes en limitent le nombre aux États prenant effectivement part aux travaux et/ou accrédités et présents à la réunion.
Le sujet pourrait avoir son importance en cas de vote, puisque certains États membres ne participent pas aux négociations (l'UE portant une position commune) ou ne sont pas systématiquement présents lors du vote. Et avec 27 voix, l'UE totalise 15 % des votes (175 États négocient). En outre, elle compte parmi les négociateurs affichant une grande ambition environnementale dans la lutte contre la pollution plastique.
Vote en dernier recours
Mais depuis deux jours, un groupe d'États conteste le principe même d'un vote, pourtant validé à Punta del Este. Le projet de règlement (1) prévoit qu'« aucun effort [ne soit ménagé] » pour parvenir à un consensus sur les questions de fond. Mais si un consensus n'est pas trouvé, le projet permet de trancher à une majorité de deux tiers. Ce vote ne doit intervenir qu'« en dernier recours », précise le texte.
« Cette procédure, qui associe consensus et vote en dernier recours, est habituelle dans les négociations internationales », explique David Azoulay. Le directeur du programme santé environnementale du Center for International Environmental Law (Ciel) précise qu'elle a été appliquée pour plusieurs textes, notamment la Convention de Minamata sur le mercure (dont le projet de règlement s'inspire directement).
Dans les faits, le vote est exceptionnel, le but étant surtout d'encourager chacun à négocier. En termes onusiens, le consensus signifie qu'une décision est adoptée sans objection formelle. Chaque pays dispose donc d'un véto. Mais avec un vote en dernier recours, il est difficile de s'arcbouter sur une position trop minoritaire. De nombreux pays ont d'ailleurs rappelé en plénière que la procédure est censée convaincre chacun de négocier réellement pour, justement, aboutir à un consensus. Surtout qu'un État insatisfait peut toujours refuser d'adhérer à un traité.
La Russie perd la bataille du bureau
Traditionnellement, la nomination du bureau est rapide. Mais les 23 pays d'Europe de l'Est ne sont pas parvenus à s'entendre sur leurs candidats, Ukraine et Russie voulant chacun un mandat. Finalement, l'Ukraine s'est retirée et a laissé la voie libre à la Géorgie (qui la remplace) et à l'Estonie. Mais la Russie a maintenu sa candidature. Il a donc fallu un vote à bulletin secret pour les départager : la Géorgie a été élue avec 111 voix (sur 159 votes, dont un nul et 17 abstentions) ainsi que l'Estonie avec 104 voix. La Russie n'a eu l'appui que de 51 États.
Parallèlement, la Russie a contesté, « par principe de réciprocité », les candidatures de la Suède et des États-Unis (au titre du groupe Europe de l'Ouest et autres). Il a donc fallu, là aussi, organiser un vote. Les deux candidats ont obtenu les deux sièges en jeu : la Suède a recueilli 119 voix et les États-Unis 116 (sur 149 votes exprimés, dont 21 abstentions).
Mais, en ouverture de la réunion parisienne, le président a décidé de recourir à un vote. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les délégués devaient désigner le bureau du CIN. Sur ce sujet, l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a pas permis d'aboutir au consensus (lire l'encadré). Dans les couloirs, certains jugeaient la manœuvre habile, car elle permettait de former rapidement l'équipe chargée de piloter les négociations. Mais cette décision a aussi donné l'opportunité à une quinzaine d'États de dire tout le mal qu'ils pensent de cette façon de faire.
Le vote constitue « un abus » (le terme a été repris à plusieurs reprises), ont-ils fait valoir, insistant pour que cela reste strictement exceptionnel. De fil en aiguille, ces pays, menés par l'Arabie saoudite, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, ont expliqué « qu'il n'est pas possible de négocier » si la règle du vote en dernier recours n'est pas rediscutée. Et depuis deux jours, ils rejettent chaque tentative d'avancer. De fait, les groupes de négociation consacrés au contenu du futur accord n'ont toujours pas débuté leurs travaux.
Stratégie dilatoire
« Il s'agit d'une stratégie dilatoire », estime le représentant du Ciel, qui juge qu'il s'agit de retarder les débats sur le fond et de créer un précédent en remettant en cause un point déjà adopté. Ces États craignent « l'élan croissant des opinions publiques qui appellent à réduire la production et la consommation de plastique ». Retarder les travaux, c'est surtout empêcher les pays les plus volontaires d'avancer.
C'est aussi ce qu'ont mis en avant les nombreux États qui s'opposent à la position de l'Arabie saoudite et consorts. « Ceux qui ne veulent pas avancer [sans revoir les règles de procédure] sont ceux qui ne veulent pas de prise de décision [sur le traité] », a déploré le Sénégal, estimant que « le consensus tue la démocratie : si un ou deux pays ne sont pas d'accord, nous sommes bloqués ». Une position partagée par l'UE, le Royaume-Uni, la Norvège, l'essentiel des pays africains, le Canada ou encore les États-Unis.
Nœud gordien
Comment sortir de cette situation ? En recourant à un nouveau vote ? La Micronésie et le Sénégal l'ont suggéré. « La question est délicate », a euphémisé le président du CIN qui, pour l'instant n'a pas donné suite. Surtout, la Chine a clairement dit que, pour elle, dorénavant, recourir à un nouveau vote « n'est pas légal ». Et si la règle du vote en dernier recours devait être adoptée, « de nombreux États hésiteront à négocier activement ».
Une autre solution serait d'accepter de renégocier la question du vote en dernier recours. Mais cela créerait un précédent qui permettrait de rediscuter perpétuellement chaque avancée. Surtout, compte tenu de la rudesse des échanges et de l'écart entre les positions, un accord paraît très incertain. Mettre entre crochet le recours au vote reviendrait, de fait, à abandonner cette option et à accepter de mener les négociations à venir au consensus strict.