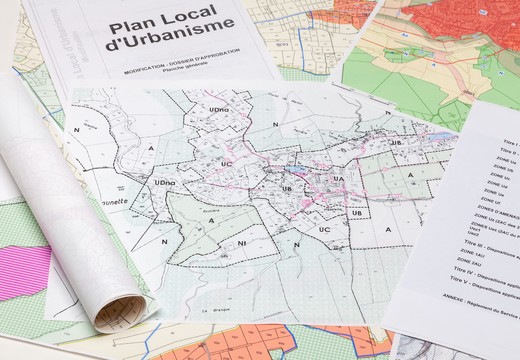Le Conseil constitutionnel a décidé de faire un point sur le droit constitutionnel de l'environnement qu'il voit se constituer à travers les sept décisions qu'il a rendues sur la Charte de l'environnement (1) depuis 2005.
Sept décisions fondées sur la Charte depuis 2005
Bien que fondées sur la charte, les deux premières de ces décisions ont été rendues dans des matières assez éloignées du droit de l'environnement : organisation du référendum sur le projet de loi autorisant la ratification de traité établissant une Constitution pour l'Europe et création du registre international français.
Ce n'est pas le cas des cinq autres à travers lesquelles les sages de la rue Montpensier ont examiné la conformité à la Charte de l'environnement de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (2) , de la loi relative aux OGM (3) , de la création de la taxe carbone (4) par la loi de finances pour 2010, de dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives au régime de responsabilité en matière de nuisances industrielles (5) et, enfin, de dispositions du Code de l'environnement relatives aux installations classées (6) .
Possibilité de contrôler les lois a posteriori
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
La QPC donne le droit à toute personne qui est partie à un procès de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative contestée.
La QPC a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
Ce qui ne l'empêche pas de procéder à "une analyse article par article" de la portée juridique des droits et obligations définis dans la Charte. À ce jour, sur ses dix articles, seuls les sept premiers ont été invoqués devant sa juridiction. "En outre, seuls les articles 1er à 4 ainsi que l'article 7 ont été invoqués dans cadre du contrôle a posteriori", précise le Conseil. C'est-à-dire dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Le Conseil a reconnu que ces articles figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit au sens de son article 61-1 et qu'ils peuvent, à ce titre, être invoqués à l'appui d'une telle question.
Caractère impératif des articles de la Charte
Le Conseil constitutionnel tire deux enseignements de sa jurisprudence. Tout d'abord, il a "refusé de considérer que les énoncés les plus généraux figurant dans la Charte de l'environnement sont purement incantatoires et dépourvus de force impérative". "Fidèle à la lettre des articles de la Charte et à leur formulation impérative", il considère avoir "cherché à identifier la portée normative précise de ces énoncés généraux".
Deux décisions illustrent cette position selon lui. Lorsqu'il a examiné la conformité au principe d'égalité devant la loi fiscale et les charges publiques des dispositions instaurant la taxe carbone, le Conseil a pris en compte le fait que les devoirs énoncés par les articles 2, 3 et 4 de la Charte s'imposaient à "toute personne". "Cela a conduit à un renforcement du contrôle des exemptions à cette contribution dont l'objet était de taxer des activités polluantes", explique-t-il.
Deuxième illustration : dans sa décision du 8 avril 2011 sur les nuisances industrielles, le Conseil a estimé que "le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux" par les articles 1er et 2 de la Charte implique que "chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité ".
Renforcement de la compétence du législateur
Deuxième enseignement : le Conseil constitutionnel a confirmé "le renforcement de la compétence du législateur dans la mise en œuvre des principes qui assurent le respect de la Charte de l'environnement".
Ce renforcement résulte des articles de la Charte qui précisent que les droits et devoirs énoncés trouvent à s'appliquer "dans les conditions définies par la loi". Cela s'applique au devoir de prévention prévu par l'article 3, au devoir de contribuer à la réparation des dommages prévu par l'article 4, ainsi qu'au droit d'accès à l'information et au principe de participation du public prévus par l'article 7.
La compétence du législateur porte également sur la mise en œuvre des exigences prévues par les articles 5 (principe de précaution) et 6 (développement durable) de la Charte. Le Conseil estime ainsi qu'il lui incombe "de s'assurer que le législateur n'a pas méconnu le principe de précaution et a pris des mesures propres à garantir son respect par les autres autorités publiques".
Quant à la nature du contrôle exercé, le Conseil procède à "un contrôle relativement strict du respect, par le législateur, de la compétence que lui assigne le constituant en matière de droit de l'environnement". "Les deux seules censures de dispositions législatives au regard des exigences de la Charte de l'environnement sont fondées sur des cas d'incompétence négative", précise-t-il.
En revanche, il procède à un contrôle plus restreint de la conformité des dispositions législatives au regard "des exigences matérielles de la Charte de l'environnement". "La définition des orientations de la législation environnementale procède en effet de choix politiques" pour lesquels le Conseil n'a pas à "substituer son appréciation à celle de la représentation nationale".