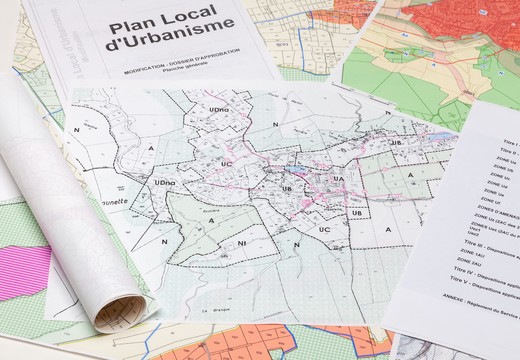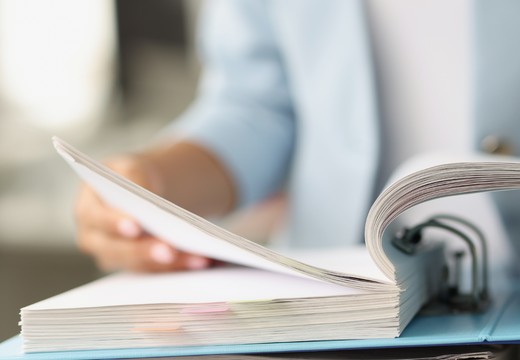Emmanuel Macron a fait part le 4 mars de sa volonté d'inscrire la lutte contre les changements climatiques dans la Constitution, norme juridique suprême qui s'impose à la loi. Tous ceux qui oeuvrent à la prise en compte des bouleversements climatiques dans l'ordre juridique se réjouissent de cette intention, mais de nombreux juristes, associations et parlementaires restent sur leur faim du fait des modalités actuellement envisagées pour cette inscription. Il en débattaient ce jeudi 8 mars lors du colloque "La Constitution face au changement climatique" organisé à l'Assemblée nationale.
"L'enjeu climatique est celui de l'habitabilité de la terre", rappelle Dominique Bourg, professeur à l'Université de Lausanne. Or, dans un déni de réalité, le droit actuel fait passer la protection de l'environnement après les droits économiques comme la liberté du commerce. Résultat, explique le président du conseil scientifique de la Fédération pour la nature et l'homme (FNH), tout l'édifice va s'effondrer si cette prise en compte n'est pas assurée. L'inscription du droit à la vie sur terre apparaît donc comme un préalable pour permettre aux autres droits de s'exprimer.
Pour l'ancienne ministre de l'Environnement Delphine Batho, cette révision constitutionnelle est l'occasion d'accomplir un progrès, comme a pu l'être l'adoption de la Charte de l'environnement en 2005, en vue d'aller vers la République écologique qu'elle appelle de ses voeux. La députée socialiste illustre les limites actuelles du travail du législateur avec l'exemple de la loi interdisant la production d'hydrocarbures d'ici 2040. "Nous aurions voulu mettre des dates plus proches mais nous nous sommes heurtés à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété garantis par la Constitution", explique Mme Batho.
"Inutile, voire contreproductif"
Mais si la plupart des acteurs se félicitent de l'ouverture d'un débat sur la place du changement climatique dans la Constitution, nombre d'entre eux sont très critiques sur la voie actuellement envisagée par l'exécutif. Ce dernier a en effet indiqué qu'il envisageait de passer par l'article 34 de la Constitution. "Inutile, voire contreproductif", cingle l'avocat Arnaud Gossement.
En effet, cet article, qui a pour objet de délimiter le champ de la loi, prévoit déjà qu'elle détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. En outre, selon l'avocat, il n'est pas dit que le Conseil constitutionnel fasse bon usage d'un objectif constitutionnel de lutte contre le changement climatique. Et de rappeler la décision des sages de décembre 2000 qui avaient censuré (1) la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l'électricité et les produits énergétiques fossiles comme contraire au principe d'égalité devant l'impôt au motif que la consommation d'électricité d'origine nucléaire permettait de lutter contre l'effet de serre.
Une solution alternative réside dans une modification de la Charte de l'environnement. Mais certains craignent, à l'image du député LReM Matthieu Orphelin, qu'en lançant le débat sur la Charte, on ouvre la boîte de pandore. "Il faut s'attendre à une offensive sur le principe de précaution", admet Delphine Batho, qui estime toutefois nécessaire de mettre la charte dans la discussion en vue de la compléter.
"En finir avec la dissociation des enjeux écologiques"
Au final, les associations et juristes spécialisés s'accordent plutôt sur une modification de l'article premier de la Constitution, dont le poids juridique serait sans commune mesure. Mais, même à ce niveau, l'ambition peut varier grandement selon la rédaction retenue. "En tout état de cause, il ne faut pas inscrire le climat seul dans la Constitution", plaide Dominique Bourg, qui rappelle les interactions entre climat et biodiversité. "C'est une opportunité pour en finir avec la dissociation des enjeux écologiques", s'accorde Delphine Batho, qui propose de travailler sur la notion de biens communs environnementaux.
Cette dernière plaide avec d'autres pour l'inscription de verrous supplémentaires. "Il faut renforcer le principe de solidarité inter-générationnel et constitutionnaliser le principe de non-régression", estime Marie Toussaint, présidente de l'ONG Notre Affaire à tous. Mais aussi insérer la question des limites planétaires afin de prendre en compte l'entrée dans l'anthropocène, ajoute Dominique Bourg.
Reste maintenant à voir si l'exécutif sera à l'écoute de ces analyses ou s'il maintient sa proposition a minima. La réponse sera contenue dans le projet de loi qu'il va transmettre dans les jours qui viennent au Conseil d'Etat.
L'enjeu n'est autre que "d'ajuster le droit à la réalité", résume Dominique Bourg.