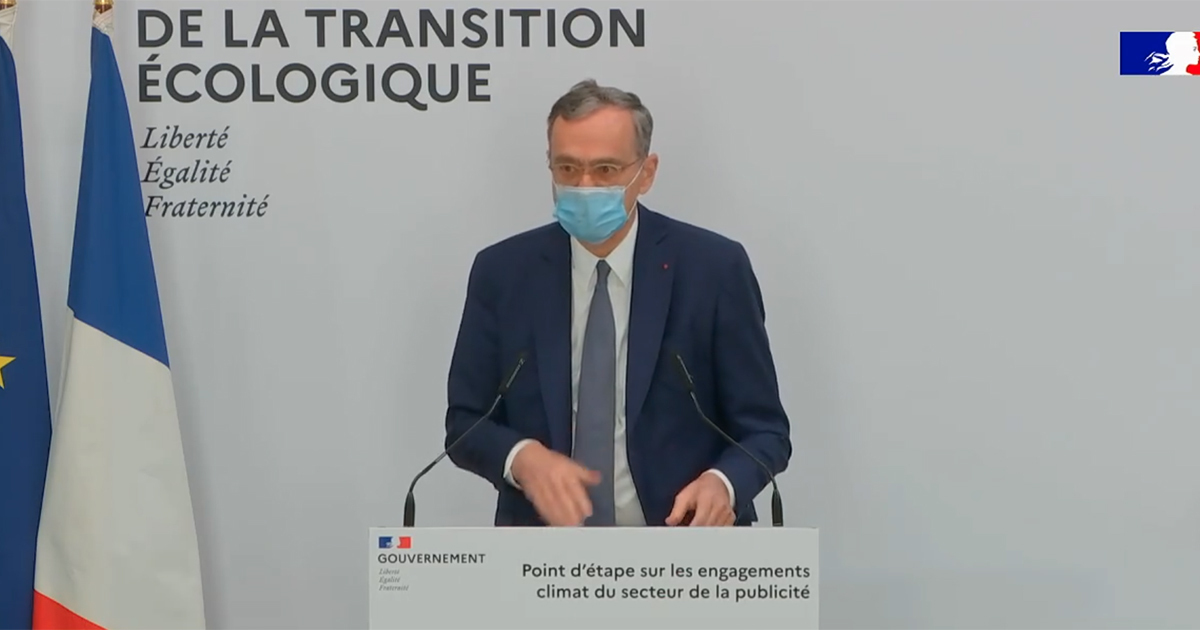Dans la ligne de mire de la convention citoyenne pour le climat et du projet de loi qui en découle, les publicités pour des comportements ou des produits défavorables à l'environnement vont-elles disparaître ? Rien n'est moins sûr. Les professionnels du secteur ont réussi à convaincre ministres et parlementaires de ne pas passer par l'obligation mais de laisser le secteur se réguler lui-même comme il le fait depuis plusieurs décennies. La notion de « contrat pour le climat » a fait son apparition. Et pour donner des gages, le monde de la publicité a présenté mardi 23 mars, les nouveaux engagements qu'il prend pour participer à la transition écologique. Des engagements fortement inspirés par les travaux de la mission confiée à Arnaud Leroy, président de l'Ademe et Agathe Bousquet, présidente du groupe Publicis France.
Mieux connaître l'empreinte environnementale du secteur
« Nous sommes à un moment particulier, et il y a une volonté collective de vouloir avancer sur des engagements mesurables et transparents, se félicite Agathe Bousquet, après plusieurs semaines d'audition. Les acteurs sont nombreux, différents et interdépendants. Les engagements des uns vont avoir des impacts sur les autres. Le choix des engagements volontaires est donc la bonne démarche », estime-t-elle.
Pour cadrer les discussions, la mission a identifié 5 axes de réflexion dont le premier : s'inscrire sur le long terme dans une trajectoire. « Il faut tout d'abord réaliser un bilan carbone de la filière pour ensuite partager l'effort et définir des trajectoires avec des jalons à 2025 puis 2030. Tout ça manque encore de chiffres, il faut commencer par documenter », explique Arnaud Leroy qui propose l'appui de l'Ademe sur ce sujet.
Dans cette optique, le président du CSA Roch-Olivier Mestre, a annoncé le lancement d'une étude sur l'empreinte environnementale du secteur audiovisuel. Le CSA se positionne en « facilitateur du dialogue » entre des « acteurs qui n'ont parfois pas les mêmes intérêts ».
Axer les engagements sur ce que les acteurs produisent
Deuxième axe : le type d'engagement. Les deux missionnés conseillent aux acteurs de s'engager sur ce qu'ils produisent en garantissant des procédés industriels plus respectueux afin d'accélérer la réalité des engagements. Le syndicat de la presse magazine (SEPM) a, sur ce point, annoncé qu'il travaillait sur un éco-simulateur de l'impact carbone des publications, et à un calculateur spécifique à la création des pubs.
Sur le fond des messages publicitaires, la mission constate que les acteurs tiennent à leur liberté éditoriale alors elle préconise seulement d'élargir à d'autres thématiques écologiques le principe de l'éco-contribution en nature. Pour éviter de payer une éco-contribution pour le recyclage, la presse est autorisée à la transformer en campagne de communication. Pour l'instant réservé au recyclage, ce principe pourrait être élargi à d'autres messages.
L'ensemble des medias audiovisuels et leurs régies se sont quant à eux engagés à accentuer la place de la transition écologique dans leurs programmes et favoriser les campagnes publicitaires des institutionnels et du gouvernement sur les messages écologiques. Pour aller plus loin, la presse magazine prévoit l'organisation d'une convention des rédactions sur le climat en juin 2021.
D'autres acteurs se positionnent toutefois sur des engagements climat. C'est le cas de l'Union de la publicité extérieure qui travaille sur des trajectoires de réduction de ses émissions de CO2 avec des jalons de -20 % en 2025 et - 48% en 2030 par rapport à l'année de référence 2019, « dans le respect des trajectoires de la SNBC », explique son président Stéphane Dottelonde.
L'évaluation et la vérification, le point faible
Et les annonceurs dans tout ça ?
« On est allé voir les annonceurs, on a élargi le périmètre de la mission », a précisé Arnaud Leroy. Deux fédérations industrielles ont elles aussi annoncé des engagements, à l'image de l'Ania qui va désormais ne plus acheter de créneaux publicitaires dans les programmes jeunesse. La filière automobile française s'est engagée à consacrer 50 % de ses investissements publicitaires en faveur de la promotion des véhicules électriques, hybrides rechargeables et hybrides en 2021, 60 % en 2022 et 70 % en 2023. Mais rien ne garantit que la publicité pour les autres véhicules va se réduire.
De nouveaux chiffres du WWF illustrent la prédominance des SUV par exemple dans la publicité. Selon l'association, l'ensemble des dépenses de publicité et de communication du secteur automobile s'élevaient à 4,3 milliards d'euros en 2019 dont 42 % pour les modèles SUV.
Il en est de même pour l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (Arpp) chargée de vérifier l'éthique des publicités mais qui n'a pas fait ses preuves aux yeux des associations de protection de l'environnement qui l'ont quittée il y a plusieurs mois. Avec le débat relancé aujourd'hui l'Arpp s'engage à réformer sa gouvernance et à l'ouvrir à des personnalités représentant les consommateurs et l'environnement. « Nous prenons 5 engagements aujourd'hui en matière de gouvernance notamment, mais aussi une amélioration du fonctionnement du jury de déontologie publicitaire, un renforcement des contrôles des allégations environnementales et la mise en place de forums d'échange avec des experts non représentés dans nos instances », promet François d'Aubert, son président. L'Arpp travaille sur 6 engagements supplémentaires et 10 indicateurs permettant de les auditer et de juger de leur effectivité en lien avec le CSA.
Mais la question de la vérification et du suivi des engagements est encore loin d'être réglée. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé la prolongation de la mission confiée à Arnaud Leroy et à Agathe Bousquet pour mobiliser d'autres acteurs et pour introduire des modalités d'évaluation et de contrôle dans les codes de bonne conduite qui seront conclus. « Il reste du chemin mais avec d'un côté les apports de la loi Climat et Résilience et de l'autre l'implication des acteurs, nous allons pouvoir répondre à des enjeux qui concernent la publicité dans tous ses supports et toutes ses spécificités. Pour ce faire, il faut comme aujourd'hui se donner des objectifs chiffrés, les formaliser et dorénavant les mesurer régulièrement », a déclaré Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable.