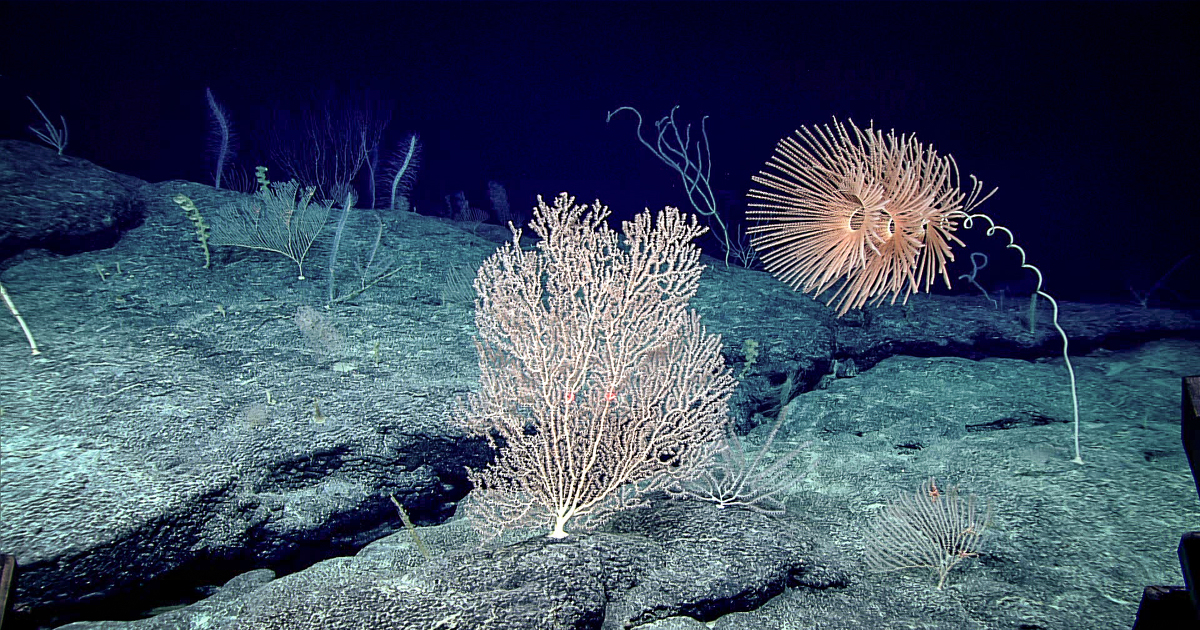L'Union européenne (UE) et ses États membres sont à la croisée des chemins : ils peuvent encore décider de sortir de la course à l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins, estime la Deep Sea Conservation Coalition. Cette coalition internationale s'appuie sur un rapport (1) présenté début mai (auquel ont participé France Nature Environnement (FNE) et le WWF France) qui met en lumière le rôle des pays européens dans l'exploration de « cette dernière frontière minière ». Sur la base de l'analyse de leur politique en matière d'exploitation minière en eau profonde, le document propose des stratégies alternatives. « L'UE doit montrer l'exemple, en interdisant l'exploitation minière dans ses eaux territoriales et en faisant pression pour un moratoire mondial sur les eaux internationales », estiment les ONG.
Actuellement, plusieurs zones ont été ouvertes à l'exploration minière en haute mer dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique. Certains pays européens figurent parmi les acteurs majeurs de cette exploration. C'est le cas de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique, de la Pologne, de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie qui parrainent ou détiennent des permis d'exploration. Quant à l'Espagne, au Portugal et à la Norvège, ils ont manifesté leur intérêt pour l'exploration de gisements minéraux sur leur plateau continental. Tous ces pays jouent aussi un rôle actif dans la gouvernance, notamment par le biais de l'Autorité internationale des fonds marins (IAS, pour International Seabed Authority) de l'ONU.
L'Ifremer, le fer de lance de l'engagement français
S'agissant de la France, l'intérêt pour les fonds marins a débuté avec des travaux exploratoires menés dans les années 1980 à Wallis et Futuna, en Polynésie française. La France participe actuellement, par le biais de l'Ifremer, à un projet de recherche de nodules polymétalliques (depuis 2001) et de dépôts d'amas sulfurés (depuis 2014) dans la zone Clarion-Clipperton. Située dans le Pacifique, entre Hawaï et le Mexique, cette zone couvre une superficie totale de plus d'un million de km2 et a fait l'objet de 30 permis d'exploration depuis 1984.
Cet intérêt « est motivé par des considérations géopolitiques et est lié aux revendications sur un plateau continental étendu », explique le rapport qui déplore « le poids et l'influence injustifiée qu'ont en France les experts de l'Ifremer favorables à l'exploitation minière ». Ces experts sont engagés dans les travaux de l'ISA et dans les projets de plateau continental étendu, signalent les ONG. Le rapport liste aussi les divers engagements politiques et les législations françaises qui soutiennent l'exploitation des gisements sous-marins. Dernier en date : la nouvelle version de la stratégie nationale (2) relative à l'exploration et à l'exploitation minières des grands fonds marins, validée en janvier 2021 par le Comité interministériel de la mer (CIMer). Elle prévoit le lancement de campagnes océanographiques dans la zone économique exclusive (ZEE) française d'ici 18 mois (en partenariat avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) et le développement d'un démonstrateur pour tester les opérations.
La Commission européenne est plus attentiste
Pour autant, rien n'est encore réellement engagé puisque aucune exploitation n'a débuté. Les ONG estiment que 2021 sera une année charnière : les négociations, sous l'égide de l'ISA, relatives à la future réglementation internationale encadrant l'exploitation de ces ressources devraient progresser. « Cela permettrait le démarrage de l'extraction commerciale des minéraux des eaux profondes d'ici quelques années », explique le rapport. Deux acteurs sont dans les starting blocks : la société belge Global Sea Mineral Resources, qui mène les tous premiers tests d'équipements dans la zone Clarion-Clipperton, et la Norvège, qui envisage de délivrer des licences d'exploration sur son plateau continental à partir de 2023.
C'est dans ce contexte que l'UE pourrait jouer un grand rôle, selon les ONG qui militent pour que les acteurs européens renoncent à ces ressources. Plusieurs éléments plaident en ce sens. Tout d'abord, les prises de position des scientifiques en faveur d'un moratoire se multiplient. Parallèlement, la stratégie européenne pour la biodiversité adoptée en 2020 défend implicitement pour un moratoire, après que le Parlement a officiellement pris position en ce sens en 2018.
Conséquence : « la Commission ralentit le rythme ». Elle vient d'adopter, le 17 mai, une nouvelle stratégie « Économie bleue durable (3) » qui prend la suite de la « Croissance bleue » de 2012. Il y a près de dix ans, l'exploitation des grands fonds figurait parmi les cinq priorités. Aujourd'hui, la nouvelle stratégie prévoit que, dans le cadre des négociations internationales, l'UE défende une exploitation sous conditions des ressources minérales des fonds marins de la zone internationale. Cette exploitation ne serait entreprise qu'après que des « recherches suffisantes » aient été réalisées concernant les effets sur le milieu marin, la biodiversité et les activités humaines. De même l'UE propose d'attendre « que les risques [soient] correctement évalués et qu'il [soit] établi que les technologies et les pratiques opérationnelles envisagées ne portent pas gravement atteinte à l'environnement ».
Effets indécis du Green Deal européen
En l'occurrence, la Commission européenne semble tiraillée entre deux positions opposées. Bien sûr, le Green Deal plaide pour une plus grande protection de la biodiversité et donc pour que l'exploitation des grands fonds ne soit plus une priorité européenne.
Mais il fixe aussi des objectifs de décarbonation et de digitalisation de l'économie qui pourraient engendrer un boom minier. L'UE fait d'ailleurs de la sécurité d'approvisionnement en matières premières une priorité. La stratégie européenne correspondante ne mentionne pas les fonds marins, mais prend acte de « l'énorme appétit européen pour les ressources ». Elle encourage donc l'exploration « des nouvelles frontières et des méthodes minières innovantes », tout en admettant qu'un usage efficace des ressources, le réemploi et le recyclage permettent aussi de réduire les besoins européens…
Les ONG en appellent donc à l'Europe pour qu'elle mette en place dix mesures. Parmi celles-ci figure l'interdiction de l'exploitation minière sous-marine dans les eaux européennes et le plateau continental, à l'image de l'interdiction adoptée par le Territoire du Nord australien (une des six régions australiennes). Elles souhaitent aussi que l'UE défende ce type de mesure dans le cadre des négociations internationales. Autre attente importante : les ONG demandent la fixation d'objectifs contraignants de réduction de l'empreinte matière de l'UE pour 2030, 2040 et 2050, y compris pour les approvisionnements en mines et métaux. L'Europe pourrait enfin interdire l'emploi de minéraux issus des fonds marins, sur le modèle de l'interdiction des minéraux issus des conflits.