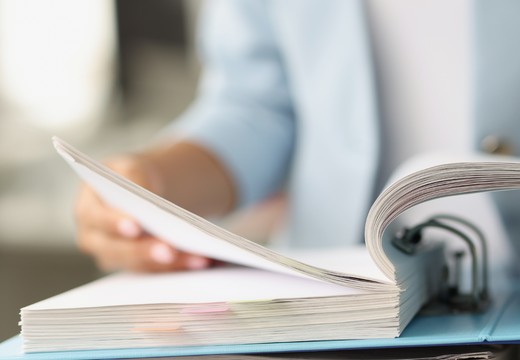La Commission européenne a publié le 6 mai, sous forme d'une communication, les lignes directrices relatives au contenu du rapport de base prévu par la directive IED. Ce rapport, qui définit l'état initial des sols et des eaux souterraines du site d'implantation des installations concernées, servira de référence lors de la cessation d'activité de l'installation pour définir les conditions de remise en état.
Ce document était attendu par le ministère de l'Ecologie et par les industriels concernés, c'est-à-dire les exploitants des installations potentiellement les plus polluantes. Tout d'abord, parce que la directive prévoyait elle-même ces lignes directrices. Ensuite parce que le ministère les attendait pour rédiger l'arrêté ministériel dédié à ce rapport et prévu par l'article R. 515-59 du code de l'environnement (1) . Enfin, parce que le guide méthodologique, rédigé par le BRGM et publié par le ministère en février dernier pour pallier précisément le retard de publication de ces lignes directrices, est susceptible aujourd'hui d'être revu en fonction de celles-ci. C'est la raison pour laquelle ces orientations, bien que par elles-mêmes non juridiquement contraignantes, revêtent une grande importance.
Processus en huit étapes
"Il est dans l'intérêt de l'exploitant de s'assurer que le niveau de contamination des sols et des eaux souterraines décrit dans le rapport de base est suffisamment précis, car cette information servira à déterminer le niveau de contamination supplémentaire dû à l'exploitation de l'installation concernée, par rapport au moment où le niveau de référence a été établi", prévient en préalable la Commission.
Pour établir le rapport, cette dernière prévoit un processus en huit étapes. Ces étapes, qui sont présentées chacune de façon détaillée, sont les suivantes :
- inventaire des substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées dans l'installation
- désignation des substances dangereuses pertinentes
- évaluation du risque de pollution lié au site
- historique du site
- description de l'environnement du site : topographie, géologie et hydrogéologie, hydrologie, voies de migration anthropiques, utilisation des terrains environnants et interdépendances
- caractérisation du site
- inspection du site : stratégie d'échantillonnage, incertitudes liées aux données concernant le sol et les eaux souterraines, analyse des échantillons
- production du rapport de base.
Ces étapes peuvent toutefois être réalisées dans un ordre différent ou simultanément, précise le document.
Les étapes 1 à 3 doivent permettre de déterminer si un rapport de base doit être établi, les étapes 4 à 7 comment il doit être établi, et l'étape 8 ce qu'il doit contenir. "Si, au cours des étapes 1 à 3, il est démontré, sur la base des informations disponibles, qu'un rapport de base n'est pas requis, il est inutile de passer aux étapes suivantes du processus", indique la Commission.
Dans la mesure du possible, précise cette dernière, il convient d'utiliser les informations disponibles pour exécuter les cinq premières étapes. Les informations fournies au titre de la directive "étude d'impact" peuvent se révéler utiles pour certains aspects du rapport de base, ajoute-t-elle. De même, les informations recueillies dans le cadre de la directive Seveso 3 ainsi que dans les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) peuvent présenter un intérêt pour l'établissement du rapport de base, indique le document. "Néanmoins, si cela n'est pas possible, il conviendra de recueillir de nouvelles informations", ajoutent les services de la Commission.
Bien interpréter la directive
La Commission précise comment doivent être interprétés les mots clés et expressions utilisés dans le texte de la directive, interprétation qui permet de définir le champ d'application du rapport de base.
L'article 22-2 de la directive est ainsi rédigé : "Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, l'exploitant établit et soumet à l'autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l'installation ou avant la première actualisation de l'autorisation délivrée à l'installation". Le document précise ainsi que l'expression "substances dangereuses pertinentes" désigne les substances ou les mélanges définis par le règlement CLP qui, "en raison leur dangerosité, de leur mobilité, de leur persistance et leur biodégradabilité (…), sont susceptibles de contaminer le sol ou les eaux souterraines, et qui sont utilisés, produits et/ou rejetés par l'installation".
Quant à l'expression "le risque de contamination du sols et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation", il convient de tenir compte, indique le document, de la quantité de substances dangereuses utilisée, produite ou rejetée, des caractéristiques du sol et des eaux souterraines sur le site, et des cas où toute contamination est impossible.
Le stockage des déchets également concerné
Un paragraphe spécifique du document concerne les décharges. La directive 1999/31/CE sur la mise en décharge des déchets prévoit que les exigences de la directive IPPC sont réputées satisfaites si la directive sur la mise en décharge est respectée. Or, les dispositions relatives au rapport de base ne figuraient pas dans la directive IPPC, qui a précédé la directive IED. "On ne saurait en conclure qu'aucun rapport de base n'est exigé dans le cas des décharges", prévient la Commission, précisant que la directive "décharges" contient plusieurs éléments utiles pour l'établissement d'un rapport de base "qu'il conviendrait de compléter au cas par cas".
Reste maintenant au ministère de l'Ecologie à rédiger l'arrêté ministériel attendu en fonction de ces lignes directrices et à modifier le guide méthodologique du BRGM en conséquence.