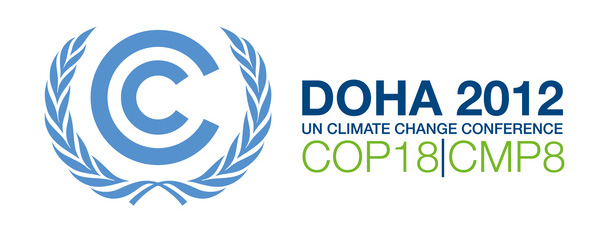Lundi 26 novembre, les Etats ayant ratifié la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc) se réuniront à Doha (Qatar) pour deux semaines de conférence sur les changements climatiques. Cette année, la 18ème Conférence des parties (COP18) doit permettre de progresser vers un accord global. L'objectif est fixé (obtenir un accord en 2015 pour une entrée en vigueur en 2020), reste maintenant à paver la voie qui y mène.
Comme tous les ans, la quinzaine précédant l'ouverture des négociations a été ponctuée de publications incitant les Etats à s'entendre pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). C'est le cas de l'habituel bilan de l'Organisation mondiale de météorologie (1) qui fixe à 390,9 parties par million le nouveau record de concentration atmosphérique en CO2. C'est le cas encore de l'étude de la Banque mondiale décrivant une Terre +4°C invivable. C'est le cas aussi du rapport publié par Agence européenne de l'environnement (AEE) (2) qui indique que le changement climatique touche toutes les régions d'Europe et a de nombreux impacts sur la société et l'environnement. C'est le cas enfin de la troisième mise à jour du rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) (3) qui confirme que l'écart ne cesse de croître entre les engagements pris et l'effort nécessaire pour limiter le réchauffement à 2°C. Rien de nouveau, mais la confirmation que le chemin actuellement pris n'est pas le bon.
Planifier les discussions
Pour les observateurs, Doha ne sera qu'une conférence d'étape sans grandes avancées et dont le principal objet est de faire progresser le compromis obtenu à Durban (Afrique-du-Sud) l'an dernier. L'obtention d'un calendrier de négociation fixant des délais pour négocier les points clés du futur accord et le prolongement du protocole de Kyoto constituent les deux principales avancées tangibles attendues par les négociateurs. Deux éléments qui pourraient être essentiels pour la suite du processus.
Cet enjeu est résumé par le Réseau action climat (RAC) qui considère qu'"il est hors de question d'attendre les bras croisés un accord adopté en 2015 et appliqué à partir de 2020". Voulant éviter "un « Copenhague bis »", le RAC juge que "les gouvernements de la planète doivent accroître leur niveau d'action et d'ambition avant 2020 et établir une feuille de route claire, avec des échéances chaque année, en vue d'un texte ambitieux « prêt à signer » en 2015".
En langage de négociateurs, il faut hiérarchiser et planifier les discussions qui auront lieu dans le cadre du Groupe de travail spécial de la Plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP). Pour l'instant les négociateurs ne se sont entendus que pour désigner deux co-présidents, Harald Dovland (Norvège) et Jayant Moreshwar Mauskar (Inde), et scinder en deux les discussions selon qu'elles traitent de l'action à entreprendre avant ou après 2020.
Un coup de pouce des Qatari ?
Comme à chaque réunion, le pays hôte se doit d'animer les négociations qu'il préside et être force de proposition. Qu'espérer d'un pays comme le Qatar qui affiche un des pires bilans carbone mondiaux ?
Parmi les possibilités figure le soutien du Qatar à la proposition équatorienne formulée en octobre et visant à établir une taxe sur les barils de pétroles vendus au pays développés. Fixée entre 3 et 5% du prix du pétrole, cette taxe permettrait de lever 40 à 60 milliards de dollars par an pour financer les pays en développement. L'Opep n'aurait pas rejeté le principe et le Qatar pourrait donner un coup de pouce à l'initiative.
Certains négociateurs n'y croient pas et estiment plutôt que le Qatar pourrait annoncer des objectifs nationaux en matière d'émission de GES. Une approche plus classique.
De tels progrès sont-ils envisageables compte tenu de la complexité des points à aborder et des positions des participants à la conférence de Doha ? Les négociations s'annoncent "très difficiles", estime un négociateur européen chevronné qui juge qu'"on peut être pessimiste".
En cause ? Des conditions économiques qui dégradent l'ambition des protagonistes. Peu d'Etats seraient prêts à améliorer leurs engagements et, sauf surprise, peu de progrès devraient être enregistrés sur ce terrain. Quant au financement pour l'adaptation aux impacts des changements climatiques et pour l'atténuation des émissions des pays en développement, il reste bien vague. Cette question est d'autant plus critique que les pays du Sud arrivent à Doha armés d'exigences fortes…
De plus, de nouvelles difficultés apparaissent chez certains acteurs qui affichaient jusqu'à maintenant de grandes ambitions. C'est le cas notamment de l'Union européenne qui apparaît affaiblie par le travail de sape de la Pologne qui s'oppose ouvertement à la politique climatique européenne. Après l'échec de Copenhague (Danemark) en 2009, le report de sept ans de l'accord global a redonné du poids à ses arguments.
Reste que de rares lueurs d'espoir existent, à l'image de la réélection de Barack Obama. Les premières déclarations du Président des Etats-Unis ont remis du baume au cœur des écologistes mais ne devraient pas avoir d'effets directs à Doha. Autre éclaircie, l'Australie et la Chine font leur premiers pas vers les marchés carbone. Le projet australien est adopté et vise une convergence en 2015 avec le marché européen, et la Chine développe un marché qui regroupera des villes et provinces pilotes.
Préserver les outils de Kyoto
L'autre grand thème concerne la survie du protocole de Kyoto dont la première période d'engagement s'achève le 31 décembre 2012. A priori, l'Union européenne, l'Australie, la Suisse et la Norvège devraient valider une deuxième période. Le Canada a d'ores et déjà annoncé son retrait officiel et le Japon et la Russie ont émis des signaux négatifs.
Quoi qu'il en soit, la négociation s'annonce ardue. Les pays en développement n'entendent pas accepter des engagements formels, alors que pour attirer les Etats hésitants il faudra probablement ne pas être trop regardant sur l'ambition. Une question clé en matière d'ambition est la conservation des crédits carbone surnuméraires accordés généreusement aux Pays de l'Est dans le cadre de la première période d'engagement. Le maintien de cet "air chaud" réduirait sensiblement la portée d'une deuxième période mais permettrait d'attirer plus de pays. L'absence de position de l'UE sur l'avenir de l'air chaud, dont le maintien intéresse au plus haut point la Pologne, illustre parfaitement ce dilemme.
Il faut sauver coûte que coûte le protocole, n'hésitent pas à avancer certains négociateurs qui jugent essentiel le maintien du seul outil juridique contraignant dont dispose la communauté internationale. C'est aussi ce que suggèrent certaines ONG, à l'image du RAC. Certes, le Réseau souhaite une deuxième période ambitieuse, mais il souligne surtout qu'il faut préserver un protocole qui "servira de round de préparation en vue de l'accord mondial qui devrait être adopté en 2015".
Enfin, le statut juridique de cette deuxième période reste un sujet complexe. Les négociateurs s'accordent pour éviter toute discontinuité avec la première période afin d'assurer la continuité des outils opérationnels et juridiques du protocole. Cependant, les procédures de ratification nationales rendent impossible l'entrée en vigueur d'un tel engagement moins d'un mois après sa signature par les exécutifs nationaux. Certains négociateurs, notamment ceux de l'Alliance des petits Etats insulaires (Aosis), proposent une application provisoire des amendements en attendant leur ratification. Une option déjà utilisée en droit international avec "le GATT, qui a précédé l'Organisation mondiale du commerce (OMC), est connu pour avoir été appliqué à titre provisoire de 1948 à 1995", rappelait l'Institut international du développement durable à l'issue de négociations préparatoires tenues à Bangkok (Thaïlande).