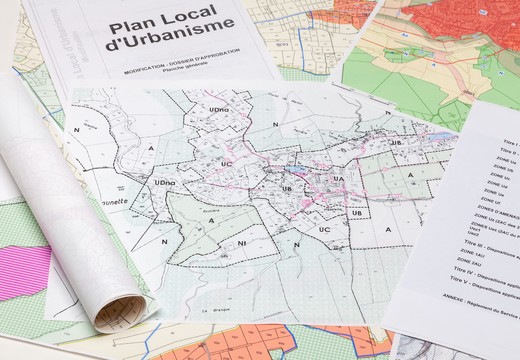Après une issue mitigée de la conférence de Nagoya en octobre dernier, les conclusions du groupe de travail sur la conservation et la protection de la biodiversité marine en haute mer semblent être une première victoire pour les défenseurs de la biodiversité.
Réunis du 31 mai au 3 juin au siège de l'ONU à New York, près de 200 participants, représentant les gouvernements, les institutions des Nations Unies, les organismes intergouvernementaux et les organisations non gouvernementales, ont planché sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des zones de juridiction nationale. Ils y ont pris ''les premières mesures essentielles pour combler les lacunes énormes qui existent en droit international sur la haute mer, ces zones situées au-delà de la juridiction nationale et si mal protégées''. Ces propositions pourraient aboutir à un nouvel accord multilatéral visant à conserver et gérer de manière durable la biodiversité marine en haute mer et à partager équitablement les avantages découlant de ses ressources génétiques marines.
''Ce fut vraiment une percée inattendue. Nous espérions obtenir ce genre d'engagement à la conférence de Rio +20 (1) l'an prochain, et non pas lors de cette réunion. Mais les gouvernements sont prêts à faire des compromis sur certaines questions clés'', se réjouit Kristina M. Gjerde, conseillère politique de l'UICN (Union nationale pour la conservation de la ntaure). Mais celle-ci prévient : ''nous avons encore un long chemin à parcourir''.
Des pressions anthropiques croissantes
La haute mer couvre près de la moitié de la surface planétaire et 64 % des océans. Si la biodiversité côtière et marine dans les eaux nationales est protégée par de nombreux accords internationaux (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Convention sur la diversité biologique), la haute mer n'est pas cocnernée et est entourée d'un vide juridique.
Pourtant, de nombreuses études scientifiques soulignent la richesse mais aussi la vulnérabilité de la biodiversité marine dans les Zones Au-Delà de la Juridiction Nationale (ZADJN). Les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens des eaux froides sont particulièrement fragiles. Or, les pressions anthropiques sont croissantes. Et de nouvelles activités apparaissent comme la pêche et la bio-prospection en mer profonde.
Dès 2004, la Convention sur la diversité biologique ''a mis en exergue le besoin urgent d'une coopération et de mesures internationales permettant d'améliorer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les ZADJN, notamment à travers l'établissement de nouvelles aires marines protégées ; et a recommandé que les parties, l'Assemblée générale et les diverses institutions compétentes, prennent d'urgence les mesures nécessaires à court, moyen et long termes, pour éliminer et éviter les pratiques destructrices'', rappellel'Institut international du développement durable (IIDD), qui publie un compte rendu des négociations (2) . Un groupe de travail spécial a été mis en place pour étudier ces questions. C'est lors de sa quatrième réunion que ce groupe de travail à aboutit à de véritables avancées.
Des négociations portées par l'UE et les pays en développement
Lors de la conférence de Nagoya sur la biodiversité, un protocole a été signé sur l'accès et le partage des avantages (APA) découlant de la biodiversité, et notamment des ressources génétiques marines. Mais il ne s'applique pas aux eaux internationales où reigne plutôt aujourd'hui le principe du ''premier arrivé, premier servi'' que dénonce l'UE. Selon elle cela déstabilise les efforts de conservation. Elle a donc appelé, lors de cette nouvelle réunion, à contrôler l'accès à ces ressources et à favoriser le partage des avantages monétaires et non monétaires.
Le G-77/Chine a pour sa part plaidé pour l'application du principe de patrimoine commun aux ressources biologiques des fonds des mers et des océans et leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale. Le Mexique et de nombreux pays en développement ont également soutenu la création d'un mécanisme de partage des avantages. Des propositions appuyées par l'UICN et Greenpeace notamment.
L'Union européenne, l'UICN et Greenpeace ont également plaidé pour un processus de désignation d'aires marines protégées à l'échelle mondiale au sein d'une instance créée dans cet objectif, en vue de concrétiser l'objectif de 10 % d'aires marines protégées en 2012 inscrit dans le Plan stratégique pour 2020 adopté à Nagoya. Selon l'UE, le hiatus entre la détermination des zones d'importance écologique et biologique et la désignation des aires marines protégées dans les ZADJN est dû à l'absence d'une instance mondiale chargée de ce mandat. Cependant, le Conseil pour la défense des ressources naturelles a souligné que cela nécessitait un accord entre les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), l'Organisation maritime internationale pour le secteur et l'Autorité mondiale des fonds marins (ISA).
Enfin, de nombreuses parties prenantes ont souligné la nécessité de mener des évaluations de l'impact environnemental et des évaluations environnementales stratégiques afin prévenir des méfaits des activités émergentes notamment.
Vers un accord multilatéral ?
Au final, les discussions ont abouti à une proposition commune du G-77/Chine, de l'UE et du Mexique pour ''un accord unique'', englobant le partage des avantages, les aires marines protégées et les évaluations d'impacts environnementaux, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines. Le Japon, l'Islande, les États-Unis, le Canada et la Russie se sont dit opposés à un tel accord et à l'idée de limiter la recherche scientifique marine à travers la mise en place d'un régime régissant l'accès et le partage des avantages.
Pourtant, le groupe de travail a finalement recommandé à l'Assemblée Générale des Nations unies qu'un processus soit lancé pour travailler sur ces questions, afin de mener à l'élaboration éventuelle d'un accord multilatéral dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
''Le consensus qui s'est dégagé lors de cette réunion est sans aucun doute un développement positif, voire inattendu, mais seul le temps nous dira à quel point la solidité du nouveau terrain d'entente est réelle'', conclut l'Institut International du Développement Durable.