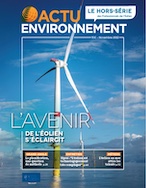Parmi les leviers que tente d'actionner la France pour doper l'éolien sur le territoire, figure la planification. Un mantra bien français, évoqué une fois encore par le président de la République lors de sa visite du parc offshore de Saint-Nazaire, le 22 septembre dernier. « Le premier pilier de l'accélération, ce ne sera pas la loi. Ça va être notre approche par la planification et la déclinaison », a-t-il ainsi affirmé, faisant allusion à la révision de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), en gestation, qui devrait ensuite se décliner par région. En 2021, la loi Climat et résilience a en effet introduit l'obligation pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) d'inclure des objectifs énergétiques compatibles avec la PPE, déclinables dans les documents territoriaux pour devenir juridiquement opposables.
Quand trop de zonage tue le zonage
En s'appuyant d'abord essentiellement sur cette programmation nationale, mais surtout sur l'établissement de zonages et autres cartes locales, la France a longtemps tâtonné en la matière. En 2005, déjà, la loi Pope créait des zones de développement de l'éolien (ZDE), destinées à favoriser les installations sur certains sites. Proposés par les collectivités territoriales, ces périmètres étaient instruits par les services régionaux de l'État et autorisés par les préfets de département. Supprimés en 2013, ils ont été remplacés par les schémas régionaux de l'éolien (SRE), eux-mêmes soumis aux conseils municipaux et aux organes délibérants des EPCI.
En mai 2021, Barbara Pompili commandait, en plus, aux préfets, la réalisation de cartographies tenant compte des contraintes topographiques, urbaines ou paysagères de chaque territoire, censées aider les porteurs de projet dans leur recherche de terrains. Ou de se transformer, au contraire, en instrument de blocage… Leur finalisation est désormais en cours à l'échelle nationale. Enfin, promulguée en février dernier, la loi 3DS autorise les élus des communes et des intercommunalités à intégrer un zonage éolien dans leurs plans locaux d'urbanisme (PLU) au sein desquels l'implantation de ces installations est soumise à conditions.
La nécessité d'une vue d'ensemble
Ce millefeuille n'a jamais réussi à prouver son efficacité. Pour Nicolas Wolff, vice-président et directeur général de Boralex, il devrait pourtant être possible de mieux se servir de ces travaux de cartographies. « On pourrait définir avec les préfets les zones dans lesquelles les approbations devraient être accélérées, puisqu'elles ont déjà été déterminées comme propices à la mise en œuvre de projets éoliens », suggère-t-il. Mais selon Pascal Craplet, directeur des affaires publiques chez Q Energy, l'éolien ne peut pas se satisfaire de simples planifications administratives. « Il faut tenir compte des gisements de vent, des possibilités de raccordement au réseau haute tension, des différents zonages de protection de la nature, de l'altitude, de la covisibilité. Pour cela, il faut faire davantage confiance aux développeurs », plaide-t-il.
La concertation : dernière roue du carrosse ?
Ces démarches ne devraient pas, par ailleurs, faire l'impasse sur une véritable concertation avec toutes les parties prenantes, y compris les populations, garante de l'objectivation de la trajectoire et du partage de l'ambition. « Il faut faire une planification climat-énergie-paysage à l'échelle départementale, avec un grand moment de concertation durant lequel on décline l'objectif national, tant pour les ENR que pour la sobriété ou pour les puits naturels de carbone, avant d'identifier les zones susceptibles d'accueillir des projets et de demander aux citoyens si cela leur semble convenable et s'ils veulent s'associer en mode participatif, détaille Nicolas Richard. Ensuite, on peut voir avec les promoteurs privés et les services de l'État comment mettre en oeuvre rapidement le projet. »
Jusqu'à présent, le Cese constate surtout de grands flous sur la légitimité des projets ou sur le partage équitable de l'effort. Mais en région Centre, rapporte Julien Reydel, directeur du développement éolien chez H2air, la cartographie demandée aux préfets a malgré tout servi de support pour reparler de planification et impliquer les territoires en leur montrant leur potentiel. « Nous avons ainsi pu faire des propositions pour mieux répartir les installations. Il faut dépassionner le débat avec les élus locaux », avance-t-il. Au Danemark, Copenhague a même poussé la démarche jusqu'à impliquer la population dans le choix du design du parc offshore qui s'étale, bien visible, dans la baie de la capitale. « C'est devenu un symbole dont les habitants sont fiers », commente Eugénie Bardin, responsable des affaires publiques chez Enercoop.
De grands débats annoncés
Éolien en mer : quelles leçons tirer de onze ans de débats publics ?
Depuis 2010, la Commission nationale du débat public (CNDP) a organisé ou garanti 14 débats publics et concertations sur des projets de parcs éoliens en mer. Ils ont réuni plus de 30 000 participants. De cette expérience, la CNDP tire plusieurs leçons. D'abord, la nécessité de la transition écologique et énergétique n'est généralement pas remise en question par le public. Mais celui-ci s'interroge souvent sur l'opportunité de développer l'éolien en mer : sa rentabilité, son efficacité, son intégration dans un bassin écologique, économique et social. Les participants demandent à l'État de justifier ses choix
et réclament les éléments lui permettant de se forger une opinion : données environnementales, bilan écologique, carbone et économique du projet. La CNDP recommande à l'État de développer la recherche sur les impacts environnementaux de l'éolien en milieu marin, tout en délivrant un discours clair et transparent sur ses objectifs.
Ce sera aussi un moyen d'aider les filières à gagner du temps, juge le président : « Parce que ça va nous permettre d'engager tous les élus (…) et les acteurs de terrain très en amont, dans la déclinaison de cette stratégie au niveau territorial, puis au niveau local, et de beaucoup pacifier les choses. » Sans préciser toutefois comment les perspectives esquissées par ce dialogue s'articuleront avec les siennes propres, tracées à Belfort, ni lesquelles prendront le pas sur les autres.
Du reporting pour finir
Toutes ces données seront peut-être également un peu mieux partagées dans le cadre des débats menés par le Conseil national de la refondation (CNR), lancé le 8 septembre dernier, et via les échanges, au Parlement, sur le projet de loi d'accélération des ENR. Restera ensuite à assurer le suivi précis des objectifs. « Trop souvent, on détermine une cible à long terme – tant de gigawatts à telle date –, puis on s'arrête là. Quelques années plus tard, sans avoir pris le temps de vérifier entre-temps où on en était, on constate que l'on est très en retard et on recule l'objectif, analyse Nicolas Wolff. Il faudrait découper les objectifs année par année, les répartir région par région, et s'assurer que l'on va y arriver. » Associé aux engagements européens de la France, le contexte géopolitique et énergétique actuel devrait aider le pays à améliorer ce reporting. Par ailleurs, « en nommant une ministre à plein temps de la Transition énergétique, l'État a montré son intérêt vis-à-vis des ENR, souligne Julien Reydel. Il y a désormais quelqu'un aux commandes dans ce domaine, ce qui n'était pas forcément le cas avant. »