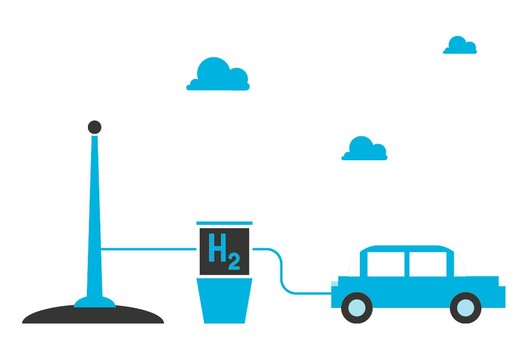Au moment où les pouvoirs publics et les professionnels des énergies renouvelables (EnR) poussent à l'installation de nouvelles capacités de production pour mettre fin à notre dépendance au énergies fossiles russes, ces projets se heurtent bien souvent à la nécessité d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
Le code de l'environnement pose en effet le principe de l'interdiction de détruire les espèces protégées. Mais, dans le même temps, il prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction si trois conditions cumulatives sont réunies : l'absence de solutions alternatives satisfaisantes, l'absence d'impact sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et le fait que le projet doive répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. L'obtention de cette dernière condition pourrait être prochainement facilitée si le gouvernement français suit les récentes recommandations de la Commission européenne à ce sujet.
« La question aujourd'hui que se posent les développeurs n'est pas tellement celle de savoir s'ils ont droit à la dérogation mais plutôt celle de savoir s'ils peuvent ne pas la demander », explique toutefois un professionnel de la filière. Une question qui n'a, jusque-là, pas été tranchée clairement par la justice administrative mais qui devrait l'être d'ici quelques semaines.
Question présentant une difficulté sérieuse
La dérogation espèces protégées se retrouve au cœur de la plupart des contentieux portant sur des projets d'EnR. Elle pose aux juges, et aux services de l'État en amont, la question de savoir si elle doit ou non être exigée. La jurisprudence en la matière devrait s'éclaircir à très court terme. À l'occasion d'un contentieux opposant une association de protection de l'environnement à un développeur éolien dans le Pas-de-Calais, la cour administrative d'appel de Douai a en effet posé deux questions (1) au Conseil d'État comme l'autorise l'article L. 113-1 du code de justice administrative s'agissant d'une « question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».
La première question porte sur le degré d'atteinte aux espèces protégées nécessaire pour qu'une dérogation soit exigée dans le dossier de demande d'autorisation environnementale d'une installation classée. Suffit-il, interrogent les juges d'appel, que le projet soit susceptible d'entraîner la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle d'un seul spécimen d'une des espèces protégées (2) , ou la destruction, l'altération ou la dégradation d'un seul de leur habitat ? Ou bien faut-il que le projet soit susceptible d'entraîner ces atteintes sur une part significative de ces spécimens ou habitats, en tenant compte notamment de leur nombre et du régime de protection applicable aux espèces concernées ?
Jusqu'à présent, l'Administration considère que l'atteinte doit porter sur une population entière et pas seulement sur un individu d'une espèce donnée. La ministre de la Transition écologique, qui est intervenante à l'instance pendante devant la cour administrative d'appel de Douai, a ainsi fait valoir qu'un projet n'était soumis à dérogation que s'il conduisait à « un risque significatif de destruction des espèces protégées ». Le guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, publié en mars 2014, indique de la même façon que « si la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques des populations concernées et n'a pas d'effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique », il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation espèces protégées.
Mais le juge administratif n'a jamais franchement tranché la question. À la différence du juge judiciaire. Par une décision du 2 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a en effet reconnu la responsabilité des exploitants d'un parc éolien dans la destruction de 28 faucons crécerellettes, sur cinq ans, en l'absence de dérogation préfectorale autorisant la destruction d'espèces protégées. « La destruction d'un seul individu d'une espèce protégée par une éolienne est interdite par la loi, et les promoteurs éoliens, même liés à EDF, doivent respecter cette interdiction », avait alors réagi Simon Popy, président de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon. Le Conseil d'État pourrait être tenté de suivre l'interprétation retenue par l'ordre judiciaire afin de mettre en cohérence leur jurisprudence respective.
« Filière à l'arrêt »
La deuxième question posée au Conseil d'État porte sur la probabilité que le risque d'atteinte ait lieu. « Dans chacune de ces hypothèses [atteinte à un individu ou à une population], l'autorité́ administrative doit-elle tenir compte de la probabilité de réalisation du risque d'atteinte à ces espèces ou des effets prévisibles des mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet ? », interroge la cour administrative d'appel.
« Si le Conseil d'État dit qu'un simple risque suffit, y compris pour un seul individu, clairement la filière est à l'arrêt », s'inquiète un professionnel des EnR. Pas un seul projet ne pourrait alors se passer d'une demande de dérogation, or beaucoup de développeurs, ajoute-t-il, abandonnent leur projet du seul fait qu'il y a une demande de dérogation, puisqu'elle occasionne des délais et un risque juridique supplémentaires.
Rallumer la guerre
Mais ces annonces, ainsi que la nouvelle organisation du gouvernement français avec deux ministères, l'un dédié à la transition écologique, l'autre à la transition énergétique, inquiètent les associations de protection de la nature. « On ne réussira pas la transition énergétique en Europe en négligeant l'importance stratégique de la biodiversité », avertissent huit présidents d'associations dans une tribune publiée le 24 mai sur Actu-Environnement.
L'inquiétude monte également chez les naturalistes du fait du projet de loi « d'exception » annoncé par le gouvernement en vue d'accélérer l'installation de nouvelles capacités de production. « Les projets ne manquent pas mais ils sont trop souvent bloqués par des procédures. Nous devons simplifier, avec tous les acteurs. C'est essentiel pour notre souveraineté énergétique et notre planète », a confirmé le 25 mai la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
« Le gouvernement est en train de rallumer la guerre entre naturalistes et porteurs de projets, ceux qui vont en sortir grands gagnants, ce sont les pétroliers et le nucléaire, au détriment des EnR », prévient un observateur qui déplore cette séparation opérée entre biodiversité et EnR.
C'est dire que l'avis du Conseil d'État, qui doit répondre à ces deux questions d'ici à la fin juillet, est attendu. Il sera scruté de très près par toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse du gouvernement avant le vote de son projet de loi, des professionnels des filières EnR, ou des opposants à l'installation dans le paysage de nouveaux mâts, parcs photovoltaïques ou centrales hydroélectriques.