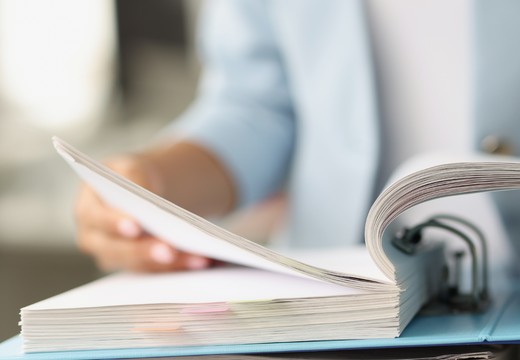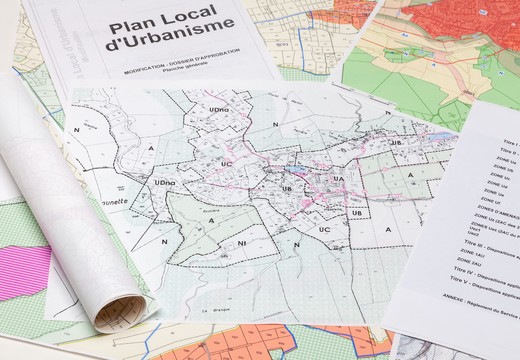Président fondateur et vice-président de CICF Territoires et Environnement
Actu-Environnement.com : Rappelez-nous l'objet de l'étude d'impact ?
Pierre Audiffren : Une étude d'impact est l'évaluation environnementale d'un projet. Il faut donc bien connaître le projet mais aussi bien connaître le milieu. Cela permet d'indiquer ce qui a été fait, ou de proposer ce qui doit être fait, pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet.
AE : L'étude d'impact actuelle présente-t-elle des insuffisances ?
PA : Jusqu'à la réforme de 1993, l'étude d'impact était un simple exercice de style. Tant les bureaux d'études que les services instructeurs n'avaient les capacités réelles pour faire de bonnes études. Sauf pour les routes et autoroutes, pour lesquelles les centres techniques de l'Equipement avaient de bonnes compétences sur l'écologie et les paysages, et l'eau en particulier. A partir de 1993, on a pris en compte les effets directs et indirects, temporaires et permanents des projets. Les auteurs de l'étude sont devenus identifiables. Ensuite, des progrès ont été faits à la marge, au gré de l'adoption de différents textes législatifs : loi sur les paysages, loi sur l'air avec le volet santé de l'étude, utilisation rationnelle de l'énergie, etc.
AE : L'adoption de ces différents textes a donc été décisive ?
PA : Pas réellement. Si l'on a affaire à un bon professionnel consciencieux et si le maître d'ouvrage est prêt à mettre les moyens, on n'a pas besoin que les décrets sortent. On distingue en fait trois groupes de bureaux d'études : ceux qui font le travail pour être utile au projet, informer le maître d'ouvrage et le décideur, et éclairer le public, les bureaux d'études low cost et, enfin, ceux qui ne sont pas compétents et qui font des études "canada dry".
AE : La question de l'indépendance des bureaux d'étude se pose donc ?
PA : Pour être indépendants, les bureaux d'études ne doivent pas être asservis par une relation hiérarchique, comme cela peut exister chez de gros aménageurs où les bureaux d'études sont internes, ou par une dépendance vis-à-vis du client ou d'une branche. Il ne faut pas, à titre d'exemple, que le bureau d'études fasse une part prépondérante de son chiffre d'affaires avec un seul groupe. L'exigence d'une dénomination complète et précise des auteurs de l'étude est une amélioration importante de la réforme actuelle. L'indépendance des bureaux d'études passe aussi par la capacité à dire les choses à son client. C'est ce que j'appelle le concept de "controverse interne à l'équipe projet".
AE : Les bureaux d'études font-ils l'objet d'une qualification obligatoire ?
PA : Il n'y pas de qualification obligatoire mais nous poussons les adhérents à obtenir la qualification de l'OPQIBI. Cette qualification apporte des garanties en termes de professionnalisme, d'assurance et de compétence. Il s'agit d'une véritable preuve de confiance car le dossier de qualification est vérifié de manière pointilleuse par une tierce partie.
AE : Ne rencontre-t-on pas des études bien faites mais non suivies d'effet ?
PA : Trop souvent, l'étude d'impact est considérée comme un simple rapport alors qu'il s'agit d'un processus. On touche là l'une des principales améliorations de la réforme. On n'avait effectivement jusque-là pas de suivi systématique de l'application des mesures préconisées par l'étude d'impact, sauf dans quelques domaines limités comme les routes et autoroutes, ou encore les installations classées soumises à la directive IPPC (1) , pour lesquels sont prévus des bilans périodiques. La réforme ne devrait toutefois pas changer grand chose à la pratique des bureaux d'étude qui font des études "utiles au projet". C'est-à-dire ceux qui réalisaient déjà des études qui infléchissent favorablement le projet, réalistes, résistant aux contentieux et garantissant le projet à long terme.
AE : Au-delà de ces améliorations en termes d'identification des auteurs de l'étude et de suivi des mesures, quelles sont les avancées de la réforme actuelle ?
PA : En matière d'information du public, on va plus rentrer dans le détail de l'analyse des variantes du projet. Alors qu'actuellement, il suffit de justifier sommairement la raison du choix du projet. Cela devrait permettre de développer certaines pratiques intéressantes, comme celle de RTE (2) qui, bousculé par les riverains des projets de lignes électriques, enregistre systématiquement et depuis longtemps ses propres évolutions durant les différentes phases du projet.
AE : Et encore ?
PA : Ce qui est innovant, c'est le volet "présentation du projet" qui est désormais généralisé à toutes les études d'impact, alors que cette présentation était parfois extérieure à l'étude elle-même. Cela vient du fait que la réforme permet un regroupement et une simplification des procédures. Des multiples types d'études d'impact existantes (enquête d'utilité publique, installations classées, permis de construire, autorisations de travaux, etc.), on passe à une étude unique avec toutefois un volet particulier pour les ICPE, les INB (3) et les grandes infrastructures de transport.
AE : Des points de la réforme posent-ils encore question ?
PA : Deux choses nous laissent circonspects : le cadrage préalable et l'examen au cas par cas. La possibilité de cadrage préalable, en amont du projet par les services de l'Etat, existe depuis 2006 mais la réforme instaure une obligation de réponse de l'Administration. Se pose la question des moyens de cette dernière pour répondre dans des délais très contraignants. Pourtant cette possibilité est intéressante et peut permettre d'éviter de faire fausse route sur un projet, mais il faut que les services instructeurs jouent le jeu.
AE : Et l'examen au cas par cas ?
PA : Avec la réforme, on aura beaucoup plus de projets soumis à étude d'impact au cas par cas. Cela prendra la forme de mini-dossiers constitués de formulaires Cerfa soumis à l'autorité environnementale. Mais, si l'on peut faire un parallèle avec le régime d'enregistrement des installations classées pour lequel il est parfois plus prudent de faire directement un dossier d'autorisation, on peut se demander si cette évolution n'ouvre pas la voie à une multiplication des contentieux en requalification.
AE : Quels sont les facteurs qui vont contribuer à améliorer encore les études d'impact ?
PA : Il faut d'abord une stabilité de la réglementation : que l'on applique les textes existants. Il faut ensuite que l'Administration adopte une position homogène au plan géographique et aussi entre les différents services instructeurs. Il y a encore trop de disparités : certains services, comme les anciennes DRIRE et DIREN, ont une culture avérée de l'étude d'impact alors que d'autres services ont moins de compétence ou d'exigence. L'avis de l'autorité environnementale apporte en revanche un autre regard et permet d'améliorer la qualité des études. Enfin, il faut que les élus et les maîtres d'ouvrage en général passent de "bonnes commandes", c'est-à-dire qu'ils rédigent un cahier des charges sérieux et n'aillent pas vers le moins-disant.