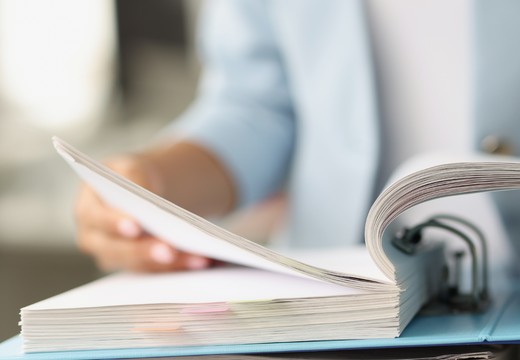Entrée en vigueur en 2013, la réforme de l'évaluation environnementale des plans, programmes et des documents d'urbanisme introduit un examen au cas par cas pour déterminer si une étude d'impact ou une évaluation environnementale stratégique est nécessaire, compte tenu des impacts potentiels. Après une première année d'application, un rapport du ministère de l'Ecologie dresse un bilan. Il apparaît que cette nouvelle disposition complexifie la tâche des services déconcentrés de l'Etat, des porteurs de projet et des bureaux d'étude. Le principal problème identifié est la saisine tardive de l'autorité environnementale, du fait de la méconnaissance des nouvelles règles, qui entraîne une surcharge de travail administratif. Cependant, l'administration est parvenue à surmonter cette difficulté et l'exemple des projets, soumis à cette évaluation préalable depuis 2012, permet d'envisager une amélioration rapide de la situation.
Pour réaliser ce Rapport sur l'activité des autorités environnementales locales en 2013 (1) , le Commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère de l'Ecologie a pris en compte les quelque 5.800 décisions prises par les autorités environnementales suite à un examen au cas par cas. Parmi les dossiers étudiés, 514 ont fait l'objet d'une demande d'étude d'impact.
Pour rappel, ce nouveau mode d'évaluation au cas par cas est issu de la transposition de la directive de 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et celle de 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Ces textes européens prévoient la consultation des "autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d'environnement" sur les projets et les plans et programmes susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement. En octobre 2009, la Commission européenne avait mis en demeure la France en raison de la transposition incomplète et incorrecte de la directive de 2001.
Complexité accrue
Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) ont constaté que les porteurs de projet connaissent mal la réforme de l'évaluation environnementale. Concernant l'urbanisme, les nouvelles règles constituent "une complexification de la législation et des procédures", en particulier pour les documents "sans enjeu". "En conséquence, les maîtres d'ouvrage saisissent l'autorité environnementale tardivement ou ne la saisissent pas dans des cas où elle devrait l'être et remplissent insuffisamment les dossiers de demande d'examen au cas par cas", constate le CGDD.
Ces saisines tardives "imposent des délais contraints pour la préparation des décisions par les services des Dreal". La gestion de l'activité est alors difficile et "l'examen au cas par cas apparaît dans certains cas comme une lourdeur administrative, chronophage lorsque les enjeux sont assez faibles", explique le CGDD, soulignant que "les circuits de signature et de transmission des dossiers ont été complexifiés". Cette complexité accrue est d'autant plus mal perçue par les porteurs de projet que certains plans et programmes sont sensés avoir essentiellement des effets bénéfiques sur l'environnement, comme les plans de prévention des risques naturels, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (Avap) ou les zonages d'assainissement.
A la complexité administrative s'ajoute aussi l'absence de compétence dans certaines Dreal, voire l'absence de service d'instruction au sein de l'administration. C'est le cas, par exemple, pour l'évaluation des dossiers de zonages d'assainissement. De même, l'articulation des textes réglementaires est parfois complexe. En matière d'urbanisme, le CGDD rapporte que l'article R121-16 qui encadre les procédures d'évolution des documents d'urbanisme "apparaît peu lisible", les codes de l'urbanisme et de l'environnement s'articulant mal, notamment en ce qui concerne l'actualisation des documents d'urbanisme nécessaires à la réalisation d'un projet soumis à étude d'impact.
Mobilisation des Dreal et simplification
Néanmoins, ces difficultés semblent avoir été bien surmontées par l'administration. Elle a pu faire face à cet exercice, qualifié de "particulièrement exigeant pour les services" compte tenu de la nécessité de motiver toutes les décisions et de l'obligation de faire une étude d'impact en l'absence de réponse de l'administration.
Le CGDD souligne que "le taux extrêmement faible de décisions tacites illustre la forte mobilisation à accomplir cette nouvelle mission". Et pourtant, la réforme est profonde puisqu'elle a conduit les autorités environnementales à prendre des décisions ayant des effets directs sur la procédure d'instruction des projets ou d'approbation des plans et programmes, alors qu'auparavant elles ne rendaient que de simples avis.
Par ailleurs, le CGDD s'appuie sur l'expérience de l'introduction de l'examen au cas par cas en 2012 pour les projets. Il apparaît que lors de sa deuxième année d'application, le ministère de l'Ecologie a constaté "une évolution des pratiques vers un abaissement des exigences et une diminution des soumissions à étude d'impact". Cette évolution s'explique par trois facteurs qui simplifient l'étude des dossiers : une amélioration de la qualité des dossiers déposés par les maîtres d'ouvrage et les bureaux d'études ; une approche plus pragmatique du rôle de l'étude d'impact par les pôles évaluation environnementale ; et un contexte de facilitation des projets. De plus, "la majorité des Dreal prend couramment en compte les mesures d'évitement et de réduction (parfois même de compensation) proposées par le maître d'ouvrage pour dispenser un projet d'étude d'impact".