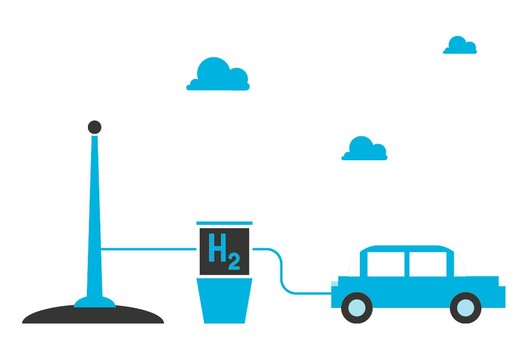Pour le développement de l'éolien offshore, "le débat national de transition énergétique offre une opportunité pour changer de paradigme et quitter l'approche des appels d'offres au coup par coup", estime Jean-François Petit, expert développement offshore auprès de France Energie Eolienne (FEE), qui relève par ailleurs qu'aucune étude préalable n'a été lancée en vue d'un troisième appel d'offre. En lieu et place, FEE préconise de recourir à une planification spatiale maritime (PSM) qui permettrait d'évaluer les zones favorables à l'éolien en tenant compte des diverses contraintes. Le représentant de FEE appelle donc les pouvoirs publics "à saisir l'occasion du projet de directive sur la planification des activités maritimes pour engager la démarche, sans attendre son adoption".
FEE présente par ailleurs sa carte du potentiel technique de développement de l'éolien en mer. Cette carte préfigure ce que pourrait être la place réservée à l'éolien dans le cadre d'une planification maritime qui permette une concertation entre acteurs maritimes indispensable à l'acceptation des projets offshore. Cette évaluation se base sur des facteurs géographiques avec la prise en compte des conditions de vent et de la bathymétrie (moins de 50 mètres de profondeur d'eau pour l'éolien posé). Elle s'appuie sur des facteurs liés à certaines activités maritimes avec la prise en compte des servitudes et d'une distance minimale à la côte de 10 km. Pour l'éolien posé, le potentiel éolien offshore ainsi évalué serait de 80 gigawatts (GW) répartis sur 10.000 km2. Quant à l'éolien flottant, le potentiel serait de l'ordre de 140 GW.

La présentation mi-mars 2013 du projet de directive visant à améliorer la planification des activités maritimes en mer et la gestion des zones côtières constitue une opportunité pour la filière offshore selon le syndicat professionnel. En effet, le Grenelle de la mer a montré qu'"il n'est pas facile de partager la mer entre les usagers", rappelle Philippe Gouverneur, président du comité offshore de FEE, estimant que "la PSM est le seul moyen d'organiser les réseaux électriques européens pour développer l'offshore". Pour cette raison, Grande-Bretagne et Allemagne entreprennent déjà la mise en œuvre de la planification, avance FEE.
La PSM permet de règlementer, d'organiser les activités en zones maritimes (pêche, transport, exploitations diverses, tourisme, etc.) et de protéger les écosystèmes marins sur le domaine public maritime, ainsi qu'en zone économique exclusive, plaide FEE. Et Philippe Gouverneur de regretter qu'"en France on [ait] surtout choisi les zones où l'offshore ne gênait pas trop, un exercice qui a ses limites".
Concrètement, FEE appelle les autorités françaises à mettre en œuvre la PSM sans attendre l'adoption de la directive européenne. La France dispose des structures et des outils lui permettant de se conformer à la future directive, soutient le syndicat professionnel. Pour cela, la France doit s'appuyer sur le Conseil national pour la mer et le littoral, les conseils maritimes de façade et les régions. Elle doit aussi être patiente, compte tenu du temps nécessaire pour obtenir un consensus, et pédagogue. Enfin, un travail d'acquisition des données est indispensable.
De la place pour les hydroliennes
S'agissant des autres énergies marines, les représentants de FEE évoquent bien sûr l'hydrolien qui bénéficie d'un soutien renouvelé de la part de l'actuel gouvernement.
Selon FEE, il n'y a pas de réelle opposition entre les deux sources énergétiques pour l'accès aux meilleurs sites car les hydroliennes nécessitent de forts courants que cherchent à éviter les installateurs d'éoliennes offshore posées. En effet, ces courants imposent un renforcement de la base des éoliennes qui augmente sensiblement les coûts de construction. Ainsi, bien que favorable à l'éolien, la zone au large de la péninsule du Cotentin (Manche) est une zone plutôt destinée à l'hydrolien, selon FEE.
Reste que la compétition ne porte pas que sur l'accès aux zones favorables mais aussi sur l'indispensable soutient public. Aussi, le président de la commission offshore de FEE a tenu à mettre en perspective les deux rivales. "On parle beaucoup d'hydroliennes", a reconnu Philippe Gouverneur, "mais le potentiel n'est que de 3 à 6 GW", bien loin du potentiel "considérable" de l'éolien offshore.
La France dispose de nombreux atouts permettant un développement important de l'éolien en mer, estime FEE. En premier lieu, avec 3.500 km de côtes maritimes, elle bénéficie de conditions géographiques particulièrement favorables pour l'implantation de parcs éoliens en mer. Elle disposerait là du deuxième gisement de l'Union européenne.
De même, l'excellence de la filière maritime française constitue un atout d'autant plus important que les acteurs nationaux disposent d'un savoir-faire industriel qui permettrait de structurer la filière offshore pour la rendre innovante et compétitive, estime FEE.
Malgré cela, "les progrès sont très très lents", déplore Jean-François Petit qui rappelle que la volonté politique inscrite dans les lois de programmation pluriannuelle des investissements (PPI) énergétiques de 2006 (1 GW d'offshore en 2010 et 4 GW en 2015) et 2009 (6 GW en 2020, conformément au Grenelle de l'environnement) n'a pas été suivie d'effet. "C'est bien d'avoir des objectifs, maintenant il faut les concrétiser", assène l'expert de FEE qui rappelle que dans le meilleur des cas, seulement un peu moins de 2 GW seront effectivement installés en 2020, loin de l'objectif officiel. Pire, il est probable qu'aucune éolienne ne soit installée en 2020 si les recours contre les projets s'accumulaient. Il faut en effet 8 à 10 ans pour développer un parc et les recours rallongent le délai de 4 à 5 ans.
Preuve que FEE ne compte plus sur l'objectif 2020, la fédération professionnelle ne se réfère plus qu'à un objectif de 15 GW en 2030. "Sur le potentiel de 80 GW que nous avons identifié, la France serait bien maladroite si elle n'en concrétisait pas 15", juge Philippe Gouverneur, qui appelle à "faire de la place à toutes les sources d'énergie".