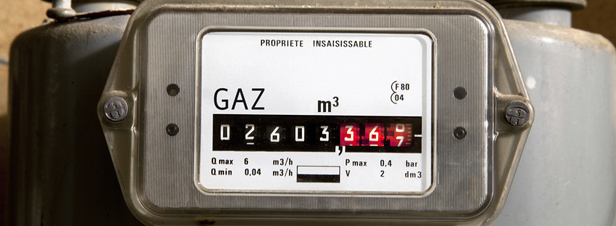La nouvelle loi sur la consommation, dite "loi Hamon", met fin aux tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz pour les acheteurs non résidentiels consommant plus de 30 mégawattheures (MWh) par an. Mercredi 2 avril, l'association Amorce a organisé une journée d'échange sur le sujet afin d'évaluer l'impact de cette réforme pour les collectivités qui se voient obligées de renégocier leurs contrats pour leur parc immobilier sans déroger au code des marchés publics.
La rencontre a été l'occasion de passes d'armes, certes à fleurets mouchetés, entre les opérateurs historiques et leurs concurrents pressés d'en découdre. Ce sera probablement "un grand moment de vérité", pour les fournisseurs comme pour les clients, pour reprendre l'expression employée par Yves Musckensturm, directeur adjoint de la direction des collectivités chez EDF.
Période transitoire avant coupure
Les consommateurs raccordés au réseau de transport devront souscrire un nouveau contrat dans les trois mois suivant la publication de la loi, soit avant le 18 juin prochain. Pour ceux, non raccordés au réseau de transport, dont la consommation annuelle dépasse 200 MWh, le basculement interviendra le 31 décembre 2014. Enfin, pour ceux consommant entre 30 et 200 MWh, la signature d'un nouveau contrat devra être réalisée avant le 31 décembre 2015.
Les clients raccordés au réseau de transport seront prévenus par leur fournisseur deux mois avant la date de suppression des TRV de la résiliation de fait de leur contrat de fourniture de gaz. Les autres seront informés par courrier à trois reprises : un mois après la promulgation de la loi, puis six mois et trois mois avant la date fatidique. La dernière lettre sera accompagnée d'une proposition de nouveau contrat.
"Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification", précise la loi. Stéphane Cochepain, directeur adjoint clients publics chez GDF Suez, a indiqué être en discussion avec les pouvoirs publics concernant cette lettre dont le contenu est essentiel pour assurer une réelle mise en concurrence. Quant au contrat transitoire, il s'agira d'une "offre correcte" qui n'entravera pas la concurrence, assure le représentant de GDF Suez.
Enfin, faute d'avoir conclu de nouveaux contrats en temps et en heure, le client sera lié, pour une période maximale de six mois, par le nouveau contrat proposé par son fournisseur initial. A l'issue de ce "contrat transitoire", "la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée", indique la loi, précisant que "le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties". Là aussi, le fournisseur devra informer le client par courrier de l'échéance de son contrat transitoire trois mois et un mois avant son terme. Si le dispositif permet d'éviter une coupure de gaz trop brutale chez les "clients dormants", c'est-à-dire ceux qui ne réagissent pas aux différents courriers, rien n'indique qu'il ne sera pas contesté (voir encadré).
Un dispositif bancal de bout en bout
Fabien Choné n'y est pas allé par quatre chemins : le dispositif transitoire est "bancal de bout en bout" a-t-il indiqué, précisant bien qu'il s'exprimait là à titre personnel. Reste que les propos du directeur général délégué stratégie de Direct Energie et président de l'Anode, qui regroupe les fournisseurs alternatifs, sonnent comme un avertissement.
Selon lui, ce dispositif ne serait pas conforme aux règles de la concurrence. S'il n'a pas détaillé ses griefs, il a cependant été très clair : si l'ouverture se passe bien, c'est-à-dire si les fournisseurs actuels mettent à disposition de leurs concurrents les données relatives aux contrats, il n'y a aucune raison que le dispositif transitoire soit attaqué. Un avis personnel qui sonne comme un avertissement.
Pour les collectivités locales, la situation est d'autant plus critique qu'elles ont une connaissance limitée du marché du gaz et de leur consommation. Autant d'éléments qui font de la rédaction de l'appel d'offres un vrai casse-tête.
L'allotissement, c'est-à-dire la création de lots au sein du marché proposé par une même collectivité ou regroupant des sites comparables (ou non) de différentes collectivités, est apparu clairement comme un élément clé. Comment constituer les lots ? Il faut des lots de "taille raisonnable", plaide Benoît Doin, représentant de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (Afieg), qui évoque des lots "d'une centaine de sites". Fabien Choné, président de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode), plaide pour des lots plus importants, c'est-à-dire jusqu'à 1.000 sites pour "quelques centaines de gigawattheures (GWh) à un peu moins d'un térawattheure (TWh)". En revanche, il estime qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de clients par lots, la gestion du contrat étant alors trop coûteuse. Selon l'Anode, il faut donc des "lots homogènes", regroupant si possible des sites de taille correcte appartenant à un nombre restreint de collectivités.
Les services associés à la vente de gaz peuvent aussi avoir leur importance, même si les avis divergent. Sur ce point, le représentant de GDF Suez insiste sur le fait que l'achat de gaz est aussi un achat de service, notamment s'agissant des interventions des agents du fournisseur lors de problèmes. Cependant, l'argument n'a, semble-t-il, pas convaincu la salle qui a souligné qu'en cas de problème, les services techniques des collectivités sont renvoyés, par les agents de GDF Suez qui fournit le gaz, vers les agents de GrDF qui gère le réseau… Reste que les agents GDF Suez sont présents sur l'ensemble du territoire, ce qui représente un enjeu d'emploi local. "Peut-être qu'un acheteur public peut être sensible à cette question ?", a tenté Stéphane Cochepain.
Pas de baisse des prix, sans accès aux données ?
Plus concrètement, comment rédiger les clauses de l'appel d'offres ? En étudiant le contrat de fourniture actuel, en particulier les conditions, les volumes et les prix, pour s'inspirer de l'existant, avance Yves Musckensturm. Mais le conseil du représentant d'EDF n'a pas franchement convaincu la salle. En effet, à trop "coller" au contrat du fournisseur actuel il y a un grand risque de favoriser les opérateurs historiques au détriment des nouveaux entrants. Dans ces conditions, la mise en concurrence serait virtuelle et le nouveau contrat aurait de grandes chances d'être retoqué au regard des règles de commande publique…
Cette remarque d'Yves Musckensturm a néanmoins eu pour avantage de mettre en lumière l'importance des données relatives aux profils de consommation des sites des clients détenues par les fournisseurs. En effet, pour bien assurer la transition, les collectivités ont besoin de définir leur cahier des charges à partir des spécificités de leur parc immobilier. Sans accès à ces données, il sera très difficile de faire un bon allotissement en proposant des lots cohérents en terme de profil de consommation. La mise à disposition des données sera probablement un des révélateurs d'une bonne mise en concurrence des fournisseurs.
En revanche, et assez logiquement, tous les fournisseurs représentés sont unanimes : il est peu probable d'obtenir des prix beaucoup plus bas que les TRV actuels, même en achetant de très grandes quantités de gaz. En effet, expliquent-ils, les molécules de méthane, qui constituent l'objet principal du contrat, ne représentent qu'une part du coût du gaz qui comprend aussi l'acheminement et les taxes. Par ailleurs, environ 40% de l'approvisionnement français est acheté sur les marchés sur lesquels il n'y a aucune réduction en fonction des volumes. Finalement, la seule variable d'ajustement est la marge des fournisseurs qu'ils peuvent réduire pour emporter un contrat intéressant. Et pour qu'un lot soit attractif, il faut qu'il soit cohérent et que sa gestion par le fournisseur ne soit pas trop complexe, d'où l'importance de l'accès aux données…