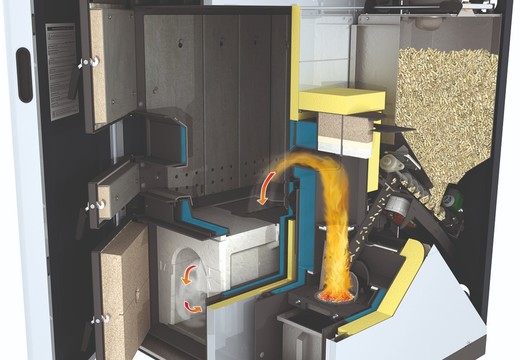« Nous assistons à une nouvelle forme de mondialisation, plus brutale, où la Chine et les États-Unis se sont engagés dans une rivalité technologique, économique et financière sans merci, constate le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. L'Europe doit y trouver sa place et affirmer son indépendance. » Sa réponse ? « Nous ne devons compter que sur nous-mêmes. » Lors du Conseil des ministres du mardi 16 mai, les ministères de l'Économie, de l'Industrie et de la Transition écologique ont présenté leur nouveau projet de loi censé traduire cette idée. Intitulé Industrie verte, le projet de texte devrait arriver au Sénat dans la semaine du 19 juin, puis à l'Assemblée nationale autour du 17 juillet.
Concentré sur quinze dispositions, il s'appuie sur deux stratégies : la décarbonation de l'industrie existante, dans la continuité du plan France 2030, et le soutien d'une nouvelle industrie autour de cinq « technologies vertes » prioritaires. Ce « big five », comme le surnomme Bruno Le Maire, se base sur le photovoltaïque, l'éolien, les pompes à chaleur, les batteries électriques et l'hydrogène décarboné. « Nous renonçons à certaines filières pour arrêter de nous disperser », se justifie le ministre. L'objectif ? Générer environ 23 milliards d'euros d'investissements, créer 40 000 emplois directs et économiser 41 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (MtCO2e) d'ici à 2030.
Accueillir jusqu'à 50 nouvelles « gigafactories »
Par ailleurs, comme énoncé en amont de sa présentation officielle, le projet de loi prévoit des mesures pour réduire de dix-sept à neuf mois le délai de procédures administratives d'autorisation. Il compte notamment sur la conduite simultanée de la consultation publique (sur trois mois au lieu d'un) et de l'instruction du dossier, dont la production d'un avis par l'Autorité environnementale (Ae). « L'idée n'est pas d'atténuer le rôle de la consultation publique, puisque sa durée sera allongée pour permettre aux citoyens de se familiariser progressivement avec le dossier au gré de son instruction », s'explique Bruno Le Maire.
Un nouveau crédit d'impôt et un nouveau livret d'épargne
Le principal levier envisagé demeure évidemment celui du financement. Le projet de loi veut exploiter les possibilités offertes par le nouveau cadre temporaire de soutien de crise (ou « Temporary Crisis and Transition Framework »), adopté par la Commission européenne en mars dernier. Ce dernier permet de créer, par le biais du projet de loi, un nouveau crédit d'impôt « Investissement dans les industries vertes » (ou C3IV) couvrant entre 20 et 45 % du coût des investissements pour les projets consacrés à quatre des « big five ». Déjà soutenue à travers le programme des Projets importants d'intérêt européen commun (Piiec), la production d'hydrogène n'en profitera pas pour l'instant. Ce C3IV pourra être sollicité jusqu'en 2025 et versé d'ici à 2029.
Ce nouveau crédit d'impôt doit être compensé, à hauteur de 500 millions d'euros par an, par une révision de plusieurs aides. Parmi les premières pistes : un relèvement des seuils d'émission de gaz à effet de serre dans l'évaluation du bonus-malus automobile et des contraintes poussant au verdissement des flottes d'entreprise. Bercy indique que d'autres pistes, touchant les carburants et les énergies fossiles, à intégrer au prochain projet de loi de finances sont « en cours d'audit ».
Le Gouvernement mise également sur la création, dès janvier 2024, d'un nouveau livret de « plan avenir climat » (qui complètera plutôt que remplacera le livret de développement durable et solidaire, ou LDDS). Ce produit d'épargne, destiné au moins de 18 ans, sera doté d'un plafond identique au livret A (environ 23 000 euros), mais à la rémunération supérieure, et sera voué à financer des projets « de transition écologique », dont d'industrie verte. Le ministère de l'Économie estime ainsi obtenir 5 milliards d'euros de financements annuels supplémentaires.
Une réindustrialisation plus exigeante
Quid du volet humain ?
En complément de son projet de loi, le Gouvernement s'engage à augmenter de 22 % le nombre d'étudiants formés par les écoles d'ingénieurs sous la tutelle de Bercy (celles de l'Institut Mines-Télécom et des Mines Paris), soit 2 300 de plus par an d'ici à 2027, tout en favorisant leur taux de féminisation (28 % contre 20 %). Et 700 millions d'euros du plan France 2030 seront alloués, entre autres, au renouvèlement de l'appel à manifestation d'intérêt consacré aux « compétences et métiers d'avenir ». Néanmoins, rien n'est encore prévu s'agissant de la reconversion professionnelle, volet jugé pourtant « indispensable » à une réindustrialisation verte, selon le RAC.
Dans le même temps, les subventions déployées par Bpifrance (prêts verts, subvention verte pour les petites structures, garanties vertes, etc.) seront soumises à un nouveau degré d'écoconditionnalité : la réalisation d'un diagnostic de son impact environnemental « adapté à la taille » de l'entreprise bénéficiaire. Ce bilan pourra même être réalisé « ex post », indique le ministère, « pour garantir la rapidité du versement de l'aide ». La Ligue de protection des oiseaux (LPO) réclame, pour aller plus loin, que parmi les conditions, les entreprises puissent « rendre publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l'impact de leurs projets industriels sur la biodiversité ».
Le projet de loi Industrie verte souhaite, en outre, resserrer la vis du bonus écologique versé à l'achat d'un véhicule électrique. Pour être éligible, ce dernier devra respecter de nouveaux standards (en cours de formulation par l'Agence de la transition écologique, ou Ademe) concernant le mix énergétique du pays d'assemblage et de fabrication des pièces détachées (acier et batteries), mais s'agissant aussi du taux de recyclabilité de ses composants. D'après les chiffres du Gouvernement, 40 % du montant des aides au bonus écologique (environ 1,2 milliard d'euros par an) profiterait actuellement à l'industrie automobile asiatique que « la France n'a pas vocation à financer ».
De plus, s'agissant justement de l'élément de circularité, le projet de loi prévoit diverses méthodes pour renforcer le recyclage de déchets industriels : simplification de la procédure de sortie du statut de déchet, sanctions pour les transferts de déchets en dehors du territoire national, etc. Le Réseau Action Climat (RAC) regrette que « l'économie circulaire soit uniquement abordée à travers le prisme des déchets, sans mention des autres piliers que sont l'écoconception, le réemploi et la réparation ».