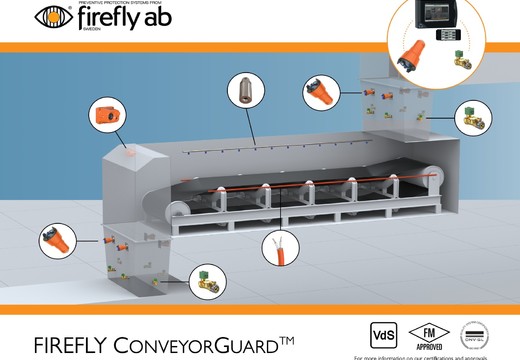C'est une profusion d'études qui ont été présentées lundi 5 juillet lors d'une nouvelle réunion du comité de transparence de Lubrizol qui avait été installé par le Gouvernement quinze jours après l'incendie de l'usine et des entrepôts de NL Logistique le 26 septembre 2019 à Rouen.
Santé publique France (SPF) a révélé les résultats de l'évaluation épidémiologique des conséquences de l'accident réalisée à la demande des ministres de la Santé, de la Transition écologique et du Travail. Les services de l'État ont également présenté l'évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) dont la réalisation avait été prescrite aux deux exploitants par arrêté préfectoral en octobre 2020. À ces études se sont aussi ajoutés les résultats d'une surveillance des impacts de l'incendie sur les lichens effectuée par la société Aair Lichens, le bilan des mesures de polluants et d'odeurs dans l'air ambiant réalisé par Atmo Normandie, ainsi qu'un rapport d'expertise établi à la demande de la commune de Mont-Saint-Aignan.
Les services de l'État comme la société Lubrizol se veulent rassurants. En effet, ces études, bien que de natures différentes, révèlent des effets sur la santé immédiatement après l'incendie mais ne font pas état de risques chroniques, si ce n'est sur la santé mentale des victimes. Des conclusions lénifiantes qui révèlent un décalage avec le ressenti des riverains.
Un trouble de santé pour 66 % des riverains
Le dispositif mis en place par Santé publique France a donné lieu à pas moins de quatre études. La première (1) analyse la perception du sinistre par la population et son impact sur la santé. Les données ont été recueillies entre septembre et octobre 2020 sur un échantillon représentatif de 4 793 adultes et enfants résidant dans les 122 communes de Seine-Maritime exposées à l'incendie, ainsi qu'auprès de 1 223 personnes résidant au Havre et constituant la zone témoin.
Il en résulte que 92 % de la population de la zone exposée a perçu au moins une des pollutions générée par l'accident : bruits, flammes et explosions, fumées noires, substances odorantes, suies et morceaux de toit en fibrociment déposées au sol. Et 66 % des personnes ont rapporté au moins un trouble de santé attribué à l'accident : symptômes psychologiques, oto-rhino-laryngologiques (ORL), généraux, oculaires, respiratoires et de troubles du sommeil. En outre, les riverains les plus proches du lieu du sinistre ont déclaré plus de symptômes que les habitants les plus éloignés.
« Un an après, cet événement accidentel a eu un effet négatif sur la santé perçue des habitants de la zone exposée (…), en particulier sur leur santé mentale », conclut Santé publique France. D'où la préconisation de l'établissement public de mettre en place un « suivi prospectif post-accidentel de la santé de la population exposée » à travers le système national des données de santé (SNDS). Par ailleurs, l'agence annonce pour le premier semestre 2022 la publication d'un volet complémentaire de l'étude, consacré à la santé mentale.
Inscrire les conditions d'exposition dans les dossiers médicaux
Le troisième rapport (3) de Santé publique France est consacré à la santé des travailleurs exposés à l'incendie. « Certains travailleurs, notamment les intervenants sur site mais aussi certains travailleurs présents sous le panache de fumée, ont été exposés à la pollution émise par l'incendie », rapportent les auteurs de l'étude. Ceux-ci établissent la présence de composés organiques volatils (COV), notamment du benzène, et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), mais « à des niveaux peu élevés ». Les symptômes observés à court terme étaient principalement de type irritatif et similaires à ceux observés en population générale. Des conclusions plutôt rassurantes et assez éloignées de celles d'un rapport d'expertise commandée par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis). « Un rapport du Sdis assez accablant sur les risques de santé des pompiers dans les années à venir », pointe Christophe Holleville, secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol.
À la lumière des résultats de Santé publique France, le groupe d'alerte en santé travail (Gast) de la région Normandie, qui comprend des services de l'État, de SPF, de la Carsat, du CHU et du centre anti-poison, suggère d'inscrire les conditions d'exposition à l'incendie dans les dossiers médicaux en santé au travail. Il propose également une surveillance épidémiologique similaire à celle qui sera mise en place pour la population générale à partir du système national des données de santé (SNDS). Ce système permet « de suivre dans le temps l'état de santé des personnes qui résidaient dans la zone impactée au moment de l'accident, même si elles déménagent », explique Santé publique France.
« Circulez, il n'y a rien à voir »
Quant à l'évaluation quantitative des risques sanitaires (4) (EQRS), réalisée par la société Ramboll à la demande des deux exploitants, il s'agit d'une démarche théorique d'estimation des éventuels risques sanitaires de l'incendie, par inhalation ou par ingestion. Elle fait suite à l'interprétation de l'état des milieux (IEM) qui avait conclu, en septembre 2020, qu'il n'y avait aucune incompatibilité d'usage des milieux liés à l'incendie.
Cette évaluation, dont la note de cadrage a été expertisée par l'Ineris, va faire elle-même l'objet d'une tierce-expertise par l'établissement public. Elle révèle, le jour de l'incendie, un dépassement des seuils d'alerte sur la zone industrielle rive gauche pour le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les particules PM10. « Seules les zones les plus proches de l'incendie et un point ponctuel sur les quais rive droite ressortent avec un risque sanitaire, sachant que les accès à ces zones, notamment sous le vent, ont rapidement été restreints le jour de l'incendie », ont toutefois rassuré les services de l'État en présentant les résultats de cette évaluation. L'étude fait état d'une absence de risques liés à la pollution des sols ou à la consommation de denrées alimentaires sur la zone impactée par l'incendie, de même qu'une absence de risques chroniques.
« En bref, circulez, il n' y a rien à voir », ironise Christophe Holleville. « Toutes les analyses, qu'elles soient de sols, de végétaux ou atmosphériques, nous sont présentées comme systématiquement au-dessous du bruit de fond, avec des pollutions historiques », explique le représentant de l'Union des victimes de Lubrizol. « Mais qu'est ce qu'il en sera dans dix ou vingt ans ? », interroge ce dernier.
« Depuis le début, il y a un décalage entre la perception de l'incendie, qui était un incendie d'ampleur, impressionnant pour la population comme pour les salariés, et l'impact sur la santé physique qui est limité aux effets aigus d'irritation », analyse de son côté Isabelle Striga, président de Lubrizol France. Même si la dirigeante de l'entreprise ne nie pas l'impact psychologique du sinistre mis en exergue par Santé publique France.