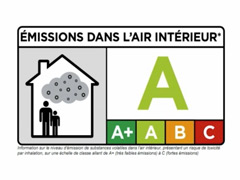Les chercheurs de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) se sont penchés sur la pollution de l'air intérieur émise par les produits ménagers et leurs risques sanitaires. Leur utilisation génère des émissions de substances volatiles mais les risques associés "sont aujourd'hui imparfaitement évalués", souligne l'Ineris. L'Institut a publié, le 26 avril, les résultats de son étude (1) portant sur dix-neuf produits ménagers utilisés en conditions réelles. Cette étude s'intéresse aux co-usages de produits (séances de ménage "multi-produits, multi-pièces") en conditions réelles, se distinguant des études antérieures mono-produit ou mono-pièce. Le rapport de l'Ineris se base sur les concentrations en substances volatiles mesurées en 2013 dans le projet de recherches baptisé "Adoq" (Activités domestiques et qualité de l'air intérieur).
Mesures des émissions de composés volatils en conditions réelles
Le rapport de l'Ineris reprend le protocole mis en place dans le projet PEPS (Produits d'entretien protocole simplifié). Il s'agit d'un protocole d'essai de caractérisation des émissions de composés volatils par les produits d'entretien. Cette méthodologie précise les conditions d'essai (type de chambre d'essai, paramètres environnementaux, scénario d'application du produit d'entretien), les composés organiques volatils (COV) étudiés et les conditions de prélèvements associées.
Une campagne d'essais a été menée au sein de la maison expérimentale "Maria" du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), afin d'évaluer les émissions en conditions réelles des 19 produits du panel (sprays, lingettes, berlingots, etc.). Il s'agit de nettoyants pour les vitres, pour la salle de bain et les sols, de nettoyants multi-usages, de dépoussiérants pour les meubles. Figurent aussi un nettoyant pour les WC, une eau de javel et un produit de vaisselle. Ces produits ont été sélectionnés en tenant compte des émissions "les plus fortes" en composés organiques volatiles totaux (COVT) et en formaldéhyde. Les substances connues pour leur réactivité avec l'ozone ont aussi été ciblées. Ces substances permettent "l'étude de mécanismes de formation de certains composés secondaires : aérosols organiques secondaires (AOS), formaldéhyde, etc." Les mesures en conditions réelles ont été réalisées pendant les deux heures et demie suivant le début de l'utilisation des produits.
Acroléine et formaldéhyde, deux substances d'intérêt prioritaires
Mais des indicateurs de risque montrent un dépassement pour une exposition de courte durée (une période d'une heure a été retenue pour caractériser les risques aigus), pour l'acroléine et le formaldéhyde. Deux substances devant faire l'objet d'une attention prioritaire mais les dépassements peuvent être considérés "comme de faibles ampleurs", précise l'Ineris. Pour ces substances, les premiers effets observés incluent des irritations respiratoires et oculaires. Par ailleurs, le formaldéhyde est une substance classée cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ).L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a établi une valeur guide de qualité d'air intérieur (VGAI) pour ces deux substances classées prioritaires.
"Les substances d'intérêt prioritaires sont l'acroléine et le formaldéhyde, puis dans une moindre mesure, le crotonaldéhyde, le propionaldéhyde, le benzaldéhyde, le benzène et l'éthylbenzène", indique l'Ineris. Les substances d'intérêt prioritaires identifiées "ne sont pas spécifiques" aux produits ménagers, ajoute l'Institut.D'autres sources peuvent générer des expositions cumulées : matériaux de construction et de décoration, mobilier, désodorisants, aliments en cours de cuisson, etc.
Ces résultats "mènent à recommander un usage modéré" des produits ménagers : adapter les doses à la taille de la pièce, aérer les pièces pendant et après les séances de ménage, rincer les surfaces. Une attention renforcée sera portée pour les personnes sensibles (asthmatiques, femmes enceintes, enfants).
Des données sanitaires encore "limitées"
A ce jour, pour plus de la moitié des substances émises par les produits testés, il n'existe pas de données sanitaires permettant de mesurer leur toxicité. Les risques liés aux particules émises et produites secondairement n'ont pas pu être quantifiés. Les produits ménagers peuvent émettre ou produire des substances "dont les effets sont aujourd'hui imparfaitement compris et quantifiables : substances à l'état nanoparticulaire, sensibilisants respiratoires et perturbateurs endocriniens", ajoute l'Ineris. Il préconise des mesures complémentaires (particules, composés organiques semi-volatils, etc.) qui "permettraient de mieux caractériser les risques associés aux produits ménagers".