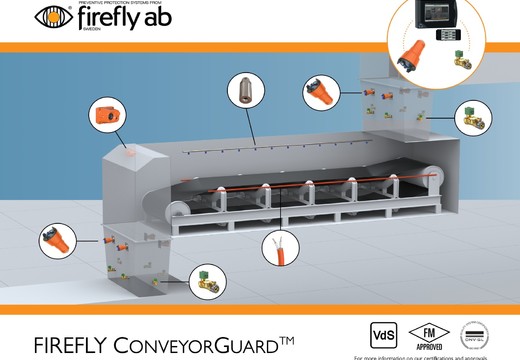La commission d'enquête du Sénat sur l'accident de Lubrizol avait pointé « une mauvaise information généralisée sur les dangers qui peuvent exister à proximité d'un site Seveso ». Les industriels sont pourtant tenus de réaliser une étude de dangers (EDD) qui doit préciser les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, son environnement, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le public est censé en être informé à travers le résumé non technique de l'étude de dangers qui doit être joint au dossier soumis à l'enquête publique.
Mais les exploitants prennent bien souvent prétexte de l'instruction interministérielle du 6 novembre 2017 pour faire du zèle. Cette instruction, qui limite la diffusion d'informations sensibles dans le contexte de la menace terroriste, n'a pas été remise en cause par les modifications réglementaires post-Lubrizol publiées le 26 septembre dernier. L'Autorité environnementale pointe toutefois une interprétation trop stricte de ce texte par les industriels. Quant à la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), elle prend ses distances par rapport à celui-ci.
Une traduction imparfaite de l'esprit de l'instruction
L'instruction de 2017 prévoit de classer les informations contenues dans l'étude de dangers en trois catégories : non confidentielles, non communicables mais pouvant être consultées, non communicables. Une note complémentaire du directeur général de la prévention des risques en date du 20 février 2018 encourage à inclure dans le résumé non technique l'ensemble des informations diffusables, dont les cartes d'aléas du risque par type d'effet sous forme agrégée. « Le résumé non technique (…) doit être suffisamment étoffé pour permettre au public d'appréhender les risques principaux du projet, mais ne doit contenir aucune donnée sensible ou très sensible », indique la note.
Or, dans son rapport 2018, l'Autorité environnementale relève « un excès de précaution dans la rédaction des documents publics », précisant que ce constat est partagé par plusieurs missions régionales d'autorité environnementale (MRAe). Dans un avis d'avril 2018 (1) portant sur la modernisation de la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), elle avait relevé que les dossiers des deux maîtres d'ouvrage du projet, Total et Air Liquide, traduisaient de manière imparfaite l'esprit de l'instruction.
Le résumé non technique d'Air Liquide « ne reprend pas de l'étude de danger la majorité des informations pourtant communicables selon les termes de l'instruction (…) et nuit à la compréhension de la spécificité de cette unité dans son environnement », pointait l'Ae. Quant au dossier Total, cette dernière jugeait « difficilement compréhensible de ne pas voir figurer dans le document des informations librement accessibles sur Internet concernant les procédés utilisés - par exemple, températures et pressions maximales -, l'analyse du retour d'expérience et de l'accidentologie, les éventuelles causes externes d'accidents (phénomènes naturels, chutes d'avions) ».
Informations réduites au minimum
Les choses ont-elles évolué dans le bon sens depuis 2018 ? Non, à en croire l'avis rendu le 4 novembre (2) dernier par l'Autorité environnementale sur le projet d'établissement Seveso seuil haut du groupe SNF à Gravelines (Nord). Cet avis actualise un précédent d'avril 2019 suite au projet de l'industriel de la chimie d'ajouter des unités de fabrication de produits nouveaux de chimie organique (ATBS et Vito) à l'unité de production de polyacrylamides initialement prévue.
L'Autorité indépendante demande également à l'industriel de superposer « sur chaque graphique représentant les zones d'effet correspondant à une probabilité d'occurrence » les effets des unités polyacrylamides et ceux liés aux nouvelles unités. « Certains scénarios présentent des effets toxiques significatifs jusqu'à 800 mètres, à partir d'installations excentrées par rapport à celles des unités polyacrylamides », relève l'avis. Des informations qui paraissent indispensables pour permettre au public d'apprécier la réalité des risques et auxquelles ils n'ont pourtant pas accès.
Le contre-pied de la Cada
On pouvait croire que les choses allaient changer avec le nouveau dispositif réglementaire mettant en œuvre le plan d'actions post-Lubrizol du Gouvernement. Il prévoit en effet que l'étude de dangers est communiquée à toute personne sur demande et que, lorsque différents intérêts font obstacle à sa mise à disposition intégrale, le résumé non technique doit être mis à disposition.
Ces textes ne changent pas l'état du droit sur ce point. Le code de l'environnement se contente de préciser que le résumé non technique comprend « au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels d'un accident majeur sur la santé publique et l'environnement ». Or, c'est d'informations précises et circonstanciées dont ont besoin les riverains. D'autre part, les nouveaux textes ne remettent pas en cause l'instruction de 2017 ni les mauvaises interprétations qui en sont faites.
Les choses pourraient en revanche changer s'il est fait application de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (3) du 20 février 2020, auquel l'Autorité environnementale se réfère. Dans cet avis, portant sur l'accès aux documents liés à l'incendie de l'usine Lubrizol, la Cada prend le contre-pied de l'instruction gouvernementale. Elle estime en effet que « l'identité des dirigeants de l'installation classée, la nature précise des substances dangereuses manipulées ou stockées sur le site, les quantités maximales de substances dangereuses susceptibles d'être présentes ou celles effectivement présentes sur le site, les cartes ou plans des zones d'effet par phénomènes dangereux ou par installation, ne relèvent pas nécessairement d'un secret protégé, notamment au titre de la protection de la sécurité publique ».
Elle juge que la communication de ces informations revêt un intérêt pour l'information du public et que « sauf circonstances particulières » elles sont par conséquent librement communicables à toute personne qui en fait la demande.