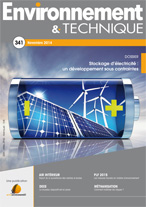Directeur Nord & Est, Groupe Quadran
Actu-environnement : La préfète de la Meuse vous a refusé un projet de parc éolien près des champs de bataille de Verdun. Que s'est-il passé ?
Charles Lhermitte : Depuis 2006 et jusqu'aux mois d'avril-mai 2014, nous n'avions jamais eu d'opposition. Nous avions eu des délibérations favorables des deux communes concernées, des trois communautés de communes, de la totalité des services de l'Etat, de l'autorité environnementale, un projet d'arrêté d'autorisation d'exploiter de la Dreal et même un projet favorable d'arrêté de permis de construire. Les réunions publiques s'étaient déroulées normalement. Mais en avril, avec les élections et un contexte de fusion des intercommunalités, les nouveaux maires des communes ont pris une direction totalement opposée à leurs prédécesseurs. Une association s'est montée et le porte à porte a commencé. A partir de là, la situation a dégénéré : on est désormais considéré comme des gens sans respect du patrimoine de guerre alors que nous l'avions pris en compte dès le début dans notre projet. Si nous étions producteurs de gaz de schiste, nous serions mieux considérés !
AE : Quel a été l'argument de la préfecture pour justifier ce revirement ?
CL : Le projet de classement mondial au patrimoine de l'Unesco des champs de bataille de la Grande Guerre porté par neufs départements a été interprété dans le département de la Meuse comme porteur d'un tourisme de mémoire incompatible avec la présence d'éoliennes. En 48h, tous nos projets d'arrêtés se sont vus rajouter une dernière ligne avec un avis défavorable. Huit ans de travail et 300.000 euros d'études réduits à néant.
AE : Pensez-vous que l'association montée contre votre projet est à l'origine de cette décision ?
CL : Même s'il n'a a priori pas été élu sur cette question, l'un des deux nouveaux maires soutient l'association et a su trouver un appui national. C'est d'ailleurs le mode de fonctionnement de l'opposition anti-éolien en France. Sur le terrain, le mouvement se structure et se radicalise. Cette opposition de principe, dogmatique, est proche du lobbying. Ces associations ont des positions de politique nationale voire européenne et elles mènent des actions partout en France. Elles sont actives aussi bien en amont des projets qu'en aval, où les recours se multiplient et engorgent les tribunaux administratifs.
AE : Certaines associations locales auraient le soutien du préfet de leur département. Vous confirmez ?
CL : Dans une préfecture de la région Centre en effet, certaines questions ont été soulevées sur l'impartialité du préfet vis-à-vis de l'éolien. Je n'ai pas envie de lever un discrédit sur le corps préfectoral mais ce cas m'a été rapporté plusieurs fois et notamment par des élus. Il n'est pas possible d'empêcher les affinités entre les gens. Une position dans un département va être traitée différemment d'un département à l'autre dans un contexte similaire. Il suffit parfois que le propriétaire d'un domaine ait des amis bien placés pour que le débat soit faussé. Il y a des subtilités qui nous échappent parfois.
AE : Est-ce la justice qui décide aujourd'hui de l'intérêt ou non d'un parc éolien ?
CL : Je ne dirais pas ça. Quand on rentre dans la mécanique du recours, on n'est jamais sûr d'obtenir gain de cause. Très souvent les recours ne portent pas sur le fond mais plutôt sur la forme : constat d'huissier mal fait, affichage en mairie à la mauvaise date, envoi d'un recommandé hors délai… L'attaque ne porte pas sur l'utilité ou sur la réelle gêne du projet. Ces débats d'avocat commencent à nous coûter cher ! 60.000 euros si l'affaire va jusqu'au Conseil constitutionnel. Mais dans bien des cas nous obtenons gain de cause. C'est désormais un élément à prendre en compte dans le montage du projet, qui en allonge la durée. De trois ans en moyenne nous sommes passés à sept ou huit ans. Et au cours de cette période nos interlocuteurs changent à la tête des préfectures, au sein des services de l'Etat, dans les mairies, avec le risque d'un revirement de position. ça rend l'équation sincèrement complexe.
AE : Pourtant il existe une loi contre les recours abusifs ?
CL : L'idée de cette loi est très bien et pas seulement pour l'éolien mais les personnes sont condamnées à 3.000 euros. Pour une association capable de dépenser 70.000 euros en avocat, cette somme ne l'intimide pas. D'ailleurs je m'interroge sur l'origine des moyens financiers des associations anti-éolien…
AE : Quels moyens avez-vous pour contrecarrer cette opposition ?
CL : Il faut distinguer ce mouvement de l'opposition "légitime", c'est-à-dire des riverains directement concernés par le projet qui se posent des questions sur les gênes éventuelles. Les projets doivent être montés de manière cohérente et respectueuse des riverains. Nous avons les moyens de considérer ces craintes et de les lever en modifiant le projet par exemple.
Concernant l'opposition anti-éolien de principe, c'est plus difficile car ce sont des positions très fermées qui bénéficient d'un relai médiatique conséquent. Les syndicats professionnels n'ont pas les moyens de payer des plans médias. Les anti-éoliens ont bien fait leur travail car de nombreuses idées reçues sont entrées dans la tête des gens. Les professionnels de l'éolien ont eu le défaut de ne pas communiquer au niveau national sur l'intérêt et l'image de nos activités.
AE : Un nouvel argument anti-eolien a émergé : la prise illégale d'intérêt. Quelle est son origine ?
CL : Cet argument est lié aux spécificités du monde rural où sont implantées les éoliennes. Les membres du conseil municipal doivent prendre position sur le projet. Et certains d'entre eux sont propriétaires et auront peut-être une éolienne sur leur terrain et le loyer qui va avec. Lors des délibérations, nous attirons l'attention des élus pour qu'ils ne fassent pas voter les personnes concernées voire qu'elles sortent de la salle. Mais bien souvent les deux tiers des conseillers municipaux sont de souche agricole et on ne peut pas faire un vote avec une poignée d'élus !
Je connais un cas dans l'Ouest de la France où une élue a été condamnée à quelques milliers d'euros d'amende pour prise illégale d'intérêt. Elle l'a très mal vécu. Ces élus de petites communes, souvent bénévoles, ne sont pas armés contre ce type d'attaque.
AE : Quelles recommandations donnez-vous aux développeurs de parc pour limiter l'opposition ?
CL : Trois points sont importants. Il faut être attentif aux aspects juridiques des dossiers car moins il y aura de faiblesses, plus les recours seront compliqués. Deuxième point : il faut communiquer même si cela peu aviver l'opposition très tôt. Moins les gens en savent, plus ils spéculent. Il faut être les premiers à communiquer et ne pas laisser le monopole du débat aux opposants.
Troisième chose primordiale : il va falloir être transparent sur le coût d'un projet, ce qu'il rapporte aux propriétaires, à la collectivité... L'investissement participatif est également une évolution qui permettra de favoriser l'acceptabilité du projet.
AE : Les retombées financières pour les collectivités concernées semblent bien minimes. Est-ce un bon argument pour vous ?
CL : L'imposition a en effet changé la donne dernièrement.La taxe professionnelle a été remplacée, dans notre secteur d'activité, par l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer). Une éolienne, qu'elle produise ou pas, est taxée à 7.120 euros par MW installé. Alors que la taxe professionnelle était perçue par les communes, l'Ifer est perçu par le bloc communal (communauté de communes) qui ne reverse pas de manière systématique. Les communes ont donc le sentiment de s'être fait déposséder même si l'argent revient sous forme de services rendus par la Communauté de Communes. Des villes dans la Marne et la Meuse où la pression fiscale a baissé grâce à la fiscalité générée par les parcs éoliens.
Un des moyens de générer des retombées pour la commune de manière légale peut être la création d'une société d'économie mixte (SEM). Une collectivité ne peut pas prendre des actions dans une entreprise privée mais elle peut créer une SEM avec des entreprises ou d'autres acteurs publics dans laquelle elle doit être majoritaire (51% des parts minimum). Le revenu du parc revient à la SEM qui le répartit entre ses actionnaires. Mais cette majorité est problématique : un parc éolien de 10 machines de 3 MW coûte 40 millions d'euros. Pour emprunter sur 15 ou 20 ans, il faut un apport de 20% soit 8 millions à mettre sur la table. La collectivité doit trouver 4 millions d'euros ! On est face à un vrai dilemme : les Communautés urbaines "riches" pourraient investir mais ce n'est pas forcément celles qui ont vocation à accueillir les éoliennes et les communautés rurales aimeraient pouvoir le faire mais n'en ont pas les moyens.