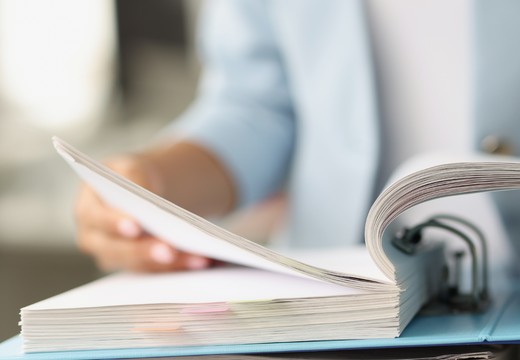Le Conseil d'État va-t-il rendre prochainement une décision déterminante en matière de justice climatique ? Les conclusions présentées par le rapporteur public ce lundi 9 novembre dans le contentieux opposant la commune de Grande-Synthe à l'État pour inaction climatique le laissent à penser.
Cette commune du Nord, menacée par la hausse du niveau de la mer, et son premier édile, Damien Carême devenu depuis député européen, ont attaqué l'État en justice en janvier 2019. "La France se présente aux yeux du monde comme championne du climat mais se montre incapable de respecter le budget carbone qu'elle s'est elle-même fixé", avait expliqué Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement et avocate de la commune. Quatre ONG (1) , initiatrices de l'Affaire du siècle, grand procès emblématique de la justice climatique en France, se sont jointes à l'affaire. Les villes de Paris et de Grenoble ont fait de même.
Double avancée jurisprudentielle
Point négatif pour les requérants, le rapporteur refuse de reconnaître à l'Accord de Paris un caractère contraignant et invocable par les citoyens. « C'est très discutable », réagit Corinne Lepage à la sortie de l'audience. En revanche, il conclut à la recevabilité des villes requérantes. « C'est important, le rapporteur reconnaît le droit des communes d'agir sur les questions de dérèglements climatiques », analyse l'avocate. "Une étape supplémentaire dans la reconnaissance des capacités d'action des communes en faveur de la protection de l'environnement, après que le tribunal de première instance de l'Union euroipéenne a reconnu les villes de Paris, Bruxelles et Madrid compétentes pour agir contre la pollution dans l'affaire du dieselgate", se félicite la maire de Paris, Anne Hidalgo.
« Le rapporteur propose également au Conseil d'État des avancées jurisprudentielles très sensibles », se félicite la spécialiste du droit de l'environnement. En premier lieu, de considérer que les lois de programmation ont un caractère contraignant, ce qui constituerait un revirement de jurisprudence. En second lieu, que le Conseil d'État applique les textes en vigueur le jour où il statue et non ceux applicables au jour du dépôt de la requête.
Confronter la science à la réalité de l'action de l'État
Mais, faute d'éléments suffisants pour trancher, le rapporteur public propose au Conseil d'État de prononcer une mesure supplémentaire d'instruction. Par cette mesure, la Haute juridiction demanderait à l'État de produire dans un délai de trois mois les éléments permettant de vérifier que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, telle qu'elle résulte de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) adoptée par décret en avril dernier, est cohérente avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique et par le règlement européen du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles des émissions de gaz à effet de serre par les États membres.
« Cette mesure serait historique car il s'agirait d'évaluer les politiques publiques basées sur des outils programmatiques type SNBC qui, jusqu'ici, n'était pas considérés comme contraignants par l'État et par le juge. Cela impliquera une confrontation des éléments scientifiques (rapports du Haut Conseil pour le climat, du Giec, du Cese (2) , etc.) à la réalité d'action de l'État pour atteindre des objectifs futurs (2030 notamment) », analyse Laura Monnier, juriste de Greenpeace France.
Le précédent Urgenda
Contacté par Actu-Environnement, le ministère de la Transition écologique n'a pas souhaité réagir à ces conclusions. « Et pour cause, réagit Corinne Lepage, il n'était pas représenté à l'audience ». « C'est une forme de mépris sur un sujet d'une telle importance», ajoute, dépitée, l'ancienne ministre. Selon le mémoire en défense, que nous avons pu consulter, le ministère estime que le cadre juridique national « permettra à la France d'assurer le respect de ses engagements européens et internationaux ». Et d'ajouter : « Il n'y a donc pas d'obligation juridique de prendre d'autres mesures et notamment d'imposer une « priorité climatique » qui consisterait à interdire toute mesure susceptible d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, laquelle serait, au demeurant, impossible à mettre en œuvre ».
On se rappelle aussi de la réaction du ministre en titre au moment du lancement de la procédure. "Vous croyez que c'est devant les tribunaux qu'on va résoudre le problème du dérèglement climatique ?", avait réagi François de Rugy. La décision rendue, depuis, par la Cour suprême des Pays-Bas a montré que la réponse à cette question est en partie positive. En décembre 2019, la juridiction néerlandaise a en effet confirmé l'obligation de l'État batave de réduire de manière urgente et significative les émissions de gaz à effet de serre du pays.
Il reste maintenant à voir si le Conseil d'État suit son rapporteur public et si ce contentieux pourrait aboutir au prononcé d'une injonction à agir à l'encontre de l'État français sur le modèle Urgenda. La réponse à la première question sera connue d'ici quinze jours. Quant à la deuxième, le rapporteur public a estimé qu'il n'était pas dans cette logique. « Mais le Conseil d'État est assez souverainiste. Il pourrait prendre une décision qui va dans le même sens mais qui n'est pas fondée sur la même chose », estime Corinne Lepage.