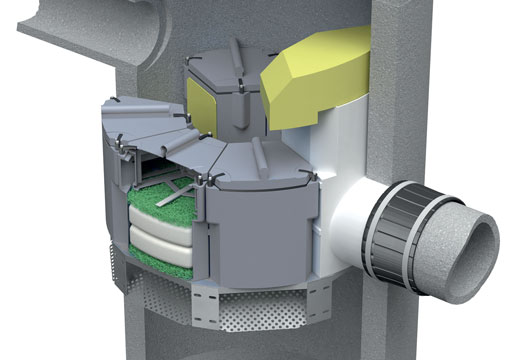Le projet de loi climat et résilience (1) , débattue en commission spéciale à l'Assemblée, a permis de sortir de l'oubli une proposition de loi toujours en attente d'une inscription à l'ordre du jour à l'Assemblée : celle relative à la sauvegarde des ressources en eau potable pour les générations futures. « Si nous ne prenons pas garde, nous manquerons d'eau en métropole dans les décennies à venir, sur le plan de la qualité et sur celui de la quantité, a rappelé Martial Saddier, député Les Républicains de Haute-Savoie, signataire de l'amendement soutenant cette disposition et dépositaire de la proposition de loi. La plus grande réserve d'eau potable, ce sont les nappes stratégiques souterraines. Or elles n'ont pas de statut juridique. Elles ne sont ni identifiées ni cartographiées, et par conséquent elles ne sont pas systématiquement protégées ».
Un statut juridique pour les nappes stratégiques souterraines
L'idée de cette initiative est de corriger ce manque à travers l'élaboration des prochains schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (2) (Sdage). Ces derniers devront, d'ici le 31 décembre 2027, identifier les masses d'eau souterraines et aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle ou future. Autre information à intégrer - si elle est disponible - : les bassins d'alimentation ou portions d'aquifère en relation avec la ressource à préserver, appelés zones de sauvegarde. À défaut, ils identifieront les masses d'eau souterraines et aquifères au sein desquelles les ressources stratégiques et leurs zones de sauvegarde doivent être identifiées.
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déclineront les mesures de protection à prendre pour les protéger. En leur absence, les schémas de cohérence territoriale, ou les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales identifieront les besoins en eau pour la consommation humaine actuelle et future ainsi que les zones de sauvegarde concernées mais également leur objectif de préservation en qualité et en quantité ainsi que les conditions de leur préservation.
Rappel du nécessaire respect de l'équilibre des milieux naturels
Le texte propose également de réaffirmer l'importance de la préservation et la restauration des milieux naturels. « Les changements climatiques ont un effet de plus en plus visible et inquiétant sur cette ressource, a souligné Cendra Motin, député La République en marche de l'Isère, rapporteur pour le titre II de la loi « produire et travailler ». Dans la lignée des Assises de l'eau et afin d'aider ceux qui ont en charge ce patrimoine naturel, le texte précise la notion de respect des équilibres naturels ».
Le projet de loi propose de rappeler dans les principes généraux du code de l'environnement que « le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, superficiels et souterrains, des zones humides et des écosystèmes marins ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques, les zones humides et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la nation ». Vers une disposition pour les moulins ?
Le projet de texte a été l'occasion de nouveaux débats entre, schématiquement, les défenseurs de la préservation des moulins et ceux de la continuité écologique. Sans que pour l'instant des dispositions ne soient adoptées. « S'agissant de la création de petites installations hydroélectriques, nous parlerons des communautés d'énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes lorsque nous examinerons l'article 23, a toutefois indiqué Cendra Motin, député La République en marche de l'Isère, rapporteur pour le titre II de la loi « produire et travailler ». Je vous ferai à cette occasion une proposition concernant les moulins, auxquels nous sommes attachés. Des communautés de citoyens, d'élus, de TPE et de PME peuvent leur apporter une seconde vie grâce à l'utilité qu'ils présentent en matière hydroélectrique et écologique ».
Vers une restauration des écosystèmes aquatiques garants de services écosystémiques ?
Le projet de loi pourrait s'enrichir de nouvelles dispositions et aller plus loin dans la préservation des services écosystémiques. Un amendement propose pour cela la restauration des écosystèmes aquatiques dégradés. « Lorsqu'ils rendent des services écosystémiques significatifs pour la lutte contre les changements climatiques, comme la séquestration de carbone, les systèmes aquatiques dégradés doivent faire l'objet d'une restauration dès lors que c'est techniquement possible et économiquement acceptable – ces deux conditions sont importantes, a détaillé Frédérique Tuffnell, députée Modem de Charente-Maritime, signataire de l'amendement. On peut restaurer des zones humides, par exemple des tourbières. Ce sont des puits de carbone exceptionnels qui rendent un service au climat et à la biodiversité. Nous avons besoin de les conserver, de les préserver et même de les restaurer. Cette mesure avait été proposée lors des Assises de l'eau : la restauration des tourbières est une action forte du plan d'action qui en est issu ». Pour l'instant non adopté, cet amendement pourrait dans la suite des discussions connaître une issue favorable. « Le fait que l'amendement porte sur cet article de principe du code me pose un problème. On imposerait une restauration sur la base de critères et de conditions qui sont peu précis – cela mériterait d'être défini, a réagi Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Les obligations de restauration, les responsabilités qui en découlent et les conditions d'application ont plutôt leur place dans d'autres dispositions du code de l'environnement, notamment celles qui sont relatives aux sanctions. Il faudrait retravailler cette question ».
Privilégier des toitures végétalisées valorisant les eaux pluviales
Le texte élargit l'obligation de se doter d'une toiture végétalisée ou productrice d'énergie renouvelable des commerces et des entrepôts. Désormais elle concerne les constructions présentant une emprise au sol de 500 mètres carrés, contre 1000 m2 auparavant. Le texte cible également des immeubles professionnels qui font l'objet d'une rénovation profonde, voire d'une reconstruction.
Toutefois, si dans certains cas, les toitures végétalisées peuvent constituer un des outils disponibles pour une gestion alternative des eaux pluviales au tout tuyau, elles peuvent également, dans d'autres situations, provoquer des augmentations de consommation d'eau potable. « Nous souhaitons le développement des toitures végétalisées, mais en utilisant les eaux pluviales, a indiqué Frédérique Tuffnell, co signataire de l'amendement. Il faut faire preuve de sobriété : je crains qu'il n'y ait demain pléthore de toitures végétalisées consommant de l'eau potable ». Le texte précise donc que seuls les dispositifs végétalisés valorisant les eaux pluviales entrent dans le champ de l'obligation.
Enfin, le projet de loi a souhaité renforcer les sanctions pénales en cas d'atteinte à l'environnement, dont celles qui concernent la ressource en eau. Il propose de créer un délit de pollution des eaux et de l'air et un délit de mise en danger de l'environnement. « S'agissant plus particulièrement des délits de pollution des eaux le nombre d'affaires nouvelles enregistrées par les parquets sur ces contentieux est en diminution sensible au cours des sept dernières années (1009 affaires en 2019 contre 1918 en 2013), révèle l'étude d'impact du texte. Environ 60% des affaires orientées sont dites poursuivables (auteur connu et infraction constituée) au cours de la période, et plus de 90% des affaires poursuivables font l'objet d'une réponse pénale. La réponse pénale est très majoritairement constituée de procédures alternatives (plus de 90%). Les poursuites ne concernant qu'un peu plus d'une affaire sur 10 ».