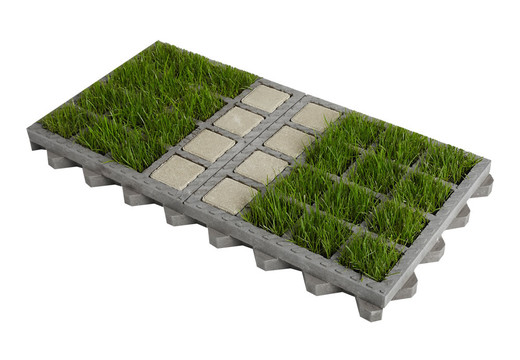Les sénateurs Hélène Masson-Maret (UMP - Alpes-Maritimes) et André Vairetto (Socialiste-Savoie) ont présenté le 4 mars les conclusions de leur rapport d'information (1) visant à "concilier" la protection et le développement économique du patrimoine naturel de la montagne. Les rapporteurs ont été missionnés par la commission du développement durable au Sénat.
Protection des populations…
Le texte de référence concernant les territoires de montagne est la loi du 9 janvier 1985 dite "loi Montagne (2) ". Dans l'esprit de cette loi, le patrimoine montagnard, "exceptionnel mais fragile", doit être protégé mais aussi pouvoir se développer, tout en s'adaptant aux évolutions liées au changement climatique, rappellent les auteurs. "C'est en s'inscrivant dans cette réflexion" qu'ils ont élaboré leur rapport. "Nous avons effectué trois déplacements et procédé à soixante auditions", a souligné Mme Masson-Maret. Le rapport formule 53 propositions "susceptibles d'inspirer le législateur pour les mesures et réformes à mettre en œuvre".
Si près de 30 ans après son entrée en vigueur, la loi Montagne constitue "un texte précurseur du développement durable", les sénateurs soulignent toutefois "la nécessité d'optimiser" les plans de prévention des risques naturels (PPRN) en montagne : 9.575 PPRN ont été approuvés et 3.616 PPRN sont en cours d'élaboration au 1er août 2013. La couverture des zones de montagne est "encore loin d'être aussi complète que l'importance et la multiplicité des risques en altitude le justifieraient", préviennent-ils. "Ce patrimoine est fragile et sensible aux changements climatiques. En montagne, les risques naturels sont accrus : avalanches, crues, feux de forêt", précise Mme Masson-Maret.
Compte tenu à la fois de "la multiplicité et de la dangerosité" des phénomènes naturels en montagne, les sénateurs jugent donc "nécessaire d'encourager l'émergence" de nouvelles stratégies territoriales de prévention des risques. Ces stratégies "devraient s'inscrire dans des processus davantage participatifs", associant les différents acteurs : élus, services de l'Etat, société civile. "Elles devraient aussi recourir à des approches « objectivables », reposant sur une analyse multicritères et socioéconomique des risques, qui croiserait l'état des connaissances scientifiques relatives aux aléas et à la vulnérabilité d'un territoire, avec une vision politique et stratégique du développement territorial", recommandent les rapporteurs.
… et de la biodiversité...
L'hydroélectricité, l'or bleu de la montagne
Le sénateur André Vairetto a souligné "le potentiel" de l'hydroélectricité, "l'or bleu de la montagne". La production d'hydroélectricité est principalement concentrée dans les Alpes (70%), puis dans le Massif central (20%) et les Pyrénées (10%). Elle représente 12% de la production totale d'électricité, avec une capacité de production variant selon les années entre 50 TWh et 75 TWh.
"Un potentiel supplémentaire existe pour la petite hydroélectricité", a indiqué M. Vairetto, estimé à 4 TWh de production annuelle. Le rapport préconise toutefois d'imposer aux exploitants de centrales hydroélectriques de "participer financièrement à l'entretien courant de la végétation du lit des cours d'eau".
Les sites protégés classés Natura 2000 au titre de la directive européenne "Habitats" sont quant à eux "plus fréquents et plus étendus" en zones de montagne. Les parcs naturels régionaux constituent "un bon support pour l'animation du réseau Natura 2000, dans la mesure où leurs deux principaux objectifs sont de valoriser le patrimoine naturel et de concilier sa préservation avec le développement économique", soulignent les rapporteurs. Ils pointent cependant "la difficulté" pour les petites communes de montagne de trouver les financements nécessaires aux actions de restauration. Ils recommandent notamment de recourir aux financements prévus dans le cadre de la politique agricole communautaire (PAC) pour la période 2014/2020, en généralisant dans les sites Natura 2000 les "mesures agroenvironnementales territorialisées".
… à l'exception du loup ?
Le rapport examine également la situation agricole. L'article 18 de la loi Montagne a reconnu l'agriculture de montagne comme "étant d'intérêt général et comme activité de base de la vie montagnarde", rappellent les sénateurs. Mais ces derniers critiquent la surface agricole utile (SAU) des massifs jugée "étroite" (représentant 13% de la SAU nationale) et des coûts d'acquisitions des terres agricoles "très élevés". Le projet de loi d'avenir agricole, en débat au Parlement, prévoit la "reconnaissance d'une politique spécifique à l'agriculture de montagne", en application de la loi Montagne.
Les rapporteurs soulignent également "la prédominance" de l'élevage extensif (brebis, vaches) pratiqué. "Nous souhaitons poser les conditions d'une gestion responsable des prédateurs", a indiqué Mme Masson-Maret. Il s'agit sans "remettre en cause" la présence du loup en France et la préservation de cette espèce protégée d'apporter "une réponse pragmatique et raisonnable à la hausse constatée des attaques de loups, à la désespérance de nombre de nos éleveurs, et à la nécessité fondamentale de protéger l'agro-pastoralisme sur nos territoires", expliquent les sénateurs. Le nombre de victimes indemnisées est passé de 2.680 en 2008 à 4.913 en 2011, dont 95% sont des ovins, soulignent-ils. Les sénateurs soutiennent la proposition de loi, déposée par le sénateur Alain Bertrand (groupe RDSE), visant à créer des "zones de protection renforcée contre le loup" adoptée par le Sénat le 30 janvier 2013.
Ils estiment "légitime" de réintégrer le loup dans l'annexe 3 de la Convention de Berne, au titre d'"espèce protégée simple" alors qu'il est actuellement classé comme espèce "strictement protégée". "Au nom de la Convention de Berne, on ne peut plus rien faire", a expliqué à l'AFP Mme Masson Maret. "Lorsque le préfet prend une décision, les associations (de défense du loup) demandent au tribunal administratif de casser l'arrêté au nom de la Convention. Si le loup est classé en catégorie animal protégé simple, on ne pourra plus aller devant le tribunal administratif", espère-t-elle. Dans le cadre du Plan national Loup, le sénateurs souhaitent "une vraie régulation" du prédateur via la reconnaissance de la possibilité "de tirs de défense plus systématiques" ou l'ouverture "des prélèvements en période d'hiver". "J'ai déjà déposé deux amendements sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture qui reprennent certaines de nos propositions", a annoncé Mme Masson Maret.
Un "Grenelle" de l'immobilier touristique
Le tourisme est "un enjeu économique fondamental pour la montagne", a ajouté le sénateur André Vairetto, caractérisé par "des investissements très lourds" pour le ski. "Depuis des années les stations sont engagées dans une fuite en avant : elles construisent toujours plus pour assurer leur fréquentation", pointent cependant les sénateurs. Ils proposent "un Grenelle de l'immobilier touristique en montagne" qui mettrait tous les acteurs autour de la table "dans une perspective de développement durable. Il est devenu urgent de passer de la construction à la réhabilitation, puis à l'exploitation." Ils recommandent notamment de supprimer les incitations fiscales à l'investissement locatif dans l'immobilier de loisir neuf.
La réduction "tendancielle de l'enneigement naturel ne peut être entièrement compensée en lui substituant de la