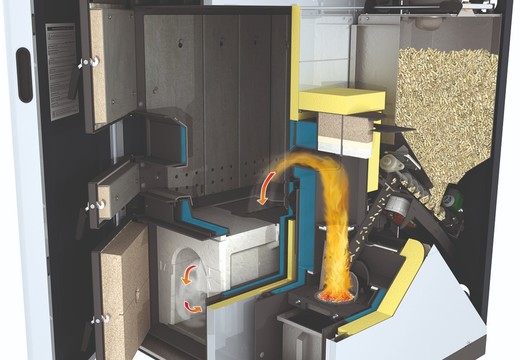Les objectifs de développement de la méthanisation posent la question des intrants nécessaires. Contrairement à l'Allemagne, la France a décidé de limiter le recours aux cultures énergétiques spécifiques pour éviter les conflits d'usage des sols. En revanche, utiliser des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) sera nécessaire pour alimenter les méthaniseurs et compléter les gisements d'effluents d'élevage, de sous-produits de l'agriculture et de déchets verts.
À Cestas, en Gironde, une unité de méthanisation tourne à 100 % avec des CIVE. Inauguré à l'été 2018, le projet Pot-au-Pin a été initié par un producteur de carottes et de poireaux pour la grande distribution et les grossistes, sous la marque Planète Végétal. « Nous avons des terrains non cultivés pendant une période de l'année, un climat doux et une nappe d'eau à proximité. Les cultures intermédiaires permettent d'occuper le terrain et de produire des matières vertes pour la méthanisation », explique Christian Letierce, gérant de Pot-au-Pin. Les CIVE viennent s'intercaler entre les cultures principales et enrichissent le système agricole de l'exploitation. « C'est un cercle économique vertueux », estime François Brethes, responsable maintenance du site.
Du seigle et du maïs ensilage
L'idée s'est imposée assez naturellement : « Notre système de production repose sur la culture de légumes (carottes, poireaux) qui nécessitent des rotations longues, entre quatre et cinq ans. Entre les deux, nous produisons du maïs doux, du haricot vert et du maïs grain. Mais sur la période qui court d'octobre à avril / mai, qui correspond à date des semis, une partie de nos terres est libre », explique Christian Letierce.
Les cultures intermédiaires permettent à la fois d'occuper ces terres et de produire l'intrant pour le digesteur. À partir de 2016, deux années de tests ont été menées sur différentes cultures : l'orge, l'escourgeon (orge d'hiver) et le seigle. Le choix s'est finalement porté sur ce dernier : « Le seigle produit plus de matières vertes lorsqu'on le récolte à un stade d'immaturité. Il se sème à partir du 15 septembre et se récolte de mi-avril jusqu'à début mai, pour une récolte à 30 % de matières sèches ». Après plus d'un an de fonctionnement, les retours sont positifs : « Cette culture s'est bien insérée dans notre système agricole. Quelques surfaces de maïs grain ont été réduites pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, nous réalisons deux récoltes de CIVE par an : le seigle en avril-mai et le maïs ensilage fin octobre, en complément de la culture de l'escourgeon destinée aux animaux ».
Une station GNV installée à proximité
Des avantages agronomiques à consolider
Les cultures intermédiaires présentent de nombreux atouts environnementaux et agronomiques. Elles permettent de réduire les pertes de nitrate vers les masses d'eau, de lutter contre l'érosion des sols, de fixer l'azote dans les sols (légumineuses notamment), de stocker les matières organiques et le carbone dans les sols, ou encore de gérer les adventices. Le choix de la variété de CIVE dépendra du calendrier de semis et de récolte des cultures principales, de la production en biomasse, des besoins hydriques de la plante et de sa résistance aux pressions (ravageurs, maladies…). L'objectif est d'obtenir le plus de biomasse possible au moindre coût, sans toucher les cultures principales et en garantissant l'amélioration des services écosystémiques. De nombreux travaux sont actuellement menés par l'Inrae, les chambres d'agriculture, les instituts techniques… pour déterminer les meilleures pratiques et variétés selon les systèmes de production.
Après de nouveaux investissements, le méthaniseur devrait ingérer 20 000 tonnes par an et produire 250 Nm3/h d'ici fin juin. Soit 23 GWh/an. « En 2020, nous serons producteurs nets d'énergie », se félicite Christian Letierce.
Le biogaz produit, composé à 53 % de méthane, est épuré puis injecté dans le réseau et alimente, en partie, une station multi-énergies construite à 3 kilomètres de là par Air Liquide, partenaire du projet. « Nous sommes dans un secteur où il y a beaucoup d'industriels ». Carrefour, notamment, y a ses bases logistiques. L'enseigne de la grande distribution s'est fixé pour objectif de réaliser 40 % de sa logistique au bioGNV d'ici 2025. « Aujourd'hui, la station dessert 40 camions par jour. Mais le méthaniseur produit de quoi faire le plein de 100 camions par jour, et bientôt, le double », détaille Christian Letierce.
Des gains d'un point de vue agronomique
Grâce à un contrat de rachat sur quinze ans, l'installation est aujourd'hui proche de l'équilibre. Les trois à quatre heures de travail quotidien nécessaire pour le méthaniseur sont réalisées en interne (remplissage des trémies, rondes de sécurité, enregistrement de données quotidiennes – obligation ICPE -, entretien technique…).
Après son passage dans le méthaniseur, « une tonne de matière sèche permet de produire 1 m3 de digestat riche en matières organiques et en fertilisants (potasse, azote ammoniaqué, oligoéléments…), qui sert à amender nos cultures. Cela devrait nous permettre de réduire de 40 % notre dépendance aux engrais », estime Christian Letierce.
Un système gagnant-gagnant donc pour cette exploitation labellisée Haute valeur environnementale (HVE), c'est-à-dire qu'elle a atteint le troisième et dernier niveau de cette démarche environnementale.