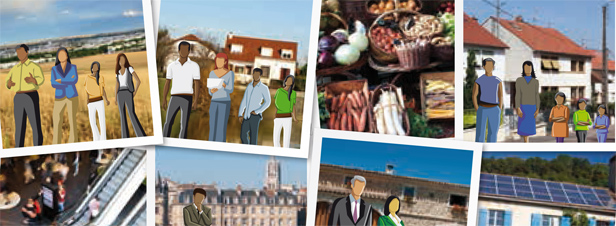Quels pourraient être les modes de vie des Français en 2050, si la France divise par deux sa consommation énergétique finale en 40 ans ? C'est à cette question que tente de répondre le troisième volet du scénario énergétique (1) de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) pour 2030-2050.
Après avoir présenté lors du débat national sur la transition énergétique ses scénarios énergétiques, construits notamment autour d'une réduction de la consommation d'énergie finale de 150 à 80 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) entre 2010 et 2050, puis l'évaluation macroéconomique de ces scénarios, l'Ademe a publié, jeudi 12 juin, un troisième volet portant sur les modes de vie des ménages français qui seraient compatibles avec ceux-ci.
"Il montre l'hétérogénéité des modes de vie possibles dans un avenir basé sur un système énergétique sobre (…) et fortement renouvelable", indique l'Ademe, précisant que le document de quelque 130 pages décrit le quotidien de 16 familles vivant en 2030 et en 2050. L'une des principales conclusions est la relation entre les choix techniques et leur appropriation par les ménages. "Il est clair que, sans progrès de comportement et de sobriété, une grande partie des gains d'efficacité énergétique seraient perdus à travers un relâchement des attitudes au quotidien", explique l'Ademe, ajoutant que "le facteur 4 pour l'ensemble du pays n'est pas atteignable sans progrès décisif des comportements individuels".
Approche empathique
Pour cette étude, l'Ademe "a fait le choix de s'éloigner d'une présentation technique de scénario (…) pour basculer vers une forme rédactionnelle assez littéraire qui permette de s'immerger dans les conditions de vie des familles", explique le document, précisant que "pour rendre le plus sensible possible les modes de vie, des préférences, des choix particuliers, des éléments de personnalités contrastés ont été attribués aux ménages ainsi mis en scène". En conséquence, l'étude adopte une approche empathique, qualifiée d'"indispensable", différente de l'approche technique des scénarios énergétiques.
L'analyse applique aussi une approche par catégorie de consommation qui permet, en s'appuyant sur l'empreinte énergie et carbone, de ramener les consommations d'énergie au niveau des ménages. Elle retient neuf usages : l'alimentation, le confort résidentiel, les produits de consommation hors alimentation et électronique de loisirs, les services, la santé, les loisirs de proximité et les vacances, le relationnel, et notamment l'éducation, l'information, le multimédia, la téléphonie, l'internet, les relations avec la famille et les amis, les déplacements liés au travail et enfin les consommations en amont de l'industrie lourde qui ne sont pas intégrées dans une des huit autres catégories de consommation.
D'un point de vue méthodologique, l'étude s'appuie sur cinq règles. Tout d'abord, elle cherche à "prospecter les diverses formes futures de satisfaction des personnes au-delà des formes actuelles très tournées vers la consommation". Ensuite, elle recherche une cohérence entre les situations à vivre, le profil des personnes et leurs options de modes de vie. Troisième point, l'étude explicite les politiques publiques qui aident les acteurs à réaliser leur propre transition énergétique. Par ailleurs, l'analyse applique un principe d'équiprobabilité des modes de vie, c'est-à-dire qu'elle n'exprime pas de préférences envers l'un ou l'autre des modes de vie possibles. Enfin, les situations présentées font l'objet d'une évaluation en termes de consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre (GES).
Quant au cadrage économique et démographique, il a été réalisé à partir des hypothèses du Commissariat général à la stratégie et à la prospective et de l'Insee. Ainsi, la France de 2050 compte 72 millions d'habitants et la croissance moyenne entre 2010 et 2050 est de 1,8% par an. Par ailleurs, elle retient des hypothèses technologiques "en évitant toute tentation de science-fiction", une forte réduction du chômage du fait du taux de croissance retenu et un resserrement des écarts de revenus.
Transports et logements au cœur de la transition
Qu'en est-il des résultats ? Au-delà des fiches décrivant la vie des types de famille retenus, l'Ademe dresse certains constats.
Concernant le logement, "les progrès d'efficacité énergétique [sont] déterminants", rappelle l'étude, confirmant que "la réalisation de travaux de réhabilitation n'est pas d'un accès aussi facile pour chacune des familles". Au-delà de l'évidence, cet aspect implique que "tous les ménages n'auront pas pu réaliser les travaux nécessaires, tandis que les prix des énergies seront orientés à la hausse". En matière de transports, les ménages en zone rurale et en banlieue peu dense pâtissent d'"un net handicap" du fait de la dépendance à la voiture, handicap d'autant plus grand que les personnes sont âgées.
Au niveau des vecteurs énergétiques, l'Ademe note "le poids croissant des consommations d'électricité, surtout celles liées aux appareils électroniques de loisirs, de communication et de gestion". Cette évolution "nécessite à la fois la diffusion des techniques de gestion de pointe et des choix et comportements individuels qui en tiennent compte" si l'on souhaite contenir la hausse des prix de l'électricité. Bien sûr, l'étude envisage la possibilité que les ménages produisent pour partie leur énergie. En l'occurrence, "les capacités de valorisation des énergies renouvelables sont très variables selon les localisations géographiques, avec, dans ce cas, un avantage à la maison individuelle".
Enfin, l'étude pointe une grande diversité des modes de vie permettant de réaliser la transition énergétique. Elle liste en particulier six modes de sobriété différents, allant de la sobriété par des modes de vie simples, à la sobriété liée à une éthique, en passant par la sobriété associée à une gestion rigoureuse du budget ménager et la sobriété liée à l'usage des objets plutôt qu'à leur possession.