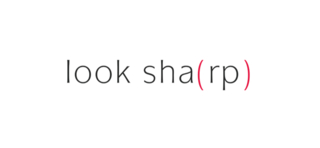© Pamanes
Alors, le commerce international devrait-il s'organiser au sein d'accords sectoriels collaboratifs entre Nord et Sud, mettant en avant des échanges de technologies propres ? Ces accords sectoriels permettraient, selon Philippe Quirion, économiste et chercheur au CIRED (Centre international de recherche sur l'environnement et le développement), de ne pas assujettir les pays du Sud à un marché carbone ou à des taxes qu'ils refusent, au nom du principe de responsabilités communes mais différenciées de la Convention climat de Rio (1992). Ils auraient un effet direct sur les émissions des grandes centrales électriques qui bénéficieraient de technologies efficientes, sans contraindre directement les pays du Sud à réduire leurs émissions, ce qu'ils refusent formellement au nom de la dette écologique des pays du Nord.
Mais la piste la plus efficace, rendue toutefois impossible par les règles des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ne serait-elle pas d'instituer un protectionnisme vert là où il s'agirait d'infléchir le comportement polluant des entreprises ? L'internationalisation croissante des échanges suscite des craintes de « dumping environnemental » via la délocalisation des industries les plus polluantes vers des pays aux normes environnementales sinon inexistantes, du moins plus souples. Le débat sur la conformité des écolabels ou d'une taxe verte avec les règles du commerce international est devenu récurrent. L'OMC s'est même récemment prononcée en faveur de la conformité entre accords sur le commerce international et imposition de droits d'importation en cas de concurrence déloyale. La France apparaît favorable à l'instauration de mesures d'ajustement aux frontières. Elle prône la répercussion des coûts substantiels pour les secteurs internationaux à forte intensité énergétique sur les pays produisant à moindre coût en l'absence de contraintes environnementales. Pour Hélène Ruiz Fabri, professeur à l'université Paris I-Panthéon Sorbonne, ''le hiatus est toujours le même : comment injecter la solidarité qu'exige une cause commune dans un système fondé sur la théorie des avantages comparatifs et donc sur la seule compétition ? Facile, dira-t-on, de questionner le système. L'interrogation est si fondamentale qu'elle en devient irréaliste, et, de ce fait, revient implicitement à justifier le maintien de ce qu'elle prétend mettre en cause. On persistera pourtant à croire qu'il n'est pas inconcevable d'engager quelques petits pas, de commencer à réfléchir vraiment en termes de redistribution, et notamment de transferts de technologie. Il ne suffit pas de dire qu'on y pense et qu'en attendant ce sera du protectionnisme, faute de mieux, mais vert''. Il ne sera plus possible de satisfaire tous les intérêts en même temps et il faudra bien questionner les piliers du système. Pour le moment, dans l'état d'esprit de l'OMC, le protectionnisme n'est pas un objectif légitime.
Alors, puisque les marchandises circulent selon les règles du libre-échange, les hommes exilés de leur terre par la dévastation des cyclones, la montée des océans ou l'avancée du désert pourront-ils, eux aussi, se voir reconnaître un droit à la mobilité ? C'est la question envisagée par Bettina Laville, membre de la Commission sur le Grand Emprunt, à qui le gouvernement a commandé un rapport sur le statut juridique des réfugiés climatiques. Cette avocate pose la question de la nationalité des personnes dont le territoire a disparu. Celles-ci seront un milliard en 2050, dans le scénario le plus pessimiste, qui, selon le PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) met en cause la sécurité mondiale. De fait, le Conseil de sécurité de l'ONU a ouvert le dossier en 2007, alors qu'il s'occupe traditionnellement de conflits avérés. Aucune enceinte existante n'est appropriée, et, selon Mme Laville, ''ces réfugiés sont le non objet de Copenhague''. Il reste donc à créer un statut d'éco-réfugié, aussi pertinent désormais que celui de réfugié politique.
Article publié le 11 décembre 2009