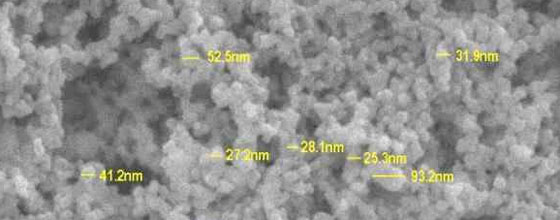
© www.nano-nik.com
Parce que leur degré de dangerosité reste impossible à évaluer, les nanotechnologies sont classées à part par les assureurs. En l'état actuel des incertitudes, les nanomatériaux ne peuvent être couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile. Les protocoles d'évaluation des risques toxicologiques et éco-toxicologiques actuellement approuvés par l'OCDE ne sont pas encore capables de déterminer le degré de dangerosité de certains nanomatériaux.
Communication cosmétique
Face à ces incertitudes, les entreprises sont partagées. Une étude réalisée par Novethic a cherché à analyser la transparence d'une centaine d'entreprises européennes cotées en bourse et concernées par le sujet. Diffusée le 15 septembre, elle montre que 54% des entreprises, évaluées à partir de leur communication publique via le web, ne disent rien sur les nanotechnologies. Un silence qui concerne surtout les secteurs cosmétique et agroalimentaire, et s'explique par différentes causes : cadre réglementaire flou, contradiction avec le parti pris de responsabilité sociale et environnementale, risque d'image et de réputation.
Pour mieux comprendre les ressorts de ce silence, l'étude de la filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations propose une analyse détaillée de la communication de Danone et du constructeur automobile PSA, deux entreprises qui n'évoquent pas le sujet dans leurs documents externes. Le groupe PSA affirme clairement que son silence ne signifie pas qu'il n'utilise pas de nanotechnologies, mais que sa communication préfère mettre l'accent sur sa capacité à développer la voiture du futur.
Contrairement aux secteurs de l'alimentation et des cosmétiques, les produits PSA comportant des nanotechnologies, ne sont pas en contact avec le corps humain. Pour ce groupe, il ne s'agit donc pas d'un sujet sensible. En charge de la communication « corporate » de PSA, Sandrine Raphanaud n'exclut pas d'envisager la question sous l'angle du développement durable, ''si l'utilisation des nanomatériaux permettait de réduire de 200 kg le poids d'une voiture''.
Si Danone axe sa communication sur le développement durable, son site web ne permet pas de savoir si l'entreprise utilise ou non des nanotechnologies et, si tel est le cas, jusqu'où elle fait volontairement le choix de ne pas en parler. Elle y fait allusion dans son rapport développement durable 2009, à propos d'un programme destiné à réduire le poids et la quantité des emballages. Elle explique ''utiliser une technologie qui injecte de l'air dans les plastiques de façon à réduire leur densité et le volume de CO2 qu'ils contiennent'', tout en précisant que ces avantages ne dégradent en rien la sécurité alimentaire du produit contenu.
Plusieurs entreprises sont tenues de communiquer sur leur utilisation des nanotechnologies, car leurs produits sont en contact direct avec le corps humain, par ingestion ou application sur la peau. C'est le cas de l'Oréal, qui utilise des nanoparticules dans certains de ses produits de soins corporels, mais leur préfère le terme de particules ultrafines dans un de ses rapports. L'Oréal ne fournit pas la liste des produits qui contiennent des nanomatériaux, mais ses rapports mentionnent l'utilisation de certains types de nanomatériaux génériques comme le dioxyde de titane. Une estimation de 2008 valorise à 600 millions de dollars les investissements de l'Oréal dans les nanotechnologies à travers 192 nano-brevets.
La chimie décomplexée
Au bout du compte, seuls les industriels de la chimie assument une communication sur le sujet. Selon l'étude de Novethic, trois entreprises seulement développent une communication approfondie sur la question des nanotechnologies. Il s'agit de Bayer, BASF, compagnies allemandes, et de la française Arkema, qui appartiennent toutes au secteur chimique. L'industrie chimique est, de fait, productrice de la plupart des matériaux à base de nanotechnologies : nano-tubes de carbone, nano-oxydes de zinc et d'aluminium et autres nanoparticules. Les entreprises du secteur cherchent à construire une communication adaptée, voire à banaliser les nanos afin de, certainement, peser sur les réglementations à venir.
Citée en exemple, Arkema a fait le choix d'être transparente dès le démarrage des travaux réalisés autour d'un nouveau produit : un nanotube de carbone, dont l'usine de production pilote, inaugurée en 2006 à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), fabriquera jusqu'à 400 tonnes par an. Comme l'indique son site web, Arkema estime que l'industrie chimique contribuera à un monde meilleur en proposant des solutions pratiques aux défis planétaires : batteries lithium-ion, avions plus légers résistant à la foudre... Arkema vient d'annoncer un partenariat avec le CNRS de Toulouse autour de la création du premier laboratoire mixte public-privé dédié à l'étude de l'évolution des nanotubes de carbone en milieu aquatique. Une bonne initiative… mais au risque d'être à la fois juge et partie.







