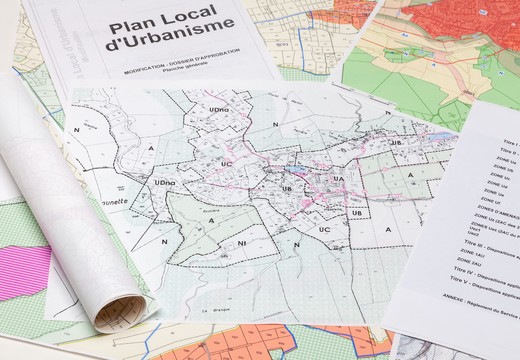Le 6 janvier, le Conseil national de la transition énergétique (CNTE) a fait le point sur les travaux de modernisation du droit de l'environnement, initiés lors des Etats généraux en 2013. Afin de poursuivre les réflexions, une commission spécialisée et sept groupes de travail ont été installés par Ségolène Royal en septembre dans le cadre du CNTE. Leur objectif : améliorer les procédures existantes, afin de renforcer la sécurité juridique des projets, raccourcir les délais d'instruction tout en maintenant un niveau élevé de préservation de l'environnement.
Mais alors que la contestation s'amplifie face à de nombreux projets locaux (NDDL, Sivens, Roybon …), François Hollande a insisté, lors de l'ouverture de la Conférence environnementale, sur l'importance du dialogue environnemental et a indiqué vouloir renforcer la concertation autour des projets.
Un des sept groupes de travail installés en septembre, et présidé par Gérard Monédiaire, portait justement sur la participation du public. Il a présenté le 6 janvier de premières propositions d'amélioration et un premier échange a eu lieu sur le sujet au sein du CNTE. Ces réflexions seront poursuivies, en vue d'intégrer de premières évolutions législatives dans le projet de loi sur la biodiversité, qui devrait être examiné par le Parlement en mai. Un projet de loi spécifique pourrait également voir le jour si nécessaire. Premiers éléments de réflexion.
Consulter en amont et étudier les alternatives
Le constat est partagé par tous : il faut améliorer la participation du public. "Beaucoup de situations conflictuelles sont liées à un problème de légitimité des décisions. Les citoyens ne sont pas assez consultés, les préoccupations à long terme ne sont pas assez prises en compte", analyse Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public (CNDP). Il pointe également du doigt la longueur et la multiplication des procédures. La mission Monédiaire a elle aussi dénoncé un "maquis procédural" et appelé à une simplification.
Autre faiblesse : les citoyens sont consultés tard, lors de l'enquête publique, c'est-à-dire lorsque le projet est déjà bien avancé. Le groupe de travail du CNTE préconise d'aller vers une participation en amont, "à un stade où il est encore possible de faire évoluer sensiblement les projets, voire, pour les projets publics, de discuter de leur finalité et de leur opportunité". C'est également une demande de la Fondation Nicolas Hulot : "Sur Notre-Dame-des-Landes, Sivens… les alternatives n'ont pas été sérieusement étudiées. Il faut consulter en amont, lorsqu'il est encore possible d'examiner les différentes options", estime Matthieu Orphelin. A ceux qui craignent un allongement des procédures, il répond : "Une bonne concertation et une bonne étude des alternatives sont les gages d'un projet réussi".
De nouveaux outils de démocratie participative
Par quels moyens associer les parties prenantes et les citoyens à la définition des projets ? "Le constat est fait qu'en France, à la différence d'autres pays, il n'existe pas de culture de la participation. Cela vaut également pour les maîtres d'ouvrage", note le groupe de travail.
La FNH a publié, en 2013, un guide des outils de démocratie participative (1) . "Il faut des forums, des assemblées, des jurys citoyens tirés au sort… pour encourager et aider la participation publique", estime Matthieu Orphelin.
La CNDP, qui a testé récemment les conférences de citoyens autour du projet Cigéo, préconise la mise en place d'une autorité indépendante, qui pourrait être saisie par les citoyens et leurs représentants, pour organiser un débat public en amont.
Le Président de la République, lors de la Conférence environnementale, a également évoqué la possibilité d'organiser des référendums locaux. Christian Leyrit y est favorable pour "débloquer les situations conflictuelles" mais pas en substitution du débat public.
Mais "pourquoi attendre le blocage ?", s'interroge Matthieu Orphelin. "Le référendum peut être organisé tôt, à condition que les citoyens soient éclairés".
Pour Alain Richard, président de la commission spécialisée sur la modernisation du droit, "la question du référendum reste à approfondir. Le code des collectivités prévoit qu'elles peuvent en organiser lorsque le sujet relève de leurs compétences. Mais de nombreuses questions subsistent : faut-il revoir la législation, associer l'Etat, quels périmètres définir pour ces référendums locaux ?". Un projet comme celui de Bure peut-il être simplement considéré comme local ?
Les conditions de la réflexion en question
Enfin, les Amis de la Terre ont regretté que les mouvements citoyens contestataires ne soient pas associés à ces réflexions : "Il ne faut pas rester sur des débats d'experts, où le CNTE mène la danse. Pour parler de l'opposition à ces projets, nous, ONG, ne sommes pas légitimes, et encore moins le CNTE", estime Florent Compain, président de l'association. Un constat partagé par Christian Leyrit : "Il y a une attente très forte des citoyens, qui ne se sentent pas représentés par les associations et les syndicats".
Autre inquiétude des ONG : le projet de loi Macron, qui prévoit que le gouvernement prenne par ordonnance des mesures législatives pour réformer l'étude d'impact et l'enquête publique. Interpellée par plusieurs membres du CNTE, la ministre de l'Ecologie a affirmé que les projets d'ordonnances seraient présentés au CNTE, ce qui n'a pas été le cas pour le projet de loi.