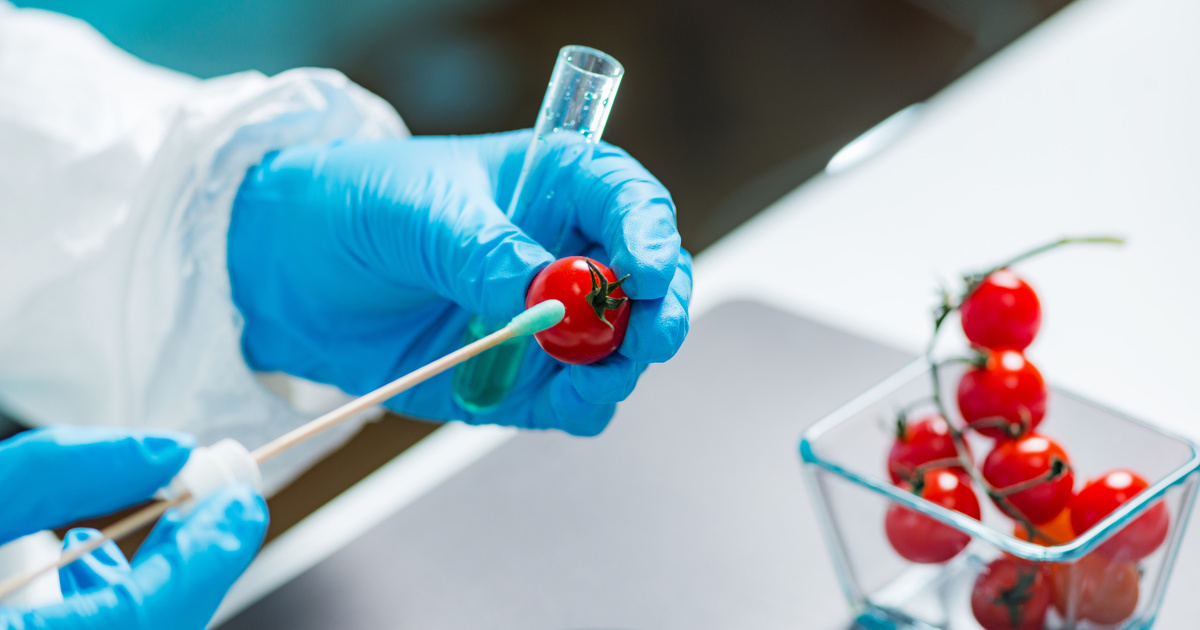La transparence se suffit-elle à elle-même ? Au regard de ce que l'État français et même l'Agence européenne de sécurité alimentaire (Efsa) rendent publique s'agissant de la présence de pesticides dans les denrées alimentaires, la réponse est plutôt négative. Même déconstruite, la diversité de la taille et des caractéristiques des échantillonnages sur lesquels se basent toutes les analyses rendent cette volonté de transparence plus opaque et confuse qu'il n'y paraît.
Le brouillard s'éclaircit en France
« L'information est publique et accessible, lorsqu'elle est demandée, mais elle n'est pas communiquée comme il se doit », souligne François Veillerette, porte-parole de Générations futures. Le 30 mars dernier, l'association a publié les résultats (1) du dernier plan annuel de surveillance de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Les données que cette dernière a fournies directement à l'association portent sur les taux de détection et de quantification de résidus de plusieurs centaines de pesticides dans une liste de produits alimentaires d'origine végétale prélevés au hasard dans le commerce. Et pour la première fois, la provenance des quelque 2 500 échantillons, analysés en 2020, a été précisée : agriculture biologique ou conventionnelle (non bio). « La présentation des résidus de pesticides dans les aliments végétaux par l'ancienne méthode utilisée jusqu'alors sous-estimait grandement le pourcentage réel d'aliments non bio contenant des résidus de pesticides, explique François Veillerette. Les échantillons prélevés en 2019 et 2020 fournis par la DGCCRF nous permettent aujourd'hui de présenter un pourcentage d'aliments végétaux non bio contenant au moins un résidu de pesticides plus proche de la réalité. »
Une complexité accrue sur le plan européen
D'autant que la publication la plus récente en la matière de la part des autorités elles-mêmes rend l'affaire encore plus floue. Le même 30 mars 2022, l'Efsa a dévoilé le rapport (2) du Programme européen pluriannuel de contrôle coordonné des pesticides (EU MACP) pour l'année 2020. Ce dispositif réunit les collectes des 27 États membres de l'Union européenne ainsi que celles de la Norvège et de l'Islande. Ces données, chiffrées à 88 000 échantillons au total, s'appuient sur des produits agricoles ou alimentaires d'origine végétale et animale vendus aux consommateurs, en provenance du pays collecteur-contrôleur comme de l'étranger. L'échantillonnage peut donc varier en fonction de chaque contribution nationale. Pour le savoir, concernant par exemple la France, il faut cependant passer par des chemins de traverse. Le rapport évoqué, l'information la plus accessible délivrée au public, peut facilement induire en erreur.
En effet, la communication de l'Efsa se focalise presque uniquement sur les résultats d'un sous-ensemble de 12 000 échantillons choisis au hasard d'une liste de douze produits alimentaires, dont la carotte, le chou-fleur, le kiwi ou encore le foie de bœuf. Selon cette analyse, plus de 68,5 % des produits sont en-dessous des limites de quantification (LQ) et 29,7 % au-dessus - le niveau de détail de l'Efsa ne prenant pas en compte la limite de détection (LD). Seulement 1,7 % s'avère au-dessus des limites maximales réglementaires (LMR). Pour comparer ces chiffres à la moyenne européenne du corpus complet (88 000 échantillons) ou aux données françaises, le rapport global de l'Efsa ne suffit pas. Il faut se tourner vers deux autres sources : une déclinaison graphique (3) , partielle et absconse, des données de l'Efsa et le « National Summary Report » du Programme national pluriannuel de contrôle des pesticides (MANCP (4) ), qui détaille (presque) toutes les données fournies par chaque pays en 2020 et qui sont reprises dans le cadre de l'EU MACP.
Les soucis du détail

D'autre part, concernant les données fournies par la France dans le cadre du MANCP 2020, l'histoire se brouille encore d'un cran. Si l'État présente aux Français – sous certaines conditions, décrites plus haut – son analyse nationale en se basant uniquement sur le plan de surveillance de la DGCCRF, ce n'est pas ce qu'elle rend compte sur le plan européen. Les données françaises, détaillées dans le « National Summary Report » 2020 de l'Efsa, proviennent autant de la DGCCRF que de la direction générale de l'Alimentation (DGAL). Cette dernière collecte seulement les produits agricoles avant leur éventuelle transformation et leur vente aux consommateurs. La France a ainsi fourni un total de 7 830 échantillons issus de :
L'analyse de l'UFC-Que choisir
À quelques jours des rapports de l'Efsa et de Générations futures sur les résidus de pesticides dans l'alimentation, l'Union fédérale des consommateurs (UFC-Que choisir) a transmis sa propre analyse sur le sujet. Se basant sur un ensemble de 14 000 échantillons (d'origine animale ou végétale, bio ou non bio) collectés, en 2019, par la DGCCRF et la DGAL, elle a présenté les taux moyens de détection (LD) et de quantification (LQ) de 150 pesticides qualifiés de perturbateurs endocriniens ou considérés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) même à très faibles doses ou par effet cocktail. Son analyse porte plus précisément sur un sous-ensemble de 5 000 produits végétaux issus de l'agriculture conventionnelle, « ceux pour lesquels les données étaient les plus solides », précise l'association. Résultat : 51 % présentent les traces (LD) d'au moins un pesticide CMR et 30 % d'au moins deux, pour une LQ moyen de 43 %. « La réglementation actuelle ne permet pas de garantir l'absence de risque dans les aliments, en déduit l'UFC-Que choisir. Ses contrôles tiennent essentiellement compte des limites maximales de résidus autorisés (LMR). Cette conformité est une notion obsolète qui n'offre pas de protection suffisante. »
- La DGAL : un plan annuel de surveillance (produits végétaux), un plan de contrôle des produits animaux, un plan de contrôle des produits végétaux et un plan de contrôle de produits végétaux et animaux prélevés en Guadeloupe et en Martinique, consacré exclusivement au chlordécone.
De cette ribambelle d'échantillonnages, aucun ne précise l'origine, bio ou non bio, des denrées collectées.
Pour connaître les résultats nationaux obtenus grâce à ces plans de surveillance, il faut revenir aux infographies de l'Efsa déjà citées. D'après ces dernières, 72,8 % des 7 380 échantillons français comportent des résidus de pesticides en dessous des limites de quantification (donc entre LD et LQ) et 27,2 % au-dessus. Le LMR moyen français est, quant à lui, de l'ordre de 4,57 %. Là encore, Générations futures regrette une telle disparité dans les échantillonnages et les analyses qui en découlent. Les conclusions restent similaires : le LMR moyen reste proche des 5 %. L'information brute sur laquelle elles s'appuient peut néanmoins changer du tout au tout en l'inspectant de plus près.
L'association ne se lamente pas pour autant, mais elle milite pour une plus grande clarté à l'avenir, rappelant la dangerosité de certaines des substances analysées même à l'état de traces (5) . « Savoir si les résidus de pesticides dépassent ou non les limites légales dans nos denrées alimentaires est nécessaire, mais il n'est pas inintéressant de savoir également si nous en détectons, tout simplement, conclut son porte-parole, François Veillerette. Certaines de ces substances constituent des perturbateurs endocriniens même à de très faible concentration. Par conséquent, rendre l'information la plus claire et visible possible doit être un principe à respecter. »