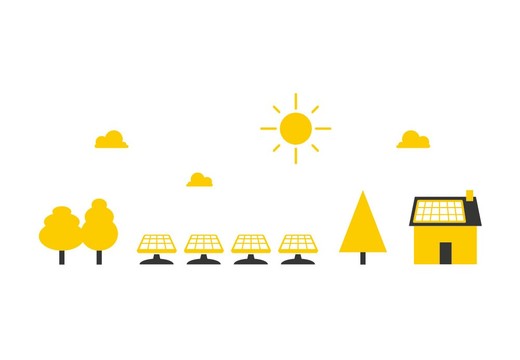Le sujet est sensible. Quel est l'impact sur la biodiversité des parcs photovoltaïques ? C'est à cette question que cherche à répondre une étude initiée par Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire, en partenariat avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER), les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, accompagnés par l'Ademe. Réalisée par deux bureaux d'études, I Care & Consult et Biotope, les résultats (1) de la première phase de cette étude ont été rendus publics ce mardi 23 mars.
Cette dernière a consisté à documenter les effets spécifiques des centrales photovoltaïques au sol sur la faune et la flore dans les trois régions « en traitant les données issues d'un échantillon de parcs photovoltaïques en exploitation et sur la base de documents existants ». Ces documents sont les études d'impact réalisées avant construction et les rapports de suivi naturalistes réalisés après.
Verdict ? « Ce travail infirme l'idée reçue selon laquelle les centrales solaires seraient systématiquement néfastes pour leur environnement », se félicitent les deux syndicats dans un communiqué. « Ces premiers résultats sont encourageants pour permettre aux développeurs de maximiser les effets bénéfiques sur la biodiversité de leurs parcs », tempère toutefois Daniel Bour, président d'Enerplan.
Résultats difficilement lisibles
En effet, les résultats ne sont pas aussi satisfaisants que le laisse entendre la première réaction des syndicats. De plus, ils restent parcellaires et sont difficilement lisibles car les auteurs croisent quatre composantes biologiques (flore, papillons, reptiles, oiseaux), deux analyses temporelles (analyse avant/après construction, analyse de suivi après la mise en service des parcs) et trois paramètres d'analyse (richesse spécifique (2) , patrimonialité (3) , valence écologique (4) ).
Méthodologie de l'étude
Les auteurs ont étudié 316 documents se rapportant à 111 parcs photovoltaïques dans les trois régions partenaires, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. La méthodologie et les résultats de l'étude ont été soumis à l'avis critique d'un comité d'experts, indiquent les auteurs sans toutefois en préciser la composition.
« Pour la flore, les effets du parc sont souvent liés à l'apparition de nouvelles espèces, généralement pionnières, voire invasives », constate l'étude. Les auteurs ont constaté que la tendance d'évolution variait en fonction du contexte écologique et l'état initial du site. Autrement dit, plus cet état initial est dégradé, plus l'évolution est positive. À l'inverse, si le milieu est en bon état, il y a davantage de situations où la patrimonialité et la valence écologique baissent ou restent au même niveau.
Pour les papillons de jour, des tendances d'évolution positives sont constatées pour la richesse spécifique. Ces tendances sont en revanche minoritaires pour la patrimonialité et la valence écologique. Quant aux reptiles, les tendances sont majoritairement négatives. Là aussi, elles sont moins mauvaises si l'on part de très bas en termes de qualité de milieu. Les auteurs relèvent par ailleurs que l'adaptation des projets afin de maintenir les zones favorables aux espèces à forte valeur patrimoniale porte ses fruits.
Une analyse plus approfondie nécessaire
Face à ces constats, les bureaux d'études formulent une série de recommandations pour améliorer la stratégie globale de suivi environnemental. Ces résultats ne constituent en effet que la première phase de l'étude et les auteurs en soulignent les limites : courte durée de l'étude (un semestre), échantillon de parcs limité, exploitation de documents existants et fournis volontairement. « Cette première phase présente le mérite d'agréger des connaissances jusque-là éparses », explique Richard Loyen délégué général d'Enerplan.
La deuxième phase va durer deux ans (2021-2022) sur un périmètre élargi (national plutôt que régional) et avec une analyse plus approfondie, annoncent les partenaires. « À l'issue de ce travail, des conclusions pourront être tirées sur l'effet des parcs photovoltaïques sur la biodiversité, et des recommandations sur les pratiques à destination de la filière et des services instructeurs seront rédigées », ajoutent-ils.
D'ores-et-déjà, il paraît manifeste que l'implantation des parcs devrait être réalisée en priorité sur des milieux déjà artificialisés ou à faible valeur écologique.