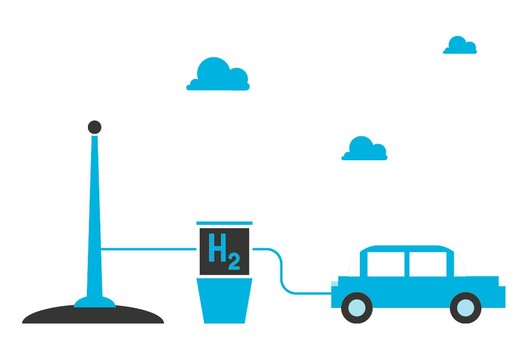Le décret du 29 décembre 2017, qui donne aux préfets le droit de déroger à certaines normes, notamment environnementales, a suscité l'inquiétude des ONG et des juristes spécialisés. Par une décision (1) du 17 juin 2019, le Conseil d'Etat rejette le recours des Amis de la Terre qui réclamaient son annulation.
Le décret en cause donne la possibilité à certains préfets de déroger, de façon ponctuelle pour la prise d'une décision individuelle, à "des normes arrêtées par l'Administration" pendant une période expérimentale de deux ans. Les préfets peuvent user de cette possibilité de dérogation pour prendre des décisions non réglementaires dans plusieurs domaines parmi lesquels figurent l'environnement, l'agriculture, les forêts, l'aménagement du territoire, la politique de la ville, la construction, le logement ou encore l'urbanisme.
Cette faculté donnée aux préfets a été utilisée plus d'une soixantaine de fois, tous domaines confondus, depuis la publication du décret. Dans le champ environnemental, elle a notamment permis de soustraire un parc éolien à la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique, de délivrer un permis de construire à une usine de méthanisation située dans une zone bleue (aléa faible ou moyen) d'un plan de prévention du risque inondation (PPRI), ou de délivrer un agrément pour traiter des véhicules hors d'usage (VHU). Cette possibilité de dérogation a aussi permis de construire plus rapidement une digue à La-Faute-sur-Mer et de mener à bien des travaux de restauration de cours d'eau en dérogeant au régime d'autorisation requis par la loi sur l'eau.
"Une souplesse inédite donnée au gouvernement"
Les Amis de la Terre avaient estimé que cette expérimentation méconnaissait l'article 37-1 de la Constitution, qui autorise les expérimentations. Selon le Conseil d'Etat, il résulte de cet article que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, autoriser des expérimentations permettant de déroger à des normes à caractère réglementaire sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi dès lors que "ces expérimentations présentent un objet et une durée limités et que leurs conditions de mise en œuvre sont définies de façon suffisamment précise". Si le décret attaqué ne désigne pas précisément les normes réglementaires auxquelles il permet de déroger, relève la Haute juridiction, il limite ces dérogations, "d'une part, aux règles qui régissent l'octroi des aides publiques afin d'en faciliter l'accès, d'autre part, aux seules règles de forme et de procédure applicables dans les matières énumérées afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures". Enfin, il ne permet une dérogation que sous conditions qu'elle réponde à un motif d'intérêt général, qu'elle soit justifiée par les circonstances locales, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
"Le décret contesté, dont le champ et la durée d'application sont limités, n'autorise, dans le respect des normes supérieures, que des dérogations dont l'objet est limité et dont les conditions de mise en œuvre sont définies de façon précise", conclut le Conseil d'Etat qui en déduit que le texte ne méconnaît ni les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution, ni la loi. "Contrairement à ce que dit le Conseil d'Etat, le champ d'application de la dérogation n'est pas limité dans son objet", réagit Louis Cofflard, avocat des Amis de la Terre, qui se dit très déçu par cette décision. "Cela donne une souplesse inédite au gouvernement", ajoute l'avocat.
Principe de non-régression
Les Amis de la Terre avaient aussi fait valoir que le décret méconnaissait le principe de non-régression inscrit en 2016 dans la partie législative du code de l'environnement par la loi de reconquête de la biodiversité. Selon ce principe, "la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment".
Selon le Conseil d'Etat, ce principe n'est pas méconnu car ce décret "ne permet pas de déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi tels que le principe de non-régression".Pour Maître Cofflard, "cette motivation apparaît insuffisante" car le décret conduit au final à soustraire des projets à l'obligation d'étude d'impact en violation du droit communautaire. Ce qui marque une rupture par rapport à la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017. Par cette décision, il avait annulé, pour méconnaissance du principe de non-régression, deux dispositions réglementaires qui exemptaient de toute évaluation environnementale des projets antérieurement soumis à une procédure de cas par cas.
"Ces dérogations sont inefficaces, estime en outre Maître Cofflard, car elles ne permettent pas de sécuriser les arrêtés pris dans leur cadre". Un risque qu'avait déjà souligné l'avocat Christian Huglo, jugeant fragiles les autorisations délivrées sur ce fondement, compte tenu de l'applicabilité des directives européennes existantes. Et ce, même si le décret affirme que la dérogation doit être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Le calcul fait par le gouvernement pourrait toutefois se révéler payant puisque, malgré les risques contentieux qu'Edouard Philippe a souhaité prévenir en adressant une circulaire aux préfets en avril 2018, aucun arrêté préfectoral de dérogation n'a pour l'instant fait l'objet d'un recours. De quoi motiver l'exécutif à généraliser le dispositif à l'issue de la phase expérimentale qui prend fin en décembre 2019.