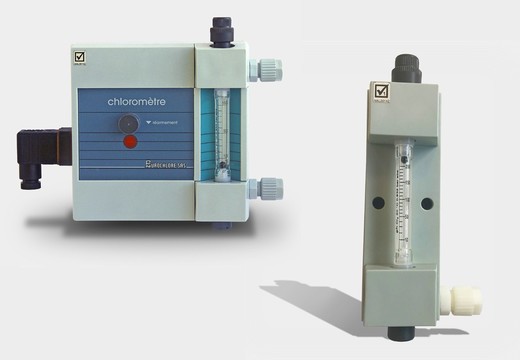En septembre dernier, le Commissariat général au développement durable (CGDD) évaluait à plus d'un milliard d'euros le coût, supporté chaque année par les ménages français, de la pollution de l'eau liée aux activités agricoles (résidus d'engrais et pesticides). En 2010 déjà, la Cour des comptes s'interrogeait sur la stratégie française consistant à traiter a posteriori l'eau destinée à la consommation, une stratégie 2,5 fois plus coûteuse au mètre cube traité que la prévention des pollutions. La Cour des comptes s'appuyait alors sur les exemples du Danemark et de la Bavière (Allemagne) qui sont parvenus, en impliquant les agriculteurs dans des actions préventives, à réduire de 30 % leurs consommations d'azote et de pesticides.
Face à ce constat, la Fédération nationale de l'agriculture biologique (Fnab) a souhaité se faire entendre en organisant un colloque sur l'agriculture biologique au service de la protection de l'eau. En favorisant une fertilisation azotée modérée, en évitant le recours aux intrants chimiques, en travaillant sur des rotations longues et diversifiées, en pratiquant un élevage extensif et en développant les surfaces en herbe, l'agriculture biologique limite en effet la contamination de l'eau.
Qualité de l'eau : plusieurs études favorables au bio
Une étude réalisée par le CNRS/Université Pierre et Marie Curie compare divers modèles développés dans le Programme interdisciplinaire de recherche sur l'environnement de la Seine (Piren-Seine). Ainsi, une généralisation des mesures agro-environnementales (améliorer les apports de fertilisants et de prélèvements, piéger l'azote…) permettrait de stabiliser la situation, en enrayant l'accroissement de la pollution azotée et ses effets, sans permettre une réelle amélioration de la qualité de l'eau. En revanche, une généralisation de l'agriculture biologique extensive permettrait une diminution nette de la contamination azotée des aquifères et des eaux de surface. Le développement de l'agriculture biologique sur les seules aires d'alimentation des captages en eau potable prioritaires (un tiers de la surface du bassin) permettrait déjà "des résultats encourageants", note l'étude. De son côté, l'Institut scientifique de recherche agronomique (Inra) a comparé les impacts sur la qualité des eaux de différents cahiers des charges agricoles de grandes cultures (AB, production intégrée suisse, Quali'terre, agriculture raisonnée…). Résultat : les modes de production biologique et de production intégrée suisse sont ceux qui ont le moins d'impact sur l'environnement, notamment sur la qualité des eaux. "Si les préconisations des autres cahiers des charges vont dans le bon sens, elles restent insuffisantes pour espérer voir une amélioration rapide de la qualité environnementale des territoires en grandes cultures", indique l'Inra, qui a également identifié des voies d'amélioration pour le cahier des charges AB : "Pour limiter encore plus l'impact sur le milieu en mode de production biologique, un certain nombre de pratiques devraient être encadrées (en particulier la gestion quantitative de l'azote, de l'irrigation, de la couverture du sol…)".
Munich : une expérience exemplaire
Plusieurs exemples montrent également l'intérêt de l'agriculture bio dans la préservation de la qualité de l'eau. Le plus connu est celui de la municipalité de Munich qui, depuis 1991, encourage le développement de l'agriculture biologique sur les terres situées à proximité des captages d'eau potable (6.000 hectares dont 2.250 hectares consacrés à l'agriculture). Outre un accompagnement technique et commercial (approvisionnement de la restauration collective des écoles et crèches), la municipalité et l'Etat ont rémunéré la contribution des agriculteurs bio à la protection de l'eau, à hauteur respectivement de 155 €/ha/an et 280 €/ha/an (puis 230 €/ha/an au bout de six ans). Ainsi, en moyenne un agriculteur touche chaque année 10.400 € (pour une exploitation moyenne de 24 ha), contre 3.300 € pour une exploitation identique en France, qui bénéficie de financements dans le cadre des mesures agri-environnementales. Résultat : 83 % des surfaces agricoles concernées ont été converties en bio. La zone comptait 23 agriculteurs bio en 1993, ce chiffre est passé à 107.
En 14 ans (1991-2005), les teneurs en nitrates de l'eau potable munichoise ont diminué de 43 % (de 14 à 8 mg/l) et les teneurs en produits phytosanitaires ont baissé de 54 % (de 0,000065 à 0,00003 mg/l). Coût de ce programme : 750.000 € par an, soit moins d'1 centime d'euro par mètre cube d'eau distribuée. En France, le seul coût de la dénitrification est évalué à 27 centimes d'euro par mètre cube d'eau distribuée.
Des initiatives en France
En France, depuis 2008, une démarche multipartenariale d'accompagnement du développement de l'agriculture biologique sur les aires d'alimentation de captage a été lancée par la Fnab, avec notamment la participation des ministères de l'Environnement et de l'Agriculture. Douze sites pilotes (1) , présentant un fort enjeu eau, participent au projet. Sur ces sites, un diagnostic initial a été réalisé et des indicateurs communs ont été définis afin d'établir un suivi et un bilan de ces initiatives.
Une démarche gagnant-gagnant
Outre la protection des zones de captage, le développement de l'agriculture biologique sur ces périmètres permet d'approvisionner la restauration collective en produits biologiques et locaux. Des circuits courts peuvent également être mis en place. Une dynamique économique territoriale peut s'installer durablement.