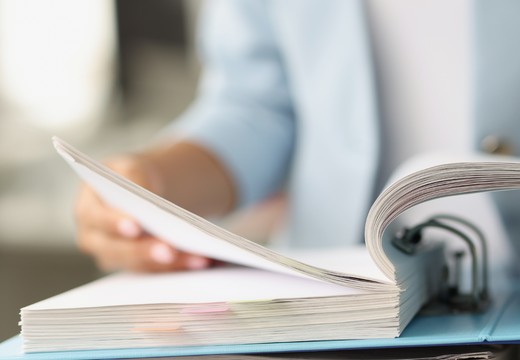Eric Woerth, ancien ministre du Budget du gouvernement Fillon, vient de déposer avec plusieurs autres députés de l'opposition une proposition de loi (1) visant à "ôter au principe de précaution sa portée constitutionnelle".
Ce principe, inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement (2) , est rédigé ainsi : "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".
La loi du 1er mars 2005 (3) a donné une valeur constitutionnelle à ce principe en même temps d'ailleurs qu'au reste de la Charte de l'environnement.
Fétichisation handicapante pour la croissance
"Si en 2005, la constitutionnalisation du principe de précaution se justifiait pleinement, la crise qui depuis nous a frappés a rendu l'avenir beaucoup plus incertain et la compétitivité de plus en plus rude. Il est donc nécessaire de lever tout frein à la croissance", estiment les signataires de la proposition de loi.
"Une société doit pouvoir oser, elle ne doit pas se donner des freins qui feraient obstacle à toute progression. Il s'agit de ne pas « sur-valoriser le doute » qui risquerait de bloquer l'innovation et le progrès scientifique (…). Certaines découvertes sont dues à des erreurs, des inattentions et des maladresses", peut-on lire dans l'exposé des motifs de la proposition de loi. Ses signataires craignent également que la possibilité de saisine directe du Conseil constitutionnel par les citoyens, à travers les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), ait pour effet "de restreindre ou d'entraver certaines recherches contraires aux intérêts de groupes de pression".
Quitte à entretenir la confusion avec le principe de prévention, les députés rappellent que de nombreux outils existent déjà, citant les procédures d'évaluation du risque qui s'imposent en permanence à travers les études d'impact ainsi que les divers débats nationaux et internationaux qui permettent "de rassembler experts en tout genre aptes à ne pas alimenter la peur de nos concitoyens".
S'ils reconnaissent que le principe de précaution constitue "un cadre d'action pour les autorités publiques confrontées à la gestion d'un risque incertain, dans les domaines environnementaux et sanitaires", ils estiment cependant qu'il suscite certaines interrogations en raison "d'une fétichisation qui pourrait s'avérer handicapante pour la croissance".
Les députés proposent par conséquent de déconstitutionnaliser le principe de précaution, remettant ainsi en cause "son positionnement dans la hiérarchie des normes en droit français", sans pour autant remettre en cause son existence, ni son utilité. Ils rappellent en effet que le droit européen empêche de le supprimer du droit français et que son inscription dans le code de l'environnement (4) lui garantit sa valeur législative.
Des critiques de plus en plus nombreuses
Cette proposition de loi semble synthétiser les critiques formulées contre ce principe, bien plus nombreuses ces derniers temps que les points de vue favorables à sa plus stricte application. Il faut dire que sa mise en oeuvre est accusée par certains d'entraver le développement économique. Or, la question est plus sensible en période de crise.
Dans son rapport sur la libération de la croissance française (5) de 2007, évoqué par les députés, Jacques Attali indiquait que "dans la réalité française, le principe de précaution conduit à des décisions qui sont pénalisantes pour les industriels et, de manière générale, pour l'investissement à long terme". Il préconisait d'abroger ou, à défaut, de préciser très strictement la portée de l'article 5 de la Charte de l'environnement, en clarifiant la nature du "dommage" et les conditions de son indemnisation.
En février 2002, l'Assemblée nationale adoptait, avec l'avis favorable du Gouvernement, une résolution tendant à adopter des lignes directrices afin d'accompagner la mise en œuvre du principe de précaution, jugée "inadaptée". Le député socialiste Philippe Tourtelier, qui avait proposé cette résolution avec son collègue UMP Alain Gest, avait fait quatre constats : une confusion avec le principe de prévention, une application principale dans le domaine de la santé, des jurisprudences divergentes et... l'absence de remise en cause de l'inscription du principe dans la Constitution. Il semble que les choses aient évolué sur ce dernier point en à peine plus d'un an.
Dans son rapport au Premier ministre intitulé "Pacte pour la compétitivité de l'industrie française" datant de novembre dernier, Louis Gallois estime, pour sa part, que "la notion même de progrès technique est trop souvent remise en cause à travers une interprétation extensive – sinon abusive – du principe de précaution". Et d'ajouter : "le principe de précaution doit servir à la prévention ou à la réduction des risques, non à paralyser la recherche (…) Fuir le progrès technique parce qu'il présente des risques nous expose à un bien plus grand risque : celui du déclin, par rapport à des sociétés émergentes qui font avec dynamisme le choix du progrès technique et scientifique".
En mars dernier, l'ancien ministre du Budget Alain Lambert et le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, fustigeaient dans leur rapport sur la simplification des normes l'épidémie d'incontinence normative "relancée par le principe de précaution qui fonde une société peureuse, frileuse, paralysée par l'obsession de prévenir tous les aléas".
Jusqu'à l'ancien président, Nicolas Sarkozy, qui, lors de son come back du 8 juillet, a dénoncé le principe de précaution "détourné comme un principe qui interdit".
Même si ses auteurs ont peu de chance de voir leur proposition de loi aller plus loin, cette dernière constitue le révélateur d'une évolution de certains parlementaires. Avec, en toile de fond, les questions récurrentes de l'exploitation du gaz de schiste ou des OGM…