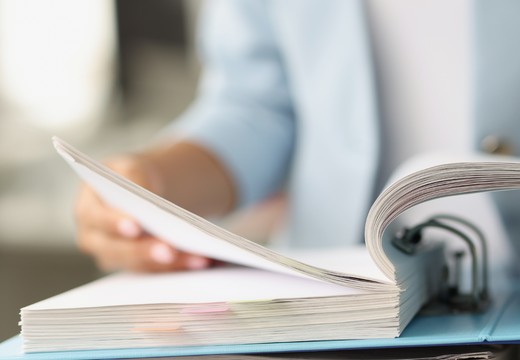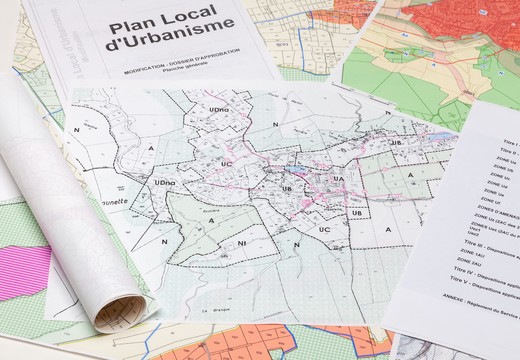Un nouveau protocole (1) sur la responsabilité et la réparation en caso de dommage causé par les mouvements transfrontaliers d'organismes vivants (2) modifiés (OVM) a été adopté le 15 octobre dernier à Nagoya dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB).
Il aura fallu six années de négociations pour voir aboutir ce ''protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur'' qui met en œuvre l'article 27 du protocole de Carthagène, qui prévoit l'élaboration de règles et de procédures internationales pour la responsabilité et la réparation lors de dommages à la biodiversité causés par des mouvements d'OVM.
Le protocole de Carthagène reconnaît les risques biotechnologiques
Le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique a été adopté en 2000 à Montréal et est entré en vigueur en 2003.
Ce protocole a pour objectif d'assurer une utilisation sécurisée des organismes génétiquement modifiés, qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé humaine et sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
Aujourd'hui, 160 Etats l'ont ratifié. Les Etats-Unis, le Canada et l'Argentine, principaux producteurs d'OGM dans le monde, ne l'ont pas signé. Selon la CDB, plus de 120 pays ont mis au point les cadres juridique et administratif nécessaires à la mise en œuvre du protocole. L'union européenne a, par exemple, adopté en 2004 une réglementation sur la responsabilité environnementale (prévention et réparation des dommages environnementaux).
Ce protocole reconnaît les risques liés au développement et à la commercialisation croissants des biotechnologies et vise à protéger les Etats n'ayant pas, jusque-là, développé d'outils juridiques pour garantir la biosécurité.Ce nouveau traité sera ouvert à la signature en mars 2011 et entrera en vigueur 90 jours après avoir été ratifié par au moins 40 Etats.
Un texte issu d'un compromis
Après six années de négociations, le texte adopté est un compromis entre les industriels et les principaux pays producteurs (avec en tête de file le Brésil) qui souhaitaient un régime souple, basé sur le volontariat, et les ONG et les pays du Sud (notamment le continent africain) qui demandaient un régime plus strict, avec l'application du principe de pollueur-payeur. Greenpeace proposait même la constitution d'un fonds international d'indemnisation, financé par des prélèvements sur les transactions d'OVM.
Finalement, le texte précise que les pays ayant subit un dommage lié à une importation d'OVM pourront exiger réparation en entamant une procédure administrative ou civile.
Pour Anne Furet, rédactrice et coordinatrice de la veille juridique à Inf'OGM, ''les objectifs ont été revus à la baisse, les discussions ont abouti à un texte très décevant''. D'abord, ''il n'y a pas eu d'ententes sur l'obligation de garantie financière des entreprises, question clé pour l'efficacité du dispositif. Le sujet a été totalement éludé''. Pourtant, la solvabilité d'un opérateur constitue une priorité pour la réparation des dommages causés.
Ensuite, les produits dérivés (tourteaux de soja GM ou farines de maïs GM par exemple) ne seront pas concernés par le protocole, ce qui réduit son champ d'application aux seuls OVM.
Un outil à destination des pays du Sud mais avec quels moyens ?
D'autres difficultés se posent quant à la mise en œuvre du protocole. Tout d'abord, il revient aux Etats de faire la preuve des dommages subis. Cela suppose d'effectuer des contrôles lors de l'entrée sur le territoire des marchandises et un appareil administratif important.
Ensuite, la réparation est limitée aux dommages ''importants'' : ceux-ci doivent avoir un caractère durable ou permanent, réduire la capacité de la biodiversité à fournir des biens et des services ou avoir un impact prouvé sur la santé humaine.