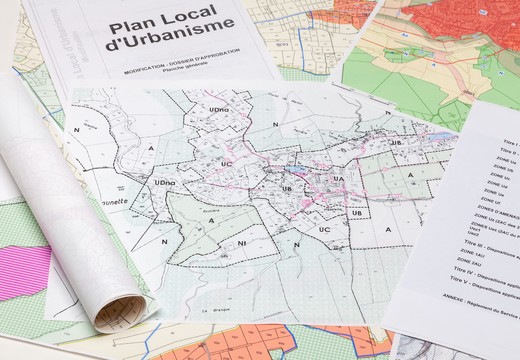Végétaliser les berges afin de les consolider peut paraître évident mais cette technique demande beaucoup de savoir-faire et de patience. Les intérêts écologiques qui en découlent laissent toutefois entrevoir un bel avenir à cette méthode.
Etat à la fin des travaux
Zones de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, les berges des cours d'eau naturels ou artificiels font l'objet de toutes les attentions au sein de
Voies Navigable de France (VNF), l'établissement public en charge de l'exploitation du domaine public fluvial. Soutènement des ouvrages, protection contre les inondations, lieu très riche en végétation et en faune, protection contre l'érosion, accueil d'activité de loisir, les berges concentrent à elles seules de nombreuses fonctions physiques, biologiques et socio-économiques. Elles doivent donc être régulièrement entretenues et consolidées pour assurer ces fonctions.
Si pendant longtemps cette consolidation a été réalisée grâce à des techniques de génie civil lourdes ayant des conséquences souvent désastreuses sur le milieu aquatique (bétonnage, palplanches métalliques), elle est depuis quelques années réalisée le plus souvent possible grâce à des techniques végétales. Alors que les techniques classiques représentaient 92,26% des opérations réalisées par VNF en 1999, elles ne représentaient plus que 53,57% en 2001.
“ Outre leur intérêt majeur sur le plan écologique et paysager, les techniques végétales sont peu onéreuses ” Voies Navigable de France (VNF)Une technique végétale est une technique utilisant des végétaux ou parties de végétaux afin de protéger une berge contre l'érosion, de stabiliser une zone érodée et de régénérer son sol. S'il s'agit d'une réplique de ce qui se fait naturellement sur les cours d'eau, ce qui peut passer pour du bon sens à première vue est en réalité complexe et exigeant. Les techniques végétales consistent globalement à installer des fascines de plantes hélophytes c'est-à-dire des fagots constitués d'un boudin géotextile lesté et de plantes qui apprécient d'avoir les racines immergées. Une étude préliminaire à l'aménagement doit être faite dans la plupart des cas afin d'adapter l'aménagement au site. Le géotextile peut être synthétique ou biodégradable, tissé ou non. Les végétaux doivent être choisis avec précaution afin de s'adapter au site. Il faut choisir les espèces en fonction des conditions d'implantation (sol, variations du niveau d'eau...) des végétaux déjà présents sur le site, de leur capacité à assurer la stabilité de la berge et de leur rapidité de croissance par rapport aux autres espèces implantées. Les travaux doivent être réalisés le plus souvent au printemps avant la reprise des plantes ou en automne pendant le repos des végétaux.
Au fil des réalisations, Voies Navigables de France a mis en évidence de nombreux intérêts à cette technique. Elle présente l'avantage de créer un milieu plus riche et de permettre une très bonne tenue de la berge grâce à l'enracinement des plantes. Le suivi scientifique de plusieurs aménagements a mis en évidence la migration de nouvelles espèces sur ces zones grâce aux plantes qui offrent de nouveaux habitats à des poissons, oiseaux, insectes.

Etat trois mois après la fin des travaux
Outre leur intérêt majeur sur le plan écologique et paysager, les techniques végétales peuvent être mises en place sans perturber la circulation sur la voie d'eau et sont peu onéreuses. D'après les données de VNF, une technique classique revient en moyenne à 191€ par mètres de berge alors qu'une technique végétale coûte en moyenne 137€ le mètre et peut atteindre 53€ si les travaux sont réalisés en régie. Ces chiffres varient évidemment en fonction de la hauteur du talus de berge, des conditions du site et de l'état initial de celui-ci. Le recours aux techniques végétales permet également de s'affranchir de procédures administratives préalables souvent longues et fastidieuses pour les techniques classiques.
Néanmoins, VNF prévient que ce type d'aménagement demande un suivi indispensable pour éviter un développement anarchique, surtout au cours des cinq premières années. Le professionnalisme de l'entreprise responsable de l'aménagement est également un point clef pour la réussite de l'installation. Certaines opérations demandent une main-d'œuvre conséquente pour leur réalisation qui doit, de plus, être qualifiée. Le nombre d'entreprises ou bureaux d'études capables de répondre à ce genre de marché est limité même si ces entreprises sont cependant en plein essor.
Article publié le 03 avril 2008