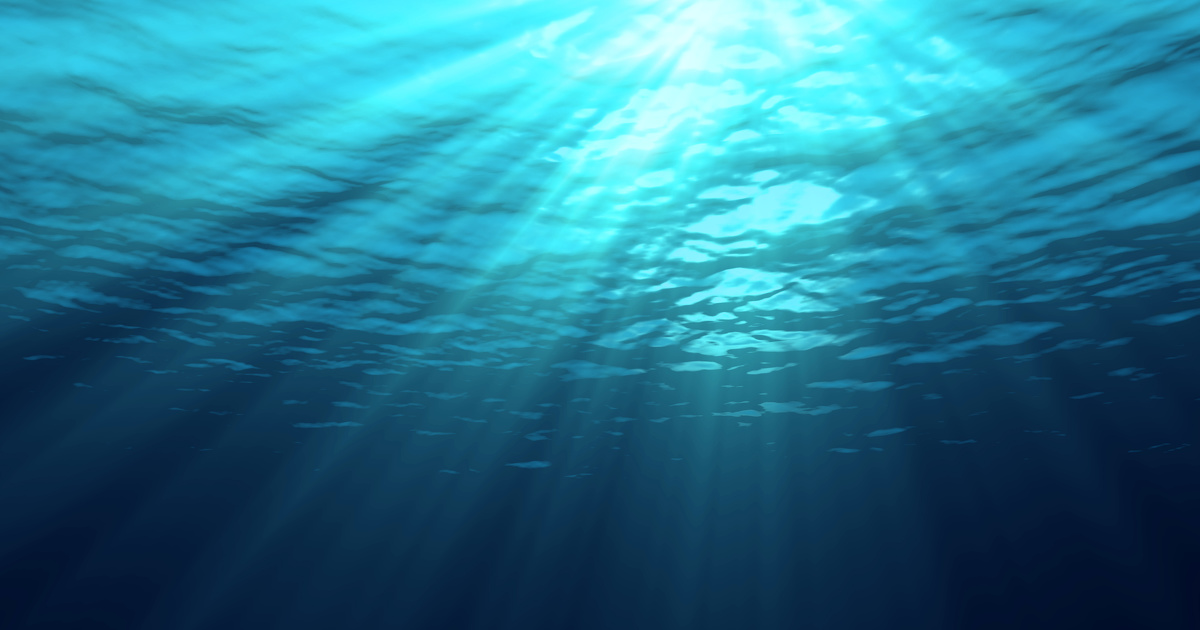Quelle stratégie adopter en France, dans le domaine de l'exploration, de la protection et de l'exploitation des grands fonds marins ? Après cinq mois de travaux, d'auditions et de voyages d'études sur ce sujet, la mission d'information had hoc du Sénat a rendu ses conclusions (1) , très mesurées, mardi 21 juin. Alors que les pressions s'accentuent sur les pouvoirs publics en faveur d'une exploitation des ressources minières des sous-sols en haute mer, les parlementaires avancent, en effet, sur ce terrain sensible avec une extrême prudence.
Au vu des connaissances actuelles sur ces espaces, « ou plutôt des méconnaissances », précise Teva Rohfritsch, sénateur de la Polynésie française et rapporteur de cette étude, les parlementaires estiment largement prématuré de se prononcer sur la pertinence d'une quelconque exploration, et a fortiori d'une exploitation, de ces milieux. Une position pas si éloignée qu'il n'y parait du moratoire sur les permis d'exploiter réclamé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en septembre dernier, et rejeté par la France. Certains élus des îles du Pacifique, des parlementaires européens et des associations, comme Greenpeace, comptent toutefois encore le relayer, lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans, ce lundi 27 juin, à Lisbonne.
Mobiliser les moyens de la connaissance
Un milliard de kilomètres cubes concernés
Créée en 2015 par des partenaires institutionnels, des organismes scientifiques et des ONG, la Fondation de la mer a également publié une étude sur les fonds marins, début juin. Cet espace représente 75 % du volume des océans et constitue 88 % du plancher océanique, soit une surface totale estimée à 320 millions de kilomètres carrés, détaille ce rapport. Le volume total d'eau située dans cette zone atteindrait 1 milliard de kilomètres cubes. Une aire que la Fondation recommande de « sanctuariser » en partie, en protégeant certains périmètres de toute intervention humaine.
Pour mener les travaux nécessaires au développement des savoirs, la mission préconise de concrétiser en cinq ans le projet de démonstrateur destiné à mesurer les impacts environnementaux de l'extraction minière. Annoncé en mai 2021, celui-ci est encore dans les limbes. Une fois les tests menés, les sénateurs proposent de réunir l'ensemble des parties prenantes afin d'examiner l'opportunité de poursuivre ou non l'objectif d'une exploration à des fins d'exploitation industrielle. « Et d'en déterminer, le cas échéant, les conditions techniques, le cadre juridique et les différentes étapes. »
Associer un plus grand nombre d'acteurs
Ces derniers insistent aussi sur la nécessité d'associer plus étroitement les citoyens et les élus, notamment ceux des outre-mer, particulièrement concernés, aux débats, aux décisions et au pilotage de la stratégie. Avec 9,5 millions de kilomètres carrés situés sous 1 000 mètres de profondeur, la France possède la plus vaste zone économique exclusive (ZEE) en zone de grands fonds marins dans le monde. La question concerne donc tout un chacun, estime la mission, notamment les habitants des régions marquées par un environnement maritime qui subissent déjà de plein fouet le réchauffement climatique. Or, les pouvoirs publics ont d'ores et déjà inscrit, sans aucune concertation, l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins dans le plan de relance France 2030, puis dans la stratégie française pour les grands fonds, publiée en janvier dernier, qui sera vraisemblablement dotée d'un financement de quelque 600 millions d'euros. D'ores et déjà, un comité de pilotage a été installé en février, tout comme a été acté le lancement de plusieurs missions d'exploration ().
Revoir la gouvernance
Le rapport suggère notamment d'imposer un débat parlementaire transparent, après consultation des collectivités, pour toute ouverture d'exploitation minière. Une bonne occasion, pour François Chartier, d'engager une salutaire réflexion de fond sur nos besoins réels, en matière de terres rares ou de cobalt, sur la nécessité de développer l'économie circulaire et de favoriser la sobriété. Pour mieux incarner le débat et lui donner plus de clarté, la mission d'information recommande, par ailleurs, de nommer un délégué interministériel aux Fonds marins, placé auprès du Premier ministre, et de reconstituer un ministère de la Mer de plein exercice. Mais il milite également pour la nomination d'un député et d'un sénateur représentant les outre-mer au sein du comité de pilotage de la stratégie.
En parallèle, l'Autorité internationale des fonds marins (AIMF), seule habilitée à délivrer les autorisations d'exploration, pourrait être accompagnée pour l'aider à développer « une véritable expertise scientifique » et « réaliser des contrôles efficients ». Une formule polie pour réclamer, à l'instar de Greenpeace, une réforme de cette émanation des Nations unies, dont le fonctionnement est jugé particulièrement opaque. « Cette réforme figure déjà dans sa propre convention et doit avoir lieu cette année, observe François Chartier. Mais l'accès aux débats est rendu très difficile aux observateurs et aux délégués des pays. » Là encore, la prochaine conférence de Lisbonne pourrait permettre de remettre le sujet sous les feux de l'actualité, tout comme celui de la réforme du Code minier. L'enjeu est d'autant plus important, relève la mission, que « les fonds marins font l'objet de convoitises à peine voilées de la part de la plupart des puissances mondiales », notamment des États-Unis, de la Chine et de l'Inde, qui ne s'embarrasseront probablement pas des mêmes préoccupations environnementales que la France.