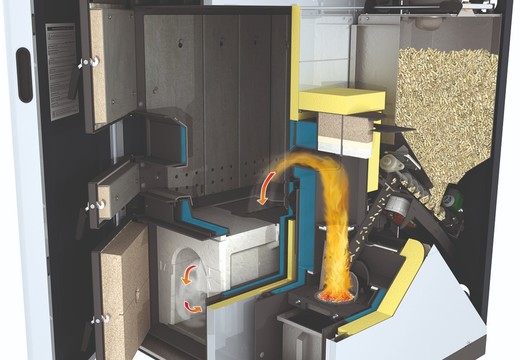Comme l'an dernier, la situation est "globalement assez satisfaisante". C'est ainsi que Pierre-Franck Chevet, président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a résumé, mardi 15 avril, devant les parlementaires de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), le rapport 2013 sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (1) .
L'audition a surtout été l'occasion pour l'ASN de mettre en avant les six "enjeux sans précédents" sur lesquels elle doit se pencher au plus vite. L'occasion, aussi et surtout, de plaider pour une augmentation de ses moyens dont elle dispose.
Stabilité des incidents constatés
Globalement, le président de l'ASN a pointé "la persistance d'incidents", avec une baisse des incidents classés au niveau 1 de l'Echelle internationale des évènements nucléaires (Ines), qui en compte huit (du niveau 0 au niveau 7, le plus grave), mais "un nombre d'écarts stable". En l'occurrence, l'ASN a relevé 1.796 évènements significatifs, dont 3 incidents classés au niveau 2 et 126 au niveau 1.
Comme l'an dernier, l'Autorité relève aussi des écarts selon les sites. S'agissant du domaine de la sûreté nucléaire, les centrales de Golfech et de Penly se distinguent de manière positive alors que celles du Bugey, de Chinon et de Civaux sont "en retrait". Les bons élèves, en matière de radioprotection sont Civaux, Golfech et Penly, et le mauvais élève est Cattenom. Enfin, Dampierre-en-Burly se distingue favorablement en matière d'impact environnemental quand Belleville-sur-Loire, Chinon et Chooz sont pointés du doigt par l'Autorité.
Restent deux problèmes qui se distinguent. Il s'agit tout d'abord de la reprise des déchets anciens sur le site de La Hague qui a fait l'objet d'une mise en demeure d'Areva, l'exploitant du site. "L'ASN sera attentive à ce que des revirements de stratégie industrielle ne retardent pas de façon notable la reprise et l'évacuation des déchets", indique le rapport. Second élément marquant, les problèmes rencontrés "à de multiple reprises" et les écarts constatés par rapport aux engagements pris par la Société franco-belge de fabrication de combustibles (FBFC) sur son site de Romans-sur-Isère. La filiale d'Areva, ainsi que la maison mère et quatre autres filiales, a elle aussi fait l'objet d'une mise en demeure.
Post-Fukushima : le plus dur reste à faire
Au-delà de ce bilan, l'Autorité a mis en avant "six enjeux sans précédents" pour la sûreté nucléaire et la radioprotection en France.
En premier lieu, il s'agit du retour d'expérience sur la catastrophe de Fukushima. Il faudra 10 ans pour assurer ce travail et "l'essentiel du travail est devant nous (…) la suite étant plus compliquée", insiste le président de l'Autorité. Pour l'instant, seules les grandes lignes des mesures post-Fukushima ont été définies. Il reste maintenant à faire le plus dur : détailler leur mise en œuvre, valider la stratégie des opérateurs et assurer le suivi de son application.
Deuxième dossier de choix : la poursuite ou non du fonctionnement des réacteurs EDF. Si pour l'instant l'ASN instruit la prolongation de 30 à 40 ans du fonctionnement d'une partie des réacteurs EDF, le passage au-delà de 40 ans est "un sujet pas totalement évident". L'enjeu, a expliqué Pierre-Franck Chevet, sera le relèvement de la sûreté des installations au niveau de celle de l'EPR pour des réacteurs conçus un demi siècle auparavant. Pour l'instant, "ce n'est pas acquis" et un avis définitif sur le sujet sera rendu en 2018.
La coopération internationale en matière de gestion des accidents nucléaires constitue un autre sujet important aux yeux de l'ASN. Rappelant que l'Autorité "[part] du postulat qu'un accident est possible", Pierre-Franck Chevet a mis en avant la nécessité d'homogénéiser les procédures de gestion de crise des différents pays européens, alors que de nombreux réacteurs sont proches de zones urbanisées (2) . Il a évoqué de "grandes difficultés à harmoniser les critères", annonçant "un travail de longue haleine".
Cigéo : attention à la réversibilité et à l'inventaire
Le Centre industriel de stockage géologique (Cigéo) de déchets nucléaires constitue un autre sujet important pour les prochaines années. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) devra prochainement décider de faire évoluer ou non son projet d'enfouissement des déchets radioactifs français, a rappelé le président de l'ASN, insistant sur les deux "questions clés" qui retiendront l'attention de l'Autorité. Il s'agit en premier lieu de la définition et l'application du concept de "réversibilité" qui "conditionne la construction mais aussi la gestion opérationnelle du site". Il s'agit ensuite de l'inventaire des déchets que l'on veut enfouir. Pierre-Franck Chevet a insisté pour que soient laissés ouverts certains choix, notamment la possibilité de stocker directement les combustibles irradiés si la France abandonnait leur retraitement.
Avant-dernier enjeu : le domaine médical. Point positif, le président de l'ASN a fait état de progrès en matière de radiothérapie permettant à la France de réintégrer la moyenne européenne. En revanche, il s'est montré plus inquiet face à la multiplication de certains examens qui a conduit à un doublement en dix ans des doses de rayons ionisants reçues par les patients. "Toutes les augmentations constatées ne sont pas toujours justifiées", a-t-il estimé.
Enfin, le radon pose toujours problème. "Ce n'est pas un sujet anecdotique", a jugé le président de l'ASN, pointant le fait que 10 à 15% des cancers du poumon sont liés au moins pour partie à l'exposition à ce gaz radioactif. Si les établissements recevant du public (ERP) sont encadrés par la réglementation, ce n'est pas le cas des bâtiments résidentiels a déploré Pierre-Franck Chevet.
150 à 200 employés supplémentaires
L'énumération de ces enjeux s'est achevée par la présentation des deux conditions nécessaires pour assurer au mieux la sûreté nucléaire et la radioprotection. Il faut tout d'abord des exploitants "en état de marche", a insisté Pierre-Franck Chevet, déplorant les retards et les écarts constatés lors des arrêts de tranche d'EDF, cela, alors même que "nous ne sommes pas dans le grand carénage (3) ".
Il faut aussi que l'Autorité de sûreté dispose de moyens adéquats. L'occasion pour l'ASN de réitérer devant les parlementaires son souhait de voir créer une sanction intermédiaire entre la mise en demeure, relativement bégnine, et la sanction suprême, c'est-à-dire la mise à l'arrêt d'une installation. Cette sanction intermédiaire pourrait prendre la forme d'une astreinte journalière.
Pierre-Franck Chevet a aussi souhaité une revalorisation du budget de l'ASN. Alors qu'actuellement un millier de personnes travaillent au contrôle de la sûreté nucléaire, il a estimé que 150 à 200 personnes supplémentaires devraient être recrutées pour assurer ce travail dans les années à venir. Cela représenterait une rallonge budgétaire de l'ordre de 50 millions d'euros. Conscient que les finances publiques sont exsangues, il a suggéré d'établir un financement sur la base de contributions versées par les "gros opérateurs" du nucléaire. Un mécanisme qui serait placé "sous le contrôle du Parlement".