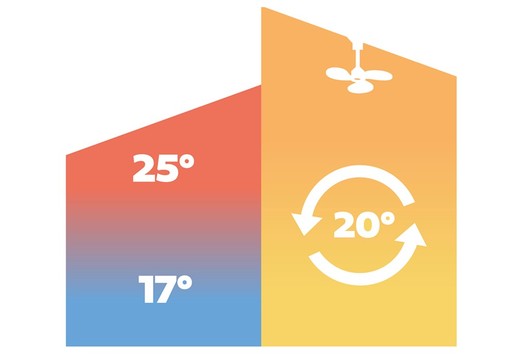Finalement, les 112 membres du Conseil national du débat, réunis le 18 juillet 2013 en plénière de clôture, ont rejeté le projet de recommandations et laissé au gouvernement le soin de trancher. Débuté avec un texte de 31 pages titré "15 recommandations pour la transition énergétique de la France", la journée s'est achevée avec une "synthèse" qui "souligne 15 enjeux majeurs" et explicite les divergences.
"Qui peut vivre avec ce texte ?" Tel a été le leitmotiv de Laurence Tubiana qui a tout fait pour satisfaire des acteurs aux positions parfois radicalement opposées. La question, maintes fois posée par la médiatrice, a rythmé l'adoption des formules les plus discutées.
"Ce n'est pas abouti, c'est un constat qu'on a tous fait ensemble", a constaté Laurence Tubiana. Le document, adopté dans une salle qui s'est progressivement dégarnie au cours de la journée, ressemble à un cahier de doléances présentant d'une phrase à l'autre des positions parfois très opposées. Le consensus n'a été atteint que sur une série de mesures, telles que l'impératif de rénovation thermique des bâtiments.
Les recommandations font place à une synthèse maladroite
Dans la ligne droite finale, FO a demandé que soit inscrit dans le texte son souhait de "ne pas s'associer aux recommandations et [de] n'être engagée par aucune d'entres elles" et le Medef a pour sa part laissé filtrer dans Le Monde (1) son refus de s'associer aux recommandations en cours de finalisation. Ce texte "est une synthèse partielle", indiquait le patronat qui a finalement obtenu gain de cause quant à la nature du document qui sera remis à l'exécutif lors de la conférence environnementale de septembre.
Dans cette ambiance, le ministre de l'Ecologie n'a eu de cesse en ouverture d'appeler les acteurs à trouver un compromis. Constatant que les membres du Conseil ont "débattu jusque tard [la veille au] soir", Philippe Martin les a exhortés à maintenir le dialogue. "Nous devons avoir le plus de monde dans la barque", a-t-il lancé, rassurant les acteurs sur le fait qu'il souhaite "respecter totalement" les divergences. Objectif de la journée ? Produire "le document de synthèse qu'[il] appelle de [ses] vœux". Même approche de la part de Laurence Tubiana qui, en introduction, a qualifié le texte de "bonne synthèse" ou encore de "synthèse maladroite mais nécessaire".
Message reçu, du côté du Medef qui annonce en réponse "[souhaiter] résolument vouloir rester dans la barque" tout en détaillant les dix points de désaccord : nucléaire, part de renouvelables, CSPE, CEE ou encore fiscalité écologique. Autant de désaccords connus de longue date. "Ca nous ira très bien", acquiesce la FNH au nom des ONG, rappelant que son organisation avait suggéré l'abandon des recommandations au profit d'une synthèse. FO a pour sa part maintenu sa position du refus du texte final, tout en restant dans la salle pour suivre les discussions. Pourtant, le syndicat "[refuse] une co-rédaction et une co-construction des préconisations (…) dans ce DNTE" et a clairement indiqué rejeter le document "quel que soit son nom".
Le CNI et la position interministérielle
Certains acteurs, ont insisté sur les recommandations émises par le Conseil national de l'industrie (CNI). Une contribution qui propose de réduire les émissions de GES en se basant sur les acquis des filières industrielles françaises et sur le nucléaire en particulier. Une position qui convient à FO ou à la CFE CGC qui se déclarent plus proches de ces positions que de la synthèse du débat.
Au-delà des positions du CNI, c'est la façon de les présenter qui attire l'attention et éclaire sur la tactique des acteurs, alors que le gouvernement devra trancher les points non consensuels. Pour FO, le cahier d'acteur du CNI traduit "une position interministériel". Un terme lourd de sous-entendu qui laisse entendre que les arbitrages ministériels ont déjà été rendus dans le cadre du CNI.
Certes, le CNI est officiellement présidé par le Premier ministre, mais il est hébergé par les services d'Arnaud Montebourg et sa cheville ouvrière, Jean-François Dehecq son vice-président, a une carrière de cadre et d'administrateur de grands groupes (Elf Aquitaine, Pechniney, Veolia, Sanofi-Aventis ou encore Air France).
Certes, les divergences seront respectées, mais "un débat national ne remplace pas le gouvernement", a prévenu Philippe Martin, expliquant que ce dernier tranchera. "Le plus dur commence", a averti la FNH qui appelle le gouvernement à trancher certains points dès maintenant. Un point largement partagé par les différents acteurs qui n'ont eu de cesse d'appeler l'exécutif à prendre ses responsabilités par rapport à une synthèse qui étale les désaccords. "Au gouvernement de dire la trajectoire retenue", a résumé la CGPME.
De même, les membres du Conseil ont indiqué rester attentifs au parcours législatif du futur texte, anticipant de fait une guérilla parlementaire. De fait, la parenthèse du débat se referme et les acteurs retournent à leur activité de lobbying habituelle... La bataille est d'ailleurs déjà engagée avec la constitution probable d'un groupe de contact entre le Conseil national du débat et le Parlement. De même, FNE a appelé à la formation d'une commission parlementaire transversale, craignant que le débat en commission du futur texte soit attribué aux Affaires économiques.
Si le sénateur écologiste Ronan Dantec a appelé les acteurs à "ne pas s'engager dans la barque avec une chignole", rien n'indique que certains ne tenteront pas de couler la transition énergétique. Un risque d'autant plus grand que les oppositions les plus fortes concernent l'un des éléments essentiels de la transition voulue par François Hollande : la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production énergétique. A l'issue du débat, il apparaît que le Medef comme les syndicats de salariés refusent toujours le cadre politique préalable aux discussions…
Débat politique et propositions concrètes
Au cours de la séance de rédaction, les acteurs "généralistes", c'est-à-dire le patronat, les salariés et les écologistes, se sont attachés à peaufiner les formulations les plus politiques abordant les grandes lignes de la transition, et tout particulièrement la part du nucléaire ou des renouvelables et la division par deux - ou non - des consommations énergétiques à l'horizon 2050. Le gouvernement devra donc décider des grands axes de la transition et, aux vues des oppositions, faire des mécontents.
Parmi les sujets plus concrets, l'obligation de travaux de rénovation énergétique dans le bâtiment a focalisé l'attention. L'opposition à cette mesure constitue "une ligne rouge" pour la CGPME. Les représentants des artisans ont pour leur part clairement indiqué "[ne pas pouvoir] s'associer à un document avec une obligation de travaux".
Enfin, les acteurs les plus spécialisés se sont assurés que leurs mesures phares apparaissent clairement dans le texte final. C'est le cas, par exemple, de la Fondation Abbé Pierre, qui a insisté sur la place à accorder à la précarité énergétique, de la plupart des représentants des collectivités locales (maires, grandes villes ou régions) appelant à plus de décentralisation afin qu'ils puissent reprendre la main sur des éléments clés de planification territoriale et en particulier les réseaux de distribution d'énergie.
Finalement, c'est peut-être l'Unaf qui décrit le mieux la situation après six mois de palabre : "le débat ne fait que commencer".