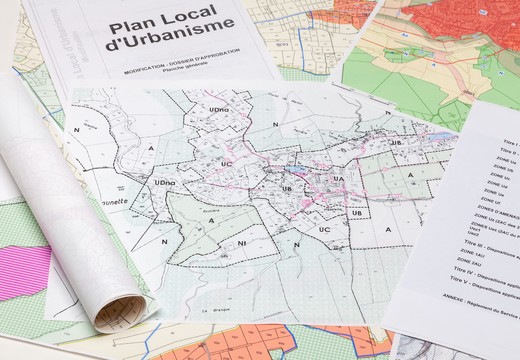Un rapport, commandé par le Parlement européen et publié en octobre par l'Ecologic institute et Bio intelligence service (BioS), fait le point sur les implications du projet de zone de libre-échange transatlantique (1) (TTIP) dans le domaine de l'environnement. Pour rappel, des négociations ont été ouvertes, en juillet dernier, entre l'Union européenne et les Etats-Unis pour créer l'une des plus vastes zones de libre échange. L'étude le rappelle en préambule : les économies concernées représentent la moitié du PIB mondial. Les normes énoncées dans cet accord pourraient donc devenir mondialement partagées. "Par conséquent, veiller à ce que l'accord respecte des normes élevées pour la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire est de la plus haute importance", soulignent les auteurs, qui rappellent les craintes émises par plusieurs acteurs sur un possible nivellement par le bas des normes environnementales et de sécurité alimentaire.
Un risque juridique non négligeable
Le rapport se penche d'abord sur le risque juridique que représente un tel accord pour l'Union européenne. Par le passé, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a débouté les entreprises qui s'appuyaient sur les règles de l'Organisation mondiales du commerce (OMC) pour dénoncer des règles environnementales préjudiciables à leur commerce.
Mais préviennent les auteurs, de nombreux accords d'échange bilatéraux ouvrent des failles juridiques. Le règlement des différends investisseur-État se passe alors en dehors des voies classiques. Ce qui permet aux investisseurs étrangers de demander réparation du préjudice subi par le manquement présumé de l'État d'accueil à ses obligations à l'égard des investissements.
Si le TTIP est rédigé en termes généraux concernant les clauses de protection, cela pourrait entraver l'UE et les États membres dans leurs efforts d'établir des règlements qui cherchent à protéger leurs citoyens et l'environnement, alertent les auteurs, qui recommandent donc d'être attentif sur ce point-là concernant le futur accord. L'association Générations futures, qui relaie ce rapport, illustre cette problématique avec un exemple d'actualité : "La compagnie suédoise Vattenfall demande actuellement des centaines de millions d'euros de compensation à l'Allemagne suite à sa décision de sortir du nucléaire".
Plus globalement, les auteurs estiment que l'acte le plus fort que peut entreprendre le Parlement est de ne pas approuver l'accord négocié, ce qu'il a déjà fait dans le passé. Solution plus mesurée : jouer un rôle dans la sensibilisation du public aux enjeux de cet accord bilatéral et engager des débats politiques sur les points clés. "Nous recommandons au Parlement européen d'accorder une très grande attention à la formulation précise des dispositions qui concernent l'environnement, la sécurité alimentaire et les arbitrages commerciaux, afin de veiller à ce que les deux parties soient en mesure de maintenir les normes de protection de l'environnement et des consommateurs nécessaires".
Des normes plus élevées en Europe
Les auteurs ont passé en revue plusieurs domaines où les règlements européens et américains diffèrent (OGM, risque chimique, émissions carbone de l'aviation…). Ils en concluent que, globalement, le schéma est le suivant : "Les Etats-Unis ont choisi soit de ne pas reconnaître les risques pour l'environnement et la santé humaine reconnus par l'UE, soit de traiter ces risques par des moyens nettement différents de l'approche choisie en Europe, par exemple en se contentant de promulguer des lignes directrices volontaires plutôt que des obligations". Parfois, les américains ont même entamé un travail de sape de l'ambition européenne en matière d'environnement, notamment pour ce qui est de l'inclusion de l'aviation civile dans le marché des quotas.
"Dans les cas étudiés, la protection de la réglementation européenne est plus élevée, et plus exigeante et moins flexible que la législation américaine avec le secteur privé. Les raisons de cette divergence sont difficiles à évaluer, mais sont sans doute dues, à des degrés divers, à des campagnes médiatiques, au lobbying de l'industrie, mais aussi à des préférences des consommateurs et à une perception différente des préoccupations environnementales". A noter cependant que certains Etats américains vont plus loin dans la protection des consommateurs et de l'environnement.
OGM, agroalimentaire : pas de principe de précaution aux Etats-Unis
La question des organismes génétiquement modifiés a déjà fait l'objet de différents devant l'OMC entre les Etats-Unis et l'Europe. Cette dernière s'appuie "sur le principe de précaution et un processus d'évaluation des risques approfondi pour déterminer quels OGM sont autorisés sur le marché, tandis que les régulateurs américains supposent que les OGM sont « substantiellement équivalents » à leurs homologues non-OGM et leur permettent d'accéder au marché sans régime réglementaire distinct".
La différence est moins grande pour la gestion du risque chimique et pourrait au contraire permettre aux législateurs américains de renforcer le régime applicable au risque chimique (2) . La présentation de données de sécurité par les industriels, exigée par le règlement européen Reach, pourrait être reprise par les Etats-Unis qui n'exigent, pour l'heure, que "la présentation de données de sécurité en des circonstances très spécifiques et permet ainsi aux produits chimiques présents sur le marché avant 1976 de rester sur le marché sans aucun test ou obligation d'enregistrement". Les auteurs indiquent que la question du renforcement de la législation sur les produits chimiques a été présentée au Congrès dès 2005.
En revanche, la question des traitements de réduction des agents pathogènes (TRP), destinés à réduire la quantité de microbe sur la viande, a déjà opposé l'UE et les Etats Unis devant l'OMC, notamment sur la volaille. L'UE interdit l'importation de viande de volaille transformée par traitements chimiques et estime, depuis 1997, que seule l'eau, le froid ou une substance déjà approuvée, peuvent être utilisés pour traiter la volaille. Les Etats-Unis autorisent certains traitements, dont le dioxyde de chlore, le chlorite de sodium acidifié, le phosphate trisodique et les peroxyacides. Les normes européennes auraient ainsi entraîné une perte de "centaines de millions de dollars à l'exportation américaine". Les négociateurs américains pourraient donc remettre cette question sur le tapis lors des discussions sur le TTIP.
Autre sujet qui fâche entre les deux continents : l'inclusion de l'aviation dans le système d'échange de quotas européen. L'Union européenne a en effet décidé de soumettre les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur au marché des quotas. Devant la forte opposition suscitée par cette mesure, notamment aux Etats-Unis, l'UE a suspendu cette mesure et discute d'un compromis dans le cadre de l'Organisation mondiale de l'aviation civile (OACI), pour 2016.