


Que ce soit en France ou en Europe, les politiques de gestion des risques industriels se construisent au rythme des accidents. Un retour d'expérience nécessaire qui participe à la mise en place d'un dialogue entre les acteurs locaux concernés.

 Ce dossier a été publié dans la revue Environnement & Technique n°332
Ce dossier a été publié dans la revue Environnement & Technique n°332Septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse explose causant 31 décès, 2.242 blessés et détruisant 30.000 foyers. La France découvre alors qu'une partie de ses citoyens vit exposée à des risques industriels majeurs, conséquence d'une urbanisation toujours plus proche des sites industriels. Mars 2013, usine de Lubrizol près de Rouen : un dégagement accidentel d'un produit dont l'odeur est proche de celle du gaz naturel est ressenti jusqu'à Paris provoquant, sur son sillage, la panique et submergeant de nombreux services de secours.
Entre ces deux accidents aux origines et conséquences bien différentes, douze ans ont passé. Douze ans pendant lesquels la question des risques industriels a fait l'objet de plans d'action gouvernementaux mis en musique via des lois, décrets et autres circulaires… Douze ans de construction d'une culture du risque en France qui peine encore à se développer.
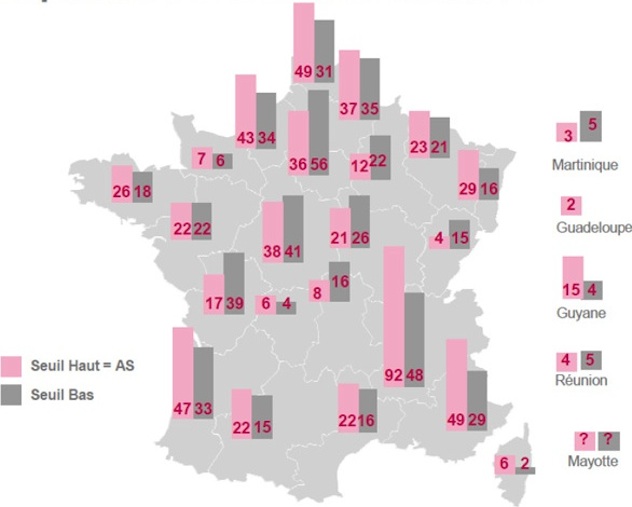
Les industriels doivent également, depuis peu, travailler de concert. C'est en tout cas ce que souhaite l'Etat français dans sa nouvelle doctrine présentée en avril 2013 en matière de gestion des risques industriels. Mutualisation des procédures, des équipements de protection, des études de dangers… l'exercice semble déroutant pour les industriels. Alors qu'ils commencent seulement à maîtriser le dialogue avec les collectivités, les voilà sommés d'échanger entre eux. Un exercice à l'épreuve du terrain.
Florence Roussel
© Tous droits réservés Actu-Environnement
Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur.
Retrouvez le dossier "Sites industriels : l’enjeu de l’urbanisation"
à la une du n° 332
Acheter ce numéro
S'abonner