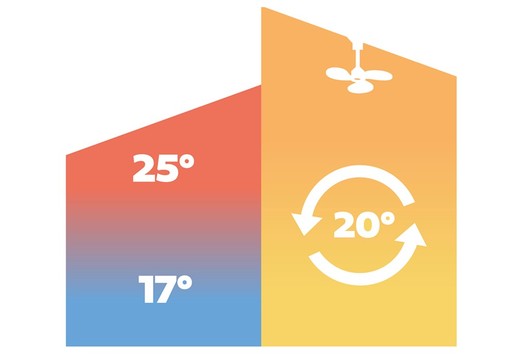Le président des Etats-Unis énonce trois préalables, déjà martelés par les porte-parole du gouvernement des Etats-Unis : les ''économies majeures'' doivent s'engager dans des réductions d'émissions ''décisives'', sous-entendu les grands émergents, tels que l'Inde et la Chine, doivent afficher leurs engagements au même titre que le Nord ; tous les pays doivent accepter des vérifications internationales de l'évolution de leurs émissions, et c'est sur ces fameuses MRV (mesures de rapport et de vérification) qu'achoppe toute la négociation depuis le début, car les pays en développement n'accepteront d'être ''vérifiés'' que pour les mesures d'atténuation financées par les pays industrialisés ; troisièmement, les Etats-Unis proposent un fonds international de 10 milliards de dollars à partir de 2012 pour les pays en développement, alors qu'il s'agissait, pour le G77, de le débloquer dès 2010 et de le faire monter en puissance jusqu'à 400 milliards de dollars.
Mais le fund raising ne fait pas tout : ''nous ne sommes pas des mendiants. Cette somme est la facture des émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés'', déclare Lula. Une dette non négociable, qui, pour le président du Brésil, ne relève pas d'un marchandage, mais d'un impératif de solidarité. Le temps n'est plus à la commisération post-coloniale, sous la tutelle dépassée du FMI et de la Banque mondiale.
Les postures se crispent sur des nationalismes mêlés de sentiments d'injustice, sur fond de récession globale. L'Union européenne, autrefois force d'entraînement de ces négociations, ne sait plus s'exprimer d'une seule voix. Les initiatives individuelles d'un Nicolas Sarkozy pour mobiliser un levier de financement à court terme pour les pays du Sud agacent et divisent. La présidence suédoise de l'Union européenne manque d'énergie. Le Danemark n'a pas su tenir son rôle d'hôte de la conférence, tant par la mauvaise organisation pratique de l'événement que par une accumulation de maladresses, vécues comme des affronts par les pays du Sud et les grands émergents. De leur point de vue, ce petit royaume septentrional n'est pas plus grand qu'un quartier de Shanghai.
Du coup, l'animation des négociations dérape. Une déclaration politique se prépare, qui rétrécit d'heure en heure comme une peau de chagrin. Dans la journée, plusieurs drafts ont officieusement circulé. De textes ultra complexes négociés pendant deux ans, depuis la conférence de Bali (2007) en vue du régime post 2012 de Kyoto, on passe, en moins de 24 heures, à une vague déclaration de principe, qui pourrait ne pas entériner la suite du Protocole de Kyoto, mais se limiter à des orientations génériques, ni chiffrées ni datées : stabiliser la hausse des températures à + 2°C, opérer des réductions ''profondes'' des émissions globales, s'engager à des réductions de ''x'' pour cent en 2020 par rapport à 1990…
Cette déclaration, confirmée en fin de soirée, met sans ambiguïté un terme à l'avenir même du processus onusien. Reporter à 2010 l'adoption d'un traité reviendrait à une sortie ''sans gloire'', comme l'a souligné le président du Vénézuela Hugo Chavez lors d'une conférence de presse improvisée et fracassante.
Dans la soirée, c'est la sidération : la déclaration finale ne comporte plus aucune mention au Protocole de Kyoto et reporte les négociations sine die. Les chefs d'Etat quittent le sommet les uns après les autres. A 23h30, Barack Obama donne une conférence de presse qui lève les dernières incertitudes : le président des Etats-Unis décrit le monde de demain, où chaque pays fera un rapport sur ses réductions d'émissions en dehors de tout traité international. Il n'évoque pas de relais à Kyoto, tout en estimant que ce protocole, adopté en 1997, n'a pas accompli ses objectifs. Manifestement, le monde entre dans une ère d'incertitudes et de turbulences. Voici Kyoto décapité, et sans postérité. Désormais, c'est chacun pour soi.