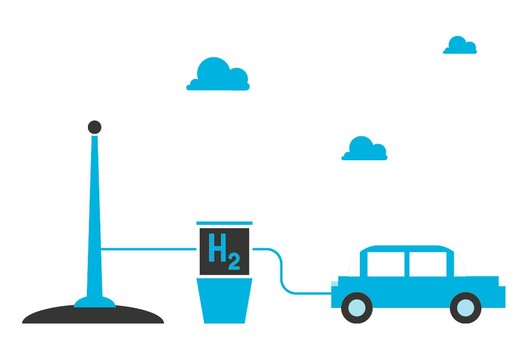Emmanuel Macron aime déclamer son intention de faire de la France la « championne » de l'hydrogène, de l'intelligence artificielle, ou encore de l'avion « vert ». Mais en matière d'éolien en mer, le chef de l'État s'est contenté de vouloir « aller deux fois plus vite », tant il sait que le titre est encore loin de sa portée. Le pays-roi incontesté du secteur reste le Danemark. Et jusqu'à présent, le port d'Esbjerg en constitue la meilleure preuve.
Le bon élève européen
En 2022, près de 55 % de l'électricité produite au Danemark provenait de l'énergie éolienne (contre 8,5 % pour l'Hexagone). À lui seul, l'éolien en mer (uniquement posé) en produit environ 25 % à partir d'une capacité totale de 2,6 gigawatts (GW). Ce qui en fait le troisième pays à l'énergie la plus « verte » de l'Union européenne (juste derrière l'Autriche et la Suède). À titre de comparaison, le Royaume-Uni ne couvre, avec ses 14 GW de capacité maritime, « que » 15 % de son mix électrique – pour, certes, une consommation de 300 térawattheures (TWh), contre les 35 TWh du Danemark. Cette primauté n'est évidemment pas nouvelle : le premier parc éolien offshore au monde, composé de 11 machines de 450 kilowatts (kW), a été posé en 1991 à deux kilomètres de Vindeby, dans la province danoise du Lolland. Le pays attendra néanmoins le début des années 2000 pour faire du vent le fleuron de sa stratégie énergétique. Le parc Horns Rev 1 (160 MW) a notamment consacré l'ascension du constructeur danois Vestas au trône de chef de file du marché mondial des turbines et du port d'Esbjerg, au large duquel il a été mis en service en 2002.
Le fruit d'une évolution énergétique
Cette histoire et cette ambition se traduisent sur le terrain sous la forme d'infrastructures portuaires, comme celles d'Esbjerg. Dès la fin du XIXe siècle, cette ville portuaire de la côte sud-ouest de la péninsule du Jutland constitue l'un des principaux ports de pêche (et d'exportation de bacon danois vers le Royaume-Uni) de la mer du Nord. Le premier choc pétrolier de 1973 la transforme une première fois en plaque tournante de l'industrie pétrogazière, à mesure que le pays se met à exploiter ces puits de pétrole et de gaz naturel en mer jusqu'à pouvoir en exporter au milieu des années 1990. Une dernière transformation industrielle et culturelle s'opère enfin au début des années 2000, avec l'avènement de l'éolien en mer. Esbjerg devient dès lors la capitale exportatrice de pales, de mâts et de turbines. Traduite en puissance électrique équivalente, « notre production moyenne est de 1,1 GW de capacité éolienne livrée par an, chiffre Jesper Bank, directeur commercial du port d'Esbjerg, comptant sur des constructeurs tels que Vestas ou Siemens Gamesa. À force, nous ne nous considérons plus tout à fait comme un port, mais plutôt comme un "hub énergétique". »
L'électrification indirecte comme alternative ?
Avec autant d'électricité éolienne bientôt à sa disposition, le Danemark risque
d'en produire au-delà de ses propres besoins de décarbonation et de consommation. Si le petit royaume nordique se positionne évidemment sur l'exportation, il semble également avoir l'intention de valoriser cette électricité renouvelable excédentaire. La « sur-installation » d'éoliennes en mer devient alors une stratégie de coproduction de carburants de synthèse – un exemple de « power-to-x » – et de stockage par « électrification indirecte », ou « power-to-x-to-power ». « Évidemment, cette optique n'est seulement valable qu'avec de l'électricité en excès, tant l'électrification directe reste bien plus rentable et efficace dans tous les cas », commente René Alcatraz Frederiksen, directeur du département "power-to-x" de l'entreprise danoise European Energy. Cette dernière a justement dans l'idée d'installer, avant la fin de l'année, un, puis deux électrolyseurs de 3 mégawatts (MW) sur le port d'Esbjerg pour valoriser entre 80 et 90 % de l'électricité que produisent, désormais en surplus, quatre éoliennes terrestres érigées près des quais. L'électricité ainsi stockée sera ensuite reconvertie en électricité par des piles à combustible afin de recharger certains bateaux, comme le ferry effectuant plusieurs fois par jour la navette entre Esbjerg et l'île frisonne de Fanø.
La folie des grandeurs ?
Une telle exemplarité s'est illustrée à travers la Déclaration d'Esbjerg. En mai 2022, le port sert de théâtre à une première décision d'ampleur internationale : le Danemark s'engage, aux côtés de l'Allemagne, des Pays- Bas et de la Belgique, à installer collectivement 65 GW d'éoliennes en mer du Nord d'ici à 2030, puis 85 GW de plus d'ici à 2050. Puis, en avril 2023, ces quatre nations sont rejointes par la France, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège et le Royaume-Uni à travers la Déclaration d'Ostende, pour pousser cette volonté à un total de 300 GW en 2050, s'alignant ainsi sur les objectifs du plan européen RePowerEU. Mais l'Europe et, avec elle, le Danemark, auraient-ils les yeux plus gros que le ventre ?
« Nous attendons une croissance de la demande de 400 % d'ici à 2030, estime Jesper Bank. Or, pour assurer ce nouveau rythme de livraisons, il va nous falloir accentuer la capacité logistique du port, ce qui ne pourra se faire en moins de dix ans. Et ce, sans compter sur l'augmentation perpétuelle de la puissance, donc de la taille et du poids des éoliennes à assembler, puis stocker, et de la dimension des bateaux de transport. L'optique même d'installer, par exemple, une usine de fabrication de pâles, pour accélérer la cadence, prendrait la place du port entier ! » Le stockage des mâts associés aux turbines de dernière génération, de 14 à 16 MW, pose déjà un problème majeur. « Certains d'entre eux pèsent parfois, mis ensemble, plus de 1 000 tonnes et ne peuvent donc être stockés sur le port plus de deux à trois semaines, sous peine de risquer l'effondrement des quais sur lesquels ils reposent. »
Esbjerg compte déjà mobiliser 150 millions d'euros pour y répondre et couvrir les deux à trois premières années de travaux. En parallèle, il en appelle à mutualiser les moyens avec les autres ports européens concernés. En janvier 2023, il a accueilli la signature d'une autre charte d'engagement, convenue quelques mois plus tôt. Accompagnés d'Ostende, de Saint-Nazaire, de Groningue (Pays-Bas), de Cuxhaven (Allemagne) et d'Humber (Royaume-Uni), Esbjerg s'est assuré le renforcement de leurs coopérations, notamment sur le partage des espaces de stockage des éoliennes.
Ces promesses ne suffiront pas à résoudre, cependant, les obstacles à la massification escomptée de l'éolien offshore. « Comme beaucoup de ses voisins européens, le Danemark fait actuellement face à une pénurie de main-d'œuvre, qui concernera tout autant la filière éolienne, indique Iver Høj Nielsen, directeur du programme de financement public Partenariat pour une croissance verte, piloté par l'agence danoise State of Green. Grâce à un assouplissement de la réglementation voté en mars 2023, le gouvernement prévoit déjà d'attirer des ingénieurs et des techniciens de l'étranger, qui permettront au Danemark de répondre à la concurrence chinoise. » La bataille se joue également sur la chaîne d'approvisionnement. Selon Mads Kroghs, directeur de la communication danoise du groupe suédois Vattenfall, « la demande grandissante s'ajoute à une inflation déjà extrêmement forte, élevant drastiquement le coût des matériaux. L'investissement nécessaire pour compenser reste énorme, surtout à l'heure où les États-Unis, avec leur loi sur la réduction de l'inflation par exemple, changent les règles du jeu. »
Le titre d'Esbjerg, et de surcroît du Danemark, serait-il menacé ? Seul l'avenir le dira et, en particulier, en fonction du succès (ou de l'échec) de son projet le plus ambitieux à ce jour : les « îles énergétiques ». De quoi le placer au centre d'un marché européen d'échange d'électricité renouvelable, en tant que principal exportateur pour des décennies ou perdre le bénéfice d'une prédominance historique, en trébuchant sur une marche trop haute à atteindre.