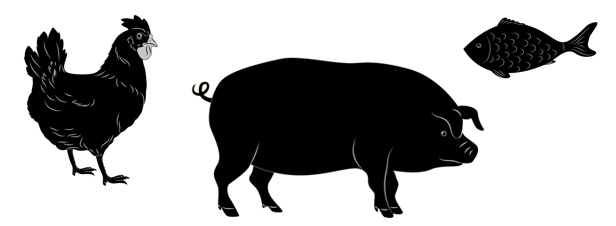Le 18 juillet dernier, le comité permanent de la chaîne alimentaire de la Commission européenne a voté en faveur de la réintroduction des "farines animales" de non-ruminants dans l'alimentation des poissons. Ce sont les règlements européens 999/2001 relatif aux règles de prévention, de contrôle et d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (1) et 1069/2009 concernant l'exploitation des sous-produits animaux (2) qui sont ainsi revus. La France et l'Allemagne sont les seuls pays de l'UE à avoir voté contre. Le texte devrait être publié d'ici la fin de l'année pour une entrée en application prévue pour le 1er juin 2013.
Attitude de la France
En 2011, le précédent ministre de l'agriculture Bruno Lemaire avait pourtant affirmé sur RTL que "les farines animales ne seraient pas réintroduites en France tant qu'il serait ministre de l'agriculture". Son mandat expiré, qu'en est-il de la gouvernance de Stéphane Le Foll ? Le ministère de l'agriculture n'envisage pas de s'opposer à l'application du texte en France.
En route vers la levée pour les animaux terrestres ?
Selon Jean-Luc Angot, directeur général adjoint de l'alimentation au ministère de l'agriculture et en charge notamment des EST, "la levée de l'interdiction pour les animaux terrestres n'est pas à l'ordre du jour car cela demande une réflexion plus importante. Elle pose d'autres problématiques que pour les poissons". Il semble cependant que la réflexion sur le sujet soit déjà bien entamée puisque la Commission européenne finance depuis 2007 et à hauteur de 1,7 million d'euros des recherches visant à déterminer si certaines farines animales à base de porc et de poulet peuvent être réintroduites dans l'alimentation des animaux d'élevage. Rappelons la position de la Commission en 2005 : "Si certaines conditions sont remplies à l'avenir – ce qui n'est pas le cas actuellement – on pourra envisager l'alimentation croisée, par exemple à base de porc pour les poulets ou à base de poulet pour les porcs". En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a déjà publié en 2009 et 2011 deux avis défavorables dans l'attente de conditions contraignantes supplémentaire (3) s "pour garantir une sécurité alimentaire totale" tandis que le Conseil National de l'Alimentation (CNA) a donné son aval depuis décembre dernier (4) .
Les protéines animales répondent à un besoin des éleveurs Mammifères exclus, exception faite du porc
Le prion, agent pathogène responsable des EST, est une forme anormalement repliée de la protéine PrP-c présente uniquement chez les mammifères. Tous les mammifères sont donc susceptibles de développer une EST, dont la forme diffère selon l'espèce (la tremblante pour le mouton, l'ESB pour les bovins, les différentes formes de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme). Pour cette raison, il n'y aura pas de remise en question de l'exclusion des ruminants (bovins, ovins, caprins) dans la réintroduction des farines animales. Le poisson et la volaille ne sont pas sujets aux EST. Seul le porc est un cas à part. En laboratoire, en injectant des grandes quantités de prions dans le système nerveux du porc, une forme d'EST se développe mais aucun cas de porc atteint d'une EST n'a été détecté dans la nature à ce jour. Des travaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) parus en novembre 2007 indiquent, de plus, que l'augmentation du risque d'exposition de l'homme aux EST par la consommation de viande de porcs nourris aux PAT de volaille est négligeable.
Au lendemain des deux crises de la vache folle de 1996 et 2000, des mesures d'urgence ont été mises en place : arrêt de l'importation de viande anglaise, abattage systématique de tout le troupeau dès lors qu'un animal atteint de l'EST a été détecté, interdiction d'alimentation de tout animal avec des farines animales… Pour Jean-Philippe Deslys, directeur de recherche au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et spécialiste du prion, l'agent pathogène responsable des EST, les mesures prises ont été efficaces pour l'éradication de la maladie mais très larges et coûteuses en raison du manque de connaissances sur les capacités de développement et de transmission ainsi que de moyens ciblés. Selon lui, "maintenant qu'on en sait bien plus sur cet agent pathogène devenu très rare et avec la crise alimentaire qui se profile, la question qui brûle les lèvres est de savoir si on ne pourrait pas trouver un juste milieu". Il précise que la crise de la vache folle est la conséquence d'aberrations dans la production des farines des années 80 où les sous-produits d'animaux étaient recyclés et redonnés à des animaux de la même espèce (cannibalisme animal), normalement exclusivement herbivores de surcroît.
Si aujourd'hui la question de réintroduire les protéines animales transformées est à nouveau posée, c'est qu'elles présentent un avantage majeur : leur coût est faible relativement à leur richesse énergétique, critère sur lequel aucune céréale ne rivalise. Pour Laurent Alibert du pôle alimentation animale de l'Ifip, institut français du porc, animal omnivore, "le retour des protéines animales permettrait d'alléger la pression sur l'aliment qui pèse sur les éleveurs due au coût élevé et prévu à la hausse des céréales". Il précise que l'aliment représente entre 60 et 70% du coût de revient pour l'éleveur de porc français. A cela s'ajoute le problème de gestion des trois millions de tonnes par an des sous-produits d'élevage. Certains, propres à la consommation humaine (classés catégorie 3), pourraient être recyclés via les protéines animales transformées.
Réflexion sur une filière PAT encadrée et contrôlée
"On parle de protéines animales transformées, non plus de farines animales et ce n'est pas une coquetterie de langage" explique Yves Berger, directeur général d'Interbev, l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. En effet, les protéines animales transformées (PAT) sont définies par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) (5) comme "des protéines animales qui dérivent en totalité de matières premières protéiques de catégorie 3 (co-produits d'abattage propres à la consommation humaine excluant les animaux malades) n'incluant aucun produit à partir de sang, lait, colostrum, gélatine, protéines hydrolysées, dicalcium et tricalcium phosphate, œufs, collagène". De plus, seule l'alimentation croisée serait autorisée (alimentation des porcs avec des PAT de volaille et inversement). Les circuits de production et distribution des PAT devraient être spécifiques à chaque espèce. Un test permettant de détecter l'origine des protéines animales des farines afin de pouvoir vérifier à n'importe quelle étape du processus (production, distribution…) la bonne étanchéité des filières a d'ailleurs déjà été validé.
Toutefois, Jean-Luc Angot du ministère exprime une réserve : "le risque c'est que les PAT n'aillent pas qu'aux poissons et que la séparation stricte des filières ne soit pas toujours respectée". Jean-Philippe Deslys du CEA ajoute que "les dérives sont par expérience difficiles à maîtriser une fois que les vannes sont ouvertes". Dans son dernier avis, l'Anses concluait en 2011 que des progrès avaient été réalisés au niveau de la spécialisation des filières mais que les conditions n'étaient pas encore toutes réunies pour faire évoluer la réglementation, en particulier au niveau des moyens de contrôle de la bonne étanchéité des filières.
L'UE face aux importations
Jean-Luc Angot du ministère de l'agriculture l'affirme, il n'y a ni viande hormonée ni nourrie aux PAT importée en France. "100 % des lots sont contrôlés et l'autorisation d'importation découle d'une procédure assez longue sur la base d'une classification de l'OIE [organisation mondiale de la santé animale] et d'audits effectués par l'OAV [Office Alimentaire et Vétérinaire], le service d'inspection de la Commission européenne". En effet, l'OIE classe les pays en fonction du risque sanitaire que représente leur viande en trois catégories : risques négligeables (pas de cas d'EST et présence d'une réglementation de surveillance), risques maîtrisés (quelques cas d'EST mais contrôlé) dont la France et pays à risques (cas d'EST non contrôlés ou absence de mesures particulières et de surveillance). Les pays des deux dernières catégories ne peuvent passer les barrières de l'UE que s'ils mettent en place des filières dédiées à l'exportation et après certification par l'UE. Sur le terrain, la seule viande hors UE présente sur le marché européen provient d'Argentine et du Brésil, deux pays prochainement classés à risques négligeables.
Peu d'alternatives énergétiques aux PAT
Pour faire face à la flambée du prix des céréales, il existe plusieurs propositions : les farines de poissons, la culture de légumineuses, cultiver du soja en Europe, mais aucune ne semble satisfaisante. Concernant les farines de poisson d'indice énergétique proche de celui des protéines animales, "elles sont utilisées pour les porcelets, surtout dans le Nord de l'Europe, mais trop chères et contraignantes" pour Laurent Alibert de l'institut du porc, et sont "devenues une aberration car on pille les océans à hauteur de 20 millions de tonnes par an uniquement pour nourrir les élevages de poissons d'après les données de la FAO", selon Jean-Philippe Deslys du CEA. Le principal problème posé par les légumineuses pourtant plus riches en énergie que le soja est sa teneur en cellulose très mal digérée par les carnivores. Il existe aujourd'hui des technologies permettant de réduire la quantité de cellulose mais Laurent Alibert note que "ça fait 25 ans que sort un plan protéagineux tous les un ou deux ans". Il pointe également l'absence d'investissement dans l'exploitation de soja "alors qu'on a tous les outils pour le faire dans le sud de la France et se détacher de notre dépendance aux importations".
Jean-Philippe Deslys voit davantage l'élevage de demain plus respectueux des cycles de la nature avec des déchets animaux digérés dans un premier temps par des insectes qui pourront nourrir ensuite des poissons ou des volailles ajoutant ainsi une barrière d'espèce. Selon lui, "les insectes, sortes de mini usines, sont capables de transformer les sous-produits animaux en protéines et lipides de façon plus efficace et plus propre que nous".
1994 : interdiction des farines animales pour les ovins et caprins.
1996 : 1ère crise de la vache folle entraînant l'arrêt des importations de viande anglaise et le durcissement des normes de préparation des farines.
2000 : 2ème crise de la vache folle entraînant la mise en place de l'abattage systématique et l'interdiction totale des farines animales en France.
2001 : interdiction totale des farines animales dans l'UE.
2002 : assouplissement des mesures sur l'abattage systématique avec la notion de cohorte après avis de l'Afssa.
2006 : réautorisation d'importation de viande anglaise sous certaines conditions.
2007 : rapport de l'Efsa avec la notion de PAT et sur les risques négligeables liés à l'alimentation croisée des poissons, porcs et volailles avec PAT. Bruxelles demande d'étudier une éventuelle réintroduction des farines animales.
2009 : premier avis défavorable de l'Anses dans l'attente de progrès des filières.
2011 : second avis défavorable de l'Anses qui note des progrès mais non suffisants et avis favorable du CNA qui ne traite pas les questions de sécurité sanitaire.
2012 : vote du comité permanent de la chaîne alimentaire de la CE en faveur de la réintroduction des PAT de porc et volaille dans l'alimentation des poissons.