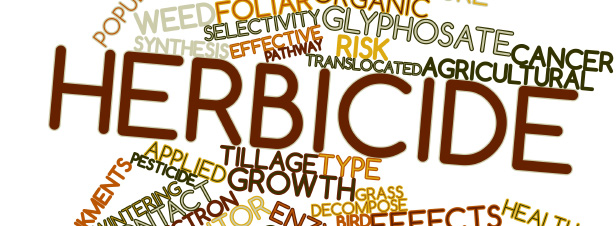"Il est improbable que le glyphosate présente un danger cancérogène pour l'Homme", assure dans un rapport (1) remis jeudi 12 novembre l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). Pour les experts, cette substance ne serait pas génotoxique et ne nécessiterait pas la classification de cancérogène dans la réglementation de l'UE sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques.
En mars dernier, le centre international de recherche sur le cancer (Circ), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans son évaluation de cinq pesticides organophosphorés, avait pourtant classé comme cancérogène probable pour les Hommes le glyphosate (groupe 2A (2) ). "L'évaluation a pris en compte une vaste quantité d'éléments, y compris un certain nombre d'études non évaluées par le Circ, ce qui explique en partie pourquoi les deux évaluations ont abouti à des conclusions différentes, justifie l'Efsa. C'est la distinction entre substance active et formulation de pesticides qui explique principalement les différences dans la façon dont l'Efsa et le Circ ont évalué les données disponibles".
Des incertitudes à lever
Le rapport de l'Efsa souligne également que des informations complémentaires restent nécessaires pour évaluer la voie de contamination de l'eau de ruissellement et par conséquent la pollution de l'eau de surface mais également l'infiltration dans les eaux souterraines.
Concernant l'écotoxicologie, des lacunes dans les données demeurent également pour l'évaluation du risque à long terme pour les petits mammifères herbivores et les oiseaux insectivores. En revanche, le risque pour les abeilles, les arthropodes non cibles, les macro et micro-organismes du sol ainsi que pour les méthodes biologiques de traitement des eaux usées a été considéré comme faible. Lorsque des mesures d'atténuation ont été mises en œuvre, l'Efsa estime également comme faible le risque pour les plantes terrestres non-cibles.
En effet, les deux organismes ont une approche différente de la classification des produits chimiques : l'Efsa évalue chaque substance chimique individuelle et chaque mélange commercialisé, de manière séparée tandis que le Circ examine des agents génériques, y compris des groupes de produits chimiques connexes, ainsi que l'exposition professionnelle ou environnementale, et les pratiques culturelles ou comportementales.
Comme l'Institut fédéral pour l'évaluation des risques (BfR) allemand, l'Efsa considère qu'il est "probable que les effets génotoxiques observés dans certaines formulations contenant notamment du glyphosate soient liés aux autres constituants ou coformulants. De même, certaines formulations contenant notamment du glyphosate présentent une toxicité plus élevée que celle présentée par l'ingrédient actif, probablement en raison de la présence de coformulants". L'Efsa préconise donc que la toxicité de chaque formulation de pesticides, et leur potentiel génotoxique, soient examinés par les autorités des Etats membres.
" La Commission européenne ne doit pas suivre des recommandations qui facilitent le retour sur le marché d'un pesticide parmi les plus utilisés sur la base d'une évaluation des risques sous-estimée et favorable à l'industrie", a réagi Michèle Rivasi, vice-présidente du groupe Verts/ALE et membre de la commission "environnement et santé" au Parlement européen.
Des conflits d'intérêts ?
Cet avis de l'Efsa entre en effet dans le cadre de la réévaluation des risques du glyphosate pour renouveler son autorisation en Europe. Cette procédure implique qu'un Etat membre rapporteur, ici l'Allemagne, rende un premier rapport pour examen à l'Efsa qui enverra elle même ses conclusions à la Commission européenne. La Commission décidera alors de conserver ou non le glyphosate sur la liste des substances actives autorisées dans l'UE. Ensuite, les Etats membres pourront également évaluer la sécurité des pesticides (formulations) contenant la substance active vendue sur leur territoire.
En août dernier, l'Institut fédéral pour l'évaluation des risques (BfR) allemand avait déjà indiqué que "les données disponibles ne montrent pas de propriétés cancérogènes ou mutagènes du glyphosate, ni que ce dernier est toxique pour la fertilité, la reproduction ou le développement embryonnaire des animaux de laboratoire". Des associations comme Foodwatch s'étaient toutefois interrogées sur la composition des membres du comité d'évaluation de BfR (3) dans lequel figurait en 2014 notamment deux représentants de BASF et un de Bayer CropScience.
Cette crainte d'une éventuelle pression des industriels pèse également sur le rapport remis par l'Efsa. "Les garanties de l'Efsa concernant le Glyphosate soulève de sérieuses questions quant à son indépendance scientifique, estime Franziska Achterberg, en charge pour Greenpeace des questions sur la politique alimentaire de l'UE. Une grande partie de son rapport repose sur des études non publiées commandées par les producteurs de glyphosate".
Selon Greenpeace, l'Efsa aurait inclus six expériences sur les animaux que l'OMS aurait exclues du fait que les "données n'auraient pas été publiées ou révisées par des pairs".
A l'inverse, dans un communiqué Monsanto pointe que "ces évaluations nouvelles et robustes des agences réglementaires vont à l'encontre de la classification du CIRC, (…) A la lumière de la procédure d'évaluation européenne du glyphosate, de vraies questions doivent être posées quant à la procédure de classification par le CIRC".
L'introduction d'une dose aiguë de référence
Concernant la toxicité, le groupe d'examen par les pairs constitué d'experts de l'Efsa et de représentants désignés par les Etats membres de l'UE a estimé qu'il fallait "redéfinir la toxicité du Glyphosate".Le groupe a donc établi un "seuil de sécurité toxicologique" et fixé une dose aiguë de référence (4) (DARf) pour le glyphosate s'élevant à 0,5 mg par kg de poids corporel.
"En introduisant une dose aiguë de référence, nous renforçons encore la façon dont les risques potentiels associés au glyphosate seront évalués dans le futur", a assuré dans un communiqué Jose Tarazona, chef de l'unité Pesticides à l'Efsa.Autres limites proposées par l'agence européenne : un niveau acceptable d'exposition des opérateurs (NAEO) a été fixé à 0,1 mg/kg de poids corporel par jour, et une dose journalière admissible (DJA) pour les consommateurs a été établie en ligne avec la dose aiguë de référence à 0,5 mg/kg de poids corporel.
L'EFSA a précisé qu'elle se baserait sur cette DARf lorsqu'elle révisera les limites maximales en résidus (5) pour le glyphosate, en coopération avec les Etats membres en 2016. L'Agence européenne des produits chimiques (Echa) devrait également se pencher sur les risques pour la santé liés à l'utilisation du glyphosate et publier un rapport en 2017, selon Greenpeace. "L'Agence européenne des produits chimiques (Echa) pourrait avoir une opinion différente de l'EFSA, a souligné Franziska Achterberg. Cela n'a aucun sens de renouveler pour 10 ans l'autorisation au glyphosate tant que ce processus n'est pas terminé".